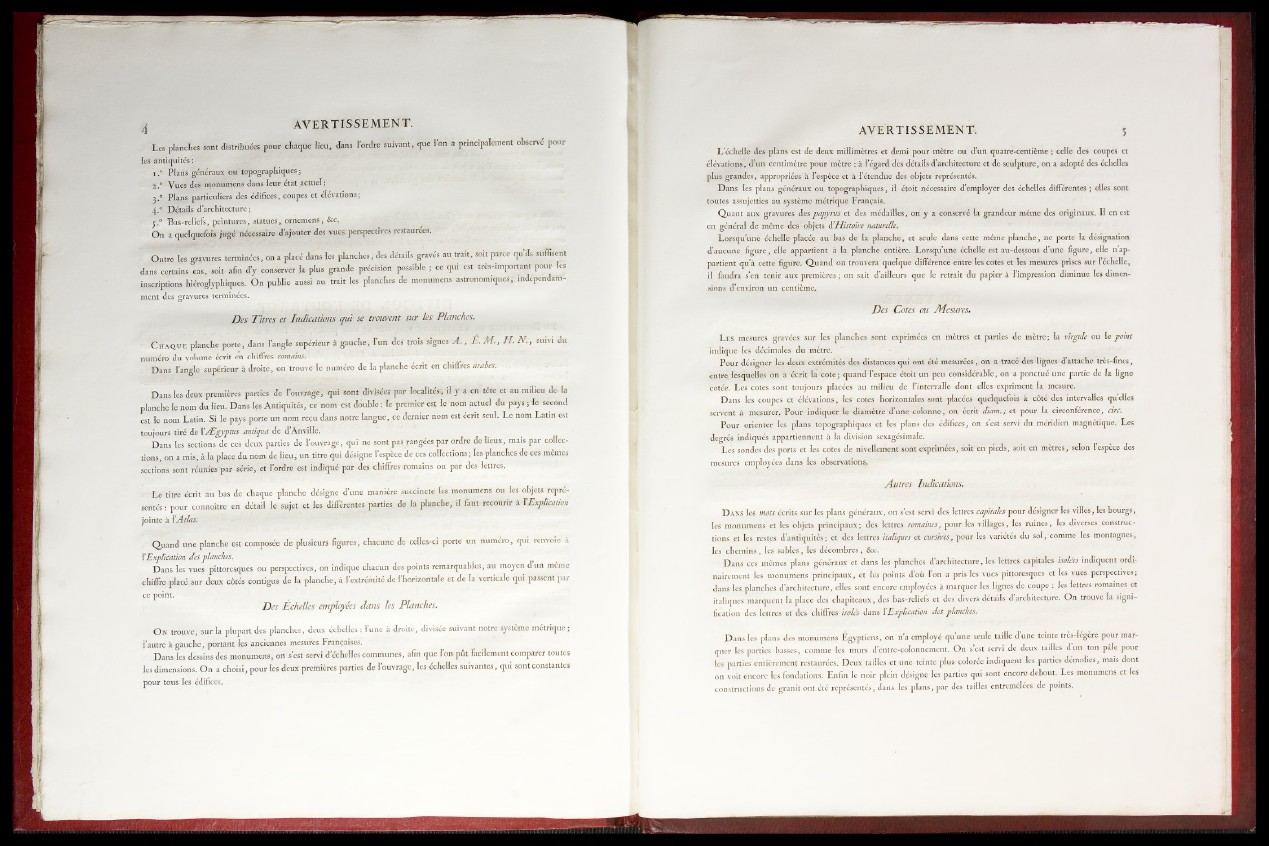
Les planches sont distribuées jo u r chaque lieu, dans l’ordre suivant, que Ion a principalement observé pour
les antiquités:
i.° Plans généraux ou topographiques ;
i.° Vues des monumens dans leur état actuel ;
3.0 Plans particuliers des édifices, coupes et élévations;
4.° Détails d’architecture;
y ° Bas-reliefs, peintures; statues,, ornemens, &c,
Gn a quelquefois jugé nécessaire d’ajouter des vues perspectives restaurées.
Outre les g^vüres terminées, on a placé dans les planchès, des détails gravés au trait, soit parce qu’ils suffisent
dans certains cas, soit .afin d’y conserver la plus grande précision possible ; ce qui est très-important pour îes
inscriptions hiéroglyphiques. On publie aussi au trait les planches de monumens astronomiques, indépendant-
ment des gravures terminées.
Des Titres et Indications qui se trouvent sur les Planches.
'C h a q u e planche porte, dans l’angle supérieur à g au ch e , l’un des tro is ‘signes A . , É . 'M . , H . N . , suivi du
numéro du volume écrit en chiffres romains.
Dans l’angle ¿supérieur à droite, on trouve le numéro de la planche écrit en chiffres arabes.
Dans les deux premières parties de l'ouvrage, qui sont divisées par localités; il y a en tête et au milieu de la
planche le nom du lieu. Dans les Antiquités, ce nom- est double: le premier est le nom actuel du pays ; de second
est le nom Latin. Si le pays porte un nom reçu dans notre langue, ce dernier nom est écrit seul. Le nom Latin est
toujours tiré de l’Ægyptus antiqua de d’Anvifle.
Dans les sections de ces deux parties de l’ouvrage, qui ne sont pas rangées par ordre de lieux, mais par collections,
on a mis, à la place du nom de lieu, un titre qui désigne l’espèce de ces collections; les planches de ces mêmes
sections sont réunies par série, et l’ordre est indiqué par des chiffres-romains ou par des lettres.
; Le titre écrit au bas de chaque planche désigne d’une manière succincte les monumens ou les objets représentés
: pour connoître en détail le sujet et les différentes parties de la planche, il faut recourir à I Explication
jointe à XAtlas.
Quand une. planche est composée de plusieurs figures, chacune de celles-ci porte un numéro, qui renvoie a
l’Explication des planches.
Dans les vues pittoresques ou perspectives, on indique chacun des points remarquables, au moyen dun meme
chiffre placé sur deux côtés contigus de la planche, à l’extrémité de I horizontale et de la verticale qui passent par
pe point.
Des Échelles employées dans les Planches.
O n trouve; sur la plupart des planches, deux échelles : l’une à droite, divisée suivant notre système métrique;
l’autre à gauche, portant les anciennes mesures Françaises.
Dans les dessins des monumens, oit s’est servi d’échelles communes, afin que l’on pût facilement comparer toutes
les dimensions. On a choisi, pour les deux premières parties de l’ouvrage, les échelles suivantes, qui sont constantes
pour tous les édifices.
L ’échelle des plans est de deux millimètres et demi pour mètre ou d’un quatre-centième ; celle des coupes et
élévations, d’un centimètre pour mètre : à l’égard des détails d’architecture et de sculpture, on a adopté des échelles
plus grandes, appropriées à l’espèce et à l’étendue dés objets représentés.
Dans les plans généraux ou topographiques, il étoit nécessaire d’employer des échelles différentes ; elles sont
toutes assujetties au système métrique Français.
Quant aux gravures des papyrus et des médailles, on y a conservé la grandeur même des originaux. II en est
en général de même des objets d’Histoire naturelle.
Lorsqu’une échelle placée au bas de la planche, et seule dans cette même planche, ne porte la désignation
d’aucune figure, elle appartient à la planche entière. Lorsqu’une échelle est au-dessous d’une figure, elle n appartient
qu’à cette figure. Quand on trouvera quelque différence entre les cotes et les mesures prises sur l’échelle,
il faudra s’en tenir aux premières ; 011 sait d’ailleurs que le retrait du papier à l’impression diminue les dimensions
d’environ un centième.
Des Cotes ou Mesures.
L es mesures gravées sur les planches sont exprimées en mètres et parties de mètre; la virgule ou. le point
indique les décimales du mètre.
Pour désigner les deux extrémités des distances qui ont été mesurées, on a tracé des lignes d’attache très-fines,
entre lesquelles on a écrit la cote ; quand l’espace étoit un peu considérable, on a ponctué une partie de la ligne
cotée. Les cotes sont toujours placées au milieu de l’intervalle dont elles expriment la mesure.
Dans les coupes et élévations, les cotes horizontales sont placées quelquefois à côté des intervalles qu elles
servent à mesurer. Pour indiquer le diamètre d’une colonne, on écrit diam.; et pour la circonférence, circ.
Pour orienter les plans topographiques et les plans des édifices, on s’e6t servi du méridien magnétique. Les
degrés indiqués appartiennent à la division sexagésimale.
Les sondes des ports et les cotes de nivellement sont exprimées, soit en pieds, soit en métrés, selon lespece des
mesures employées dans les observations.
Autres Indications,
D ans les mots écrits sur les plans généraux, on s’est servi des lettres capitales pour désigner les villes, les bourgs,
les monumens et les objets principaux; des lettres romaines, pour les villages, les ruines, les diverses constructions
et les restes d’antiquités; et des lettres italiques et cursives, pour les variétés du sol, comme les montagnes,
les chemins, les 6ables, les décombres, &c.
Dans ces mêmes plans généraux et dans les planches d’architecture, les lettres capitales isolées indiquent ordinairement
les monumens principaux, et les points d’où l’on a pris les vues pittoresques et les vues perspectives;
dans les planches d’architecture, elles sont encore employées à marquer les lignes de coupe : les lettres romaines et
italiques marquent la place des chapiteaux, des bas-reliefs et des divers détails darchitecture. On. trouve la signification
des lettres et des chiffres isolés dans 1 Explication des planches.
Dans les plans des monumens Égyptiens, on n’a employé qu’une seule taille dune teinte très^legère pour marquer
les parties basses, comme les murs d’entre-colonnement. On s’est servi de deux tailles dun ton pâle pour
les parties entièrement restaurées. Deux tailles et une teinte plus colorée indiquent les parties démolies, mais dont
on voit encore les fondations. Enfin le rioir plein désigne les parties qui sont encore debout. Les monument et les
constructions de granit ont été représentés, dans les plans, par des tailles entremelees de points.