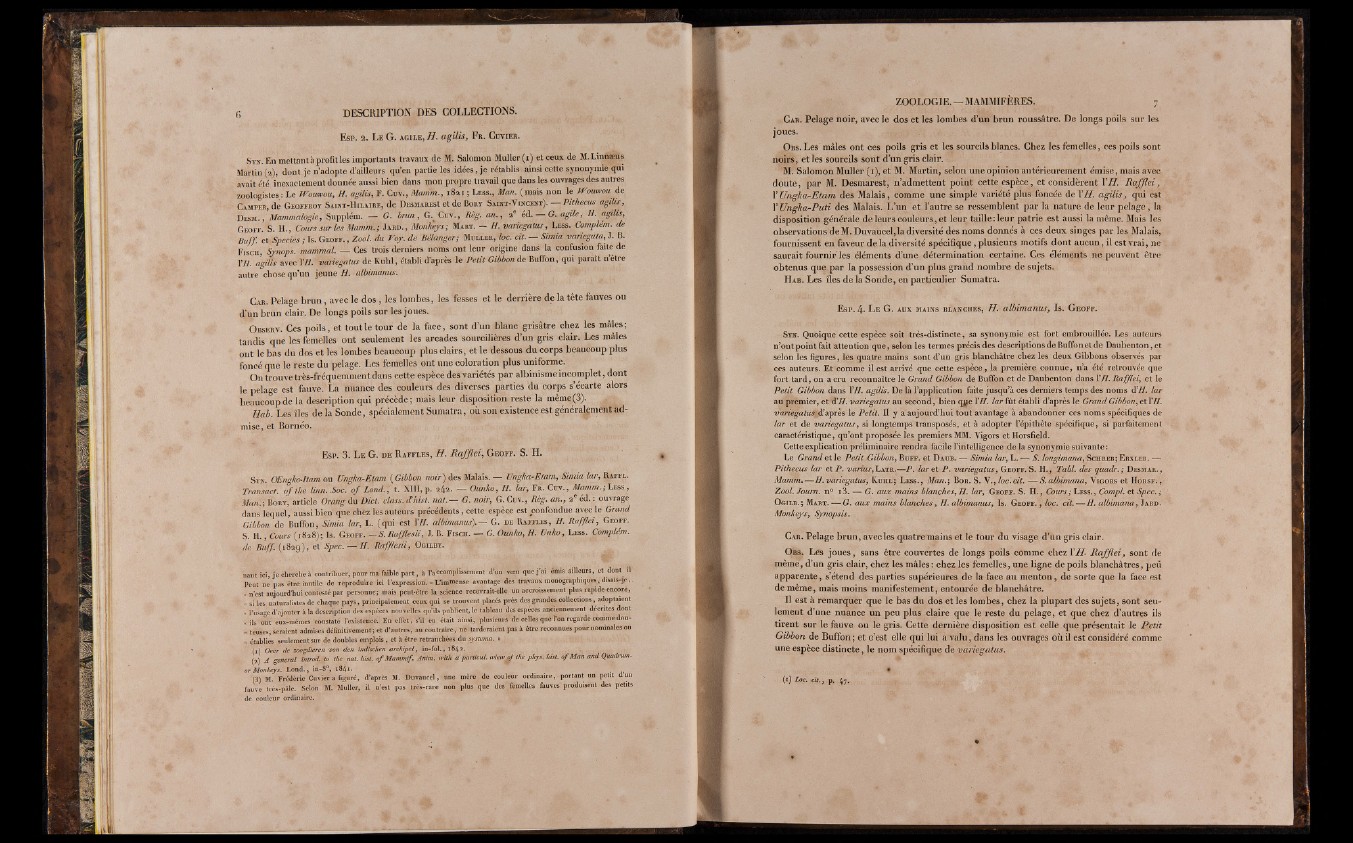
Esp. 2. L e G. a g ile , H. agilis, F r. Cuvier.
S y h . E n mettant à profit les importants travaux de M. Salomon Muller ( i ) et ceux de M.Uunæus
Martin (a), dont je n’adopte d’ailleurs qu’en partie les idées, je rétablis ainsi cette synonymie qui
avait été inexactement donnée aussi bien dans mon propre travail que dans les ouvrages des autres
zoologistes : Le K'ouwou, H. agilis, F. Ctiv., Mamm., 1821 ; L e s s ., Man. (mais non le Wowxou de
C am p e s , de G e o e f s o v S a i h t -H i l a i r e , de DesMARESt et de Bosv S a ih t - V i s c e k t ) . — Pithecus agilis,
D e sm . , Mammalogie, Supplém. — G. brun, G.^Cuv., Bèg. an., 2e éd.; G. agile, H. agilis,
G e o f f . S . H . , Cours sur les Mamm,; J a r d . , Monkeys; M a e t . — H . variegatus, I.tss. Complém. de
Buff. et.Species ; Is. G e o f f . , Zool. du Foy. de Bélanger; M u l l e r , loc. cit. — Simia variegata, J. B.
F i s c h , Srnops. mammal. — Ces trois derniers noms ont leur origine dans la confusion faite de
17/. àgilts avec 17/. variegatus de Kuhl, établi d’après le Petit Gibbon de Buffon, qui parait n’être
autre cliose qu’un jeune H. albimanus.
Car. Pelage brun, avec le dos, les lombes, les fesses et le derrière de la tête fauves ou
d’un brun clair. De longs poils sur les joues.
O b s e r v . Ces poils, et tout le tour de la face, sont d’un blanc grisâtre chez les mâles;
tandis que les femelles ont seulement les arcades sourcilières d’un gris clair. Les mâles
ont le bas du dos et les lombes beaucoup plus clairs, et le dessous du corps beaucoup plus
foncé que le reste du pelage. Les femelles ont une coloration plus uniforme.
On trouve très-fréquemment dans cette espèce des variétés par albinisme incomplet, dont
le pelage est fauve. La nuance des couleurs des diverses parties du corps s’écarte alors
beaucoup de la description qui précède ; mais leur disposition reste la inêmc.(3). ,
Hab. Les îles de la Sonde, spécialement Sumatra, où son existence est générakmént admise,
et Bornéo. ,
Esp. 3 . L e G. de R a f f le s , H . Rafflei, G e o ff. S. H.
Syk. OEngko-ltam ou Ungka-Ktam, ( Gibbon notr) des Malais.— Ungka-Elam, Simia lar, Raffl.
Transact. o f the linn. .Soc. o f Lond., t. XIII, p. a ia ife - Ounko, H. lar, Fr. C u v . , Mamm. ; Less ,
\lnn.\ Bory, article Orting du Dict. classédhisl. m t.— G. noir, G. Cuv., Règ. an., 2e éd. : ouvrage
dans lequel, aussi bien que chez les auteurs précédents, cette espèce est confondue avec le Grand
i Gibbon de Buffon, Simia lar, L. (qui est 17/. albimanus).— G. m Raffles, H. Rafflei, Geoff.
S. H., Cours (1828); Is. Geoff. — S.Rafflesü, J. B. Fisch. — G. Ounko, H. Onko, Less, Complém.
d e Buff (1829), et Spéc. — H. Rafflesii, Ogilbt.
naut icij je cherche à contribuer, pour ma faible p a r t, à l’a«°mplisse™nt d’un voeù que j ’ai émis ailleurs,'et dont it
Peut ne pas être inutile de reproduire ici l ’expression. g L’immense avantage des travaux monographiques, disais-je,.
I n’est aujourd’hui contesté par personne; mais peut-être la science recevrait-elle un accroissement plus rapide encore,
« si les naturalistes de chaque pa ys , principalement ceux qui se trouvent placés près des grandes collections, adoptaient
]>usagç d’ajouter à la description des espèces nouvelles qq’ ils publient, le tableau des espèces anciennement décrites dont
H i eux-mêmes constaté l’existence:; En effet , ‘s’il en était ainsi, plusieurs de celles queTrni regarde comme dnu-
« teuses, seraient admises déinitivement; et d’autres, au contraire , no tarderaient pas à être reconnues pour nominales où
« établies seulement sur de doubles emplois , et à être retranchées du systema. » . ■
(1) Over de zoôgdieren von den indischen archipel, in -fo l., 1842.
j général introd. to the nat. hist. ofMammif. Anim. with a pàrticul. wiewgj the phys. hist. o f Man and Quadrum.
orMonkeys. L o n d ., in-8°, 1841. !
(3) M. Frédéric Cuvier a figuré, d’après M. Duvâucel , une mè re , de couleur ordinaire, - portant un petit a un
fauve très-pâle. Selon M.' Muller, il n’est pas très-rare non plus que des femelles fauves produisent des petits
de couleur ordinaire.
C ar. Pelage noir, avec le dos et les lombes d’un brun roussâtre. De longs poils sur les
joues.
OBs.Les mâles ont ces poils gris et les sourcils blancs. Chez les femelles, ces poils sont
noirs, et les sourcils sont d’un gris clair.
M. Salomon Muller (1), et M. Martin, selon une opinion antérieurement émise, mais avec
doute, par M. Desmarest, n’admettent point cette espèce, et considèrent Y H. Rafflei,
l’Ungka-Etam des Malais, comme une simple variété plus foncée de Y H. agilis, qui est
YUngka-Puti des Malais. L’un et l’autre se ressemblent par la nature de leur pelage, la
disposition générale de leurs couleurs, et leur taille: leur patrie est aussi la même. Mais les
observations de M. Duvaucel,la diversité des noms donnés à ces deux singes par les Malais,
fournissent en faveur de la diversité spécifique, plusieurs motifs dont aucun, il est vrai, ne
saurait fournir’les éléments d’une détermination certaine. Ces éléments ne peuvent être
obtenus que par la possession d’un plus grand nombre de sujets.
Hab. Les îles de la Sonde, en particulier Sumatra.
E sp. 4- Le G. aux mains blanches, H. albimanus, Is. G eoff.
Syn. Quoique cette espèce soit très-distincte, sa synonymie est fort embrouillée. Les auteurs
n’ont point fait attention que, selon les termes précis des descriptions de Buffon et de Daubenton,et
selon les figures, les quatre mains sont d’un gris blanchâtre chez les deux Gibbons observés par
ces auteurs. Et comme il est arrivé que cette espèce , la première connue, n’a été retrouvée que
fort tard, on a cru reconnaître le Grand Gibbon de Buffon et de Daubenton dans Y H. Rafflei, et le
Petit Gibbon dans Y H. agilis. De là l’application faite jusqu’à ces derniers temps des noms (Y H. lar
au premier, et dì H. variegatus au second, bien que Y H. lar fût établi d’après le Grand Gibbon, et Y H.
variegatu^di le Petit. Il y a aujourd’hui tout avantage à abandonner ces noms spécifiques de
lar et de variegatus, si longtemps transposés, et à adopter l’épithète spécifique, si parfaitement
caractéristique, qu’ont proposée les premiers MM. Vigors et Horsfield.
Cette explication préliminaire rendra facile l’intelligence de la synonymie suivante :
Le Grand et le Petit Gibbon, B u f f . et D a u b . — Simia lar, L. — S. longimana, S ch r e b ; E h x le b . —
Pithecus lar et P. varius, L a t r .—P. lar et P. variegatus, G e o f f . S. H., Tabi, des quadr.; D e sm a r . ,
Mamm.—H.variegatus, K u h l ; L e s s . , Man.', B o r . S. V.,loc.cit. — S.albimana, V ig o r s et H o r s f . ,
Zool. Journ. n° i3. — G. aux mains blanches, H. lar, G e o f f . S. H., Cours; L e s s . , Compì, et Spec.;
O g il b . ; Ma r t . — G. aux mains blanches, H. albimanus, Is. G e o f f . , loc. cit. — H. albimana, Ja r d .
Monkeys, Synopsis.
Car. Pelage brun, avec les quatre mains et le tou? du visage d’un gris clair.
Obs. Les joues, sans être couvertes de longs poils comme chez Y H- Rafflei, sont de
même, d’un gris clair, chez les mâles : chez les femelles, une ligne de poils blanchâtres, peu
apparente, s’étend des parties supérieures de la face au menton, de sorte que la face est
de même, mais moins manifestement, entourée de blanchâtre.
Il est à remarquer que le bas du dos et les lombes, chez la plupart des sujets, sont seulement
d’une nuance un peu plus claire que le reste du pelage, et que chez d’autres ils
tirent sur le fauve ou le gris. Cette dernière disposition est celle que présentait le Petit
Gibbon de Buffon; et c’est elle qui lui a valu, dans les ouvrages où il est considéré comme
une espèce distincte, le nom spécifique de variegatus.
(1) lac. cit., p. 47.