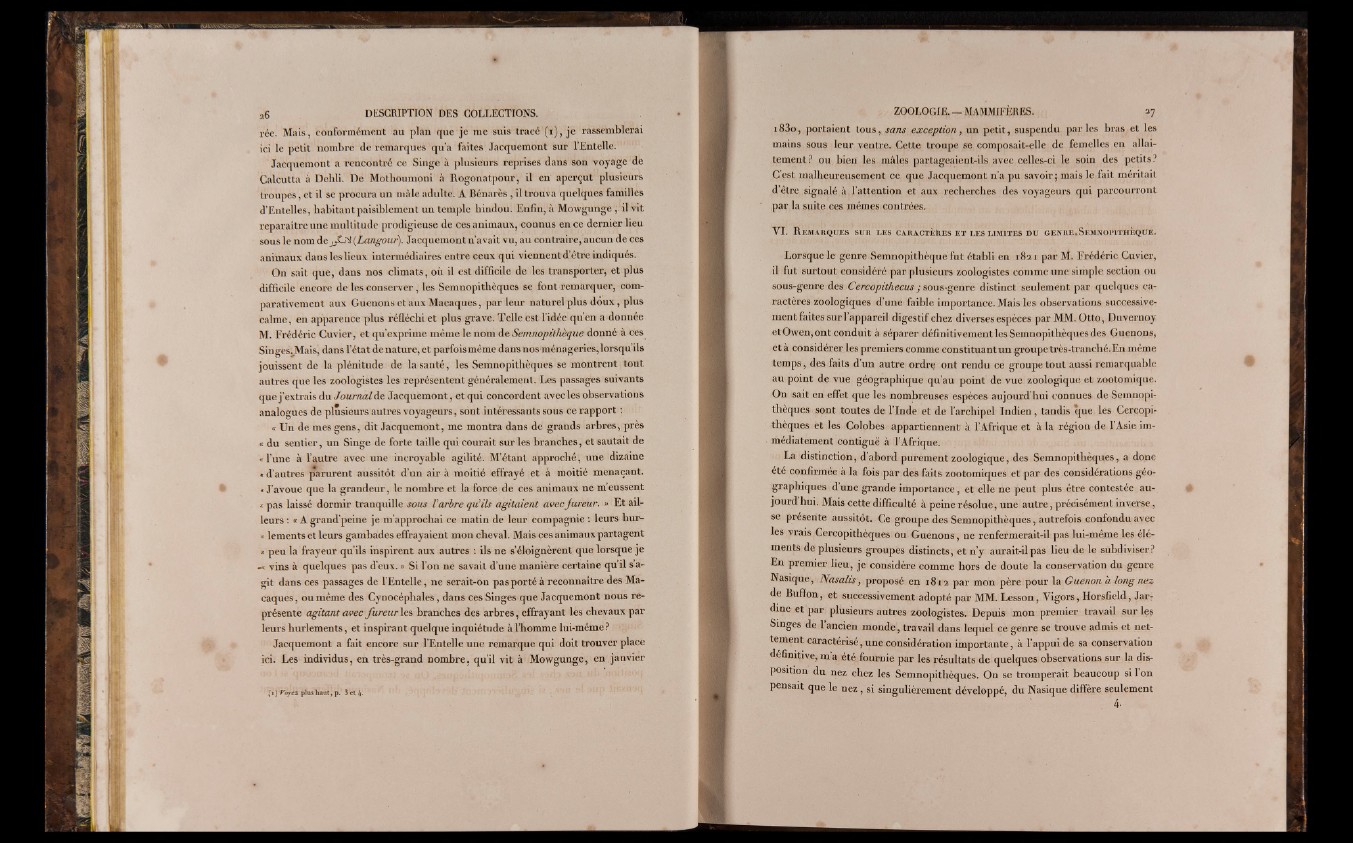
rée. Mais, conformément au plan que je me suis tracé ( i ) , je rassemblerai
ici le petit nombre de remarques qu'a faites Jacquemont sur l’Entelle.
Jacquemont a rencontré ce Singe à plusieurs reprises dans son voyage de
Calcutta à Dehli. De Mothoumoni à Rogonatpour, il en aperçut plusieurs
troupes, et il se procura un mâle adulte. A Bénarès , il trouva quelques familles
d’Entelles, habitant paisiblement un temple hindou. Enfin, à Mowgunge ,. il vit
reparaître; une multitude prodigieuse de ces animaux, connus en ce dernier lieu
sous le nom de jfsû (Langour). Jacquemont n’avait vu, au contraire, aucun de ces
animaux dans les lieux intermédiaires entre ceux qui viennent d être indiqués.
On sait que, dans nos climats, où il est difficile de les transporter, et plus
difficile encore de les conserver, les Semnopithèques se font remarquer, comparativement
aux Guenons et aux Macaques, parleur naturel plus doux, plus
calme, en apparence plus réfléchi et plus grave. Telle est l’idée qu’en a donnée
M. Frédéric Cuvier, et qu’exprime même le nom de Semnopithèque donné à ces
SingeSjMais, dans l’état de nature, et parfoismême dans nos ménageries, lorsqu’ils
jouissent de la plénitude de la santé, les Semnopithèques se montrent tout
autres que les zoologistes les représentent généralement. Les passages suivants
que j’extrais du Journal de Jacquemont, et qui concordent avec les observations
analogues de plusieurs autres voyageurs, sont intéressants sous ce rapport :
« Un de mes gens, dit Jacquemont, me montra dans de grands arbres, près
« du sentier, un Singe de forte taille qui courait sur les branches, et sautait de
V l’une à l’autre avec une incroyable agilité. M’étant approché, une dizaine
« d’autres parurent aussitôt d’un air à moitié effrayé et à moitié menaçant.
«J’avoue que la grandeur, le nombre et la force de ces animaux ne m’eussent
« pas laissé dormir tranquille sous l’arbre qu’ils agitaient avec fureur. » Et ailleurs
: « A grand’peine je m’approchai ce matin de leur compagnie : leurs hur-
« lements et leurs gambades effrayaient mon cheval. Mais ces animaux partagent
« peu la frayeur qu’ils inspirent aux autres : ils ne s’éloignèrent que lorsque je
vins à quelques pas d’eux. » Si l’on ne savait d’une manière certaine qu’il s a-
git dans ces passages de l’Entelle, ne serait-on pas porté à reconnaître des Macaques,
ou même des Cynocéphales, dans ces Singes que Jacquemont nous représente
agitant avec fureur les branches des arbres, effrayant les chevaux par
leurs hurlements, et inspirant quelque inquiétude à l’homme lui-même ? ■ ;
Jacquemont a fait encore sur l’Entelle une remarque qui doit trouver place
ici. Les individus, en très-grand nombre, qu’il vit à Mowgunge, en janvier
f i) Voyez plus haut, p. 3 et l\.
183o , portaient tous, sans exception, un petit, suspendu par les bras et les
mains sous leur ventre. Cette troupe se composait-elle de femelles en allaitement?
ou bien les mâles partageaient-ils avec celles-ci le soin des petits?
C’est malheureusement ce que Jacquemont n’a pu savoir; mais le fait méritait
d’être signalé à. l’attention et aux recherches des voyageurs qui parcourront
par la suite ces mêmes contrées.
VI. R e m a r q u e s s u r l e s c a r a c t è Ii e s e t l e s l i m i t e s d u g e n r e . S e m n o i t t h è q u e .
Lorsque le genre Semnopithèque fut établi en 1821 par M. Frédéric Cuvier,
il fut surtout considéré par plusieurs zoologistes comme une simple section ou
sous-genre des Cercopithecus ; sous-genre distinct seulement par quelques caractères
zoologiques d’une faible importance. Mais les observations successivement
faites sur l’appareil digestif chez diverses espèces par MM. Otto, Duvernoy
etOwen,ont conduit à séparer définitivement les Semnopithèques des Guenons,
et à considérer les premiers comme constituant un groupe très-tranché.En même
temps, des faits d’un autre ordre ont rendu ce groupe tout aussi remarquable
au point de vue géographique qu’au point de vue zoologique et zootomique.
On sait en effet que les nombreuses espèces aujourd’hui connues de Semnopithèques
sont toutes de l’Inde et de l’archipel Indien, tandis que les Cercopithèques
et les Colobes appartiennent à l’Afrique et à la région de l'Asie immédiatement
contiguë à FAfrique.
La distinction, d’abord purement zoologique, des Semnopithèques, a donc
été confirmée à la fois par des faits zootomiques et par des considérations géographiques
d’une grande importance, et elle ne peut plus être contestée aujourd’hui.
Mais cette difficulté à peine résolue, une autre, précisément inverse,
se présente aussitôt. Ce groupe des Semnopithèques, autrefois confondu avec
les vrais Cercopithèques ou Guenons, ne renfermerait-il pas lui-même les éléments
de plusieurs groupes distincts, et n’y aurait-il pas lieu de le subdiviser?
En premier lieu, je considère comme hors de doute la conservation du genre
Nasique, Nasalis, proposé en 1812 par mon père pour la Guenon à long nez
de Buffon, et successivement adopté par MM. Lesson, Vigors, Horsfield, JarT
dine et par plusieurs autres zoologistes. Depuis mon premier travail sur les
Singes de l’ancien monde, travail dans lequel ce genre se trouve admis et nettement
caractérisé, une considération importante, à l’appui de sa conservation
définitive, m a été fournie par les résultats de quelques observations sur la disposition
du nez chez les Semnopithèques. On se tromperait beaucoup si l’on
pensait que le nez , si singulièrement développé, du Nasique diffère seulement
4-