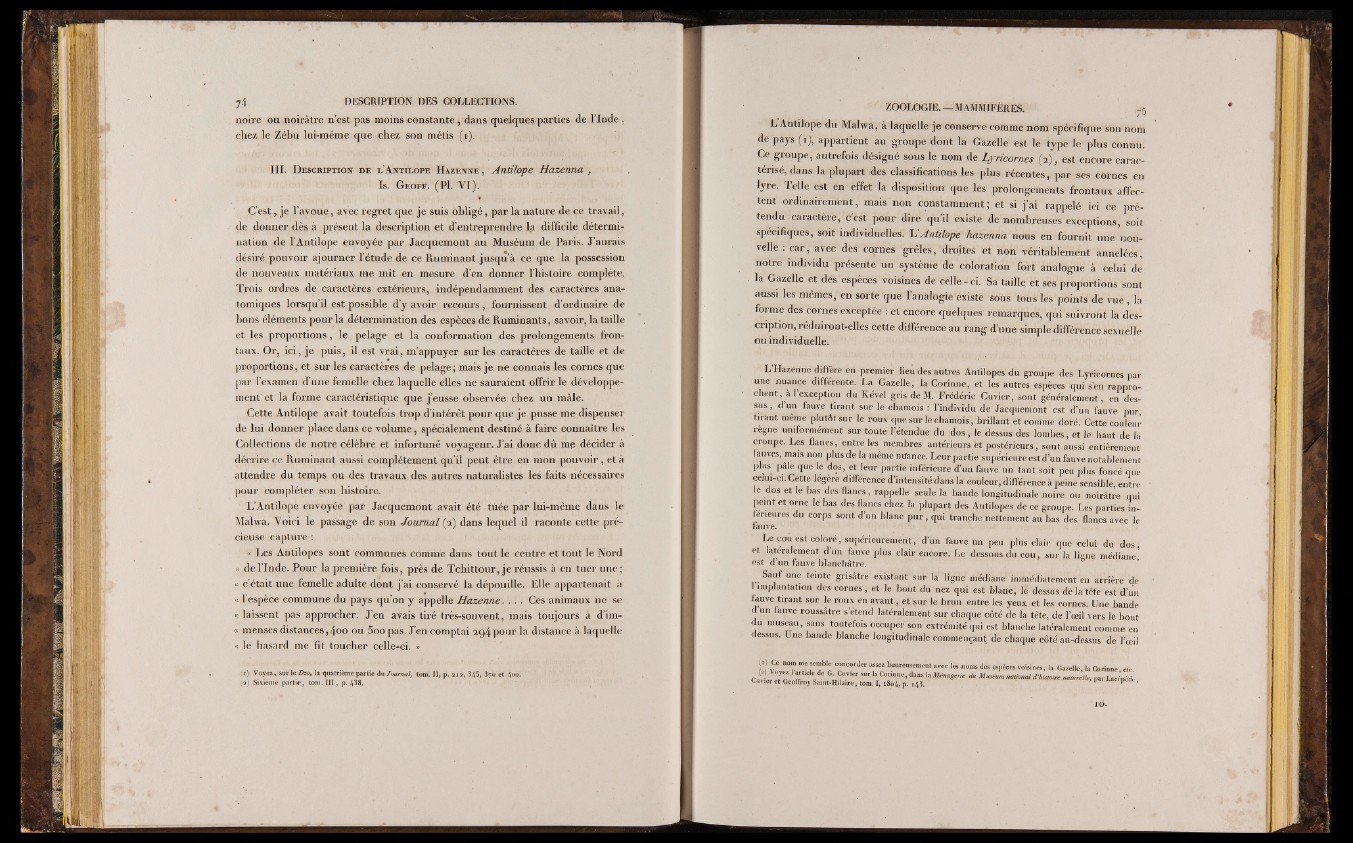
noire ou noirâtre n’est pas moins constante , dans quelques parties de l’Inde ,
chez le Zébu lui-même que chez son métis (i).
III. D e s c r i p t i o n d e l ’A n t i l o p e H a z e n n e , Antilope Hazenna ,
Is. G e o f f . (P1. VI).
C’est, je l’avoue, avec regret que je suis obligé, par la nature de ce travail,
de donner dès à présent la description et cPentreprendre la difficile détermination
de l’Antilope envoyée par Jacquemont au Muséum de Paris. J’aurais
désiré pouvoir ajourner l’étude de ce Ruminant jusqu’à ce que la possession
de nouveaux matériaux me mit en mesure d’en donner l’histoire complète.
Trois ordres de caractères extérieurs, indépendamment des caractères anatomiques
lorsqu’il est possible d’y avoir recours, fournissent d’ordinaire de
bons éléments pour la détermination des espèces de Ruminants, savoir, la taille
et les proportions, le pelage et la conformation des prolongements frontaux.
Or, ici, je puis, il est vrai, m’appuyer sur les caractères de taille et de
proportions, et sur les caractères de pelage ; mais je ne connais les cornes que
par l’examen d’une femelle chez laquelle elles ne sauraient offrir le développe-
ment'et la forme caractéristique que j’eusse observée chez un mâle.
Cette Antilope avait toutefois trop d’intérêt pour que je pusse me dispenser
de lui donner place dans ce volume, spécialement destiné à faire connaître les
Collections de notre célèbre, et infortuné voyageur. J’ai donc dû me décider à
décrirë ce Ruminant aussi complètement qu’il peut être en mon pouvoir, et à
attendre du temps ou des travaux des autres naturalistes les faits nécessaires
pour compléter son histoire.
L’Antilope envoyée par Jacquemont avait été tuée par lui-même dans le
Malwa. Voici le passage de son Journal (2) dans lequel il raconte cette précieuse
capture :
« Les Antilopes sont communes comme dans tout le centre et tout le Nord
<x{,del’Inde. Pour la première fois, près de Tchittour, je réussis à en tuer une;
« c’était une femelle adulte dont j ’ai conservé la dépouille. Elle appartenait à
« l’espèce commune du pays qu’on y appelle Hazenne. . . . Ces animaux ne se
« laissent pas approcher. J’en avais tiré très-souvent, mais toujours à d’im-
« menses distances, 400 ou 5oo pas. J’en comptai 294 pour la distance à laquelle
« le hasard me fit toucher celle-ci. »
(1) V o y e z , sur le Dzo, la quatrième partie du Journal, tom. I l, p. 212, 345, 370 et .400.
(2) Sixième partie, tom. I I I , p. 438.
L Antilope du Malwa, à laquelle je conserve comme nom spécifique son nom
de pays (r), appartient au groupe dont la Gazelle est le type le plus connu.
Ce groupe, autrefois désigné sous le nom de Lyricornes (a), est encore caractérisé,
dans la plupart des classifications les plus récentes, par ses cornes en
lyre. Telle est en effet la disposition que les prolongements frontaux affectent
ordinairement, mais non constamment; et si j ’ai rappelé ici ce prétendu
caractère, c est pour dire quil existe de nombreuses exceptions, soit
spécifiques, soit individuelles. L'Antilope hazenna nous en fournit une nouvelle
: Car', avec des cornes grêles, droites et non véritablement anneléés,
notre individu présente un système de coloration fort analogue à celui de
■ la Gazelle et dés espèces voisines de celle-ci. Sa taille et ses proportions sont
aussi les mêmes, en sorte que l’analogie existe sous tous les points de vue , la
forme des cornes exceptée : et encore quelques remarques, qui suivront la description,
réduiront-elles cette différence au rang d’une simple différence sexuelle
ou individuelle.
L’Hazenne diffère en premier lieu des autres Antilopes du groupe des Lyricornes par
une nuance différente. La Gazelle, la Corinne, et les autres espèces qui s’en rapprochent,
à 1 exception du Kével gris de M. Frédéric Cuvier, sont généralement, en des-
m t*un fauve tirant sur le chamois : l’individu de Jacquemont est d’un fauve pur
tirant même plutôt sur le roux que sur le chamois, brillant et comme doré. Cette couleur
règne uniformément sur toute le tendue du dos, le dessus des lombes, et le haut de fa
croupe. Les flancs, entre les membres antérieurs ht postérieurs, sont aussi entièrement
fauves, mais non plus de la même nifance. Leur partie supérieure est d’un fauve notablement
plus pale queie dos, et leur partie inférieure d’un fauve un tant soit peu plus foncé due
celui-ci. Cette légère différence d’intensité dans la couleur, différence à peine sensible entre
le dos et le bas des-flancs, rappelle seule la bandé longitudinale noire ou noirâtre qui
peint et orne lé bas des flancs chez la plupart des Antilopes de ce groupe. Les parties inférieures
du corps sont d’un blanc pur , qui tranche nettement au bas des flancs avec le
rauve.
Le cou est coloré, supérieurement, d’un fauve un peu plus clair que celui du dos
et latéralement dn n -fauve plus clair encore. Le dessous du cou, sur la ligne médiane'
est d’un fauve blanchâtre.
Sauf une teinte grisâtre existant sur la ligne médiane immédiatement en arrière de
1 implantation des cornes, et le bout du nez qui est blanc, le dessus de la tête est d’un
fauve tirant sur le roux en avant, et sur le brun entre les yeux et les cornes. Une bande
dun fauve roussâtre s’étend latéralement sur chaque côté de la tête, de l’oeil vers le bout
du museau, sans toutefois occuper «on extrémité qui est blanche latéralement comme en
dessus. Une bande blanche longitudinale commençant de chaque côté au-dessus de l’oeil
(.) Ce nom me semble, concorder asses Heureusement avec les noms îles espèces voisines, la Garelle, la Corinne ele
CnvièJefGeoffrôy Saint-Hilalr^^fom!l^'i^)4” p,. tia4X la^ Î,IÎ7^’^ ^ ,*ai,ona^ ^ ‘sto’n! naturelle, par Lacépèlli-,