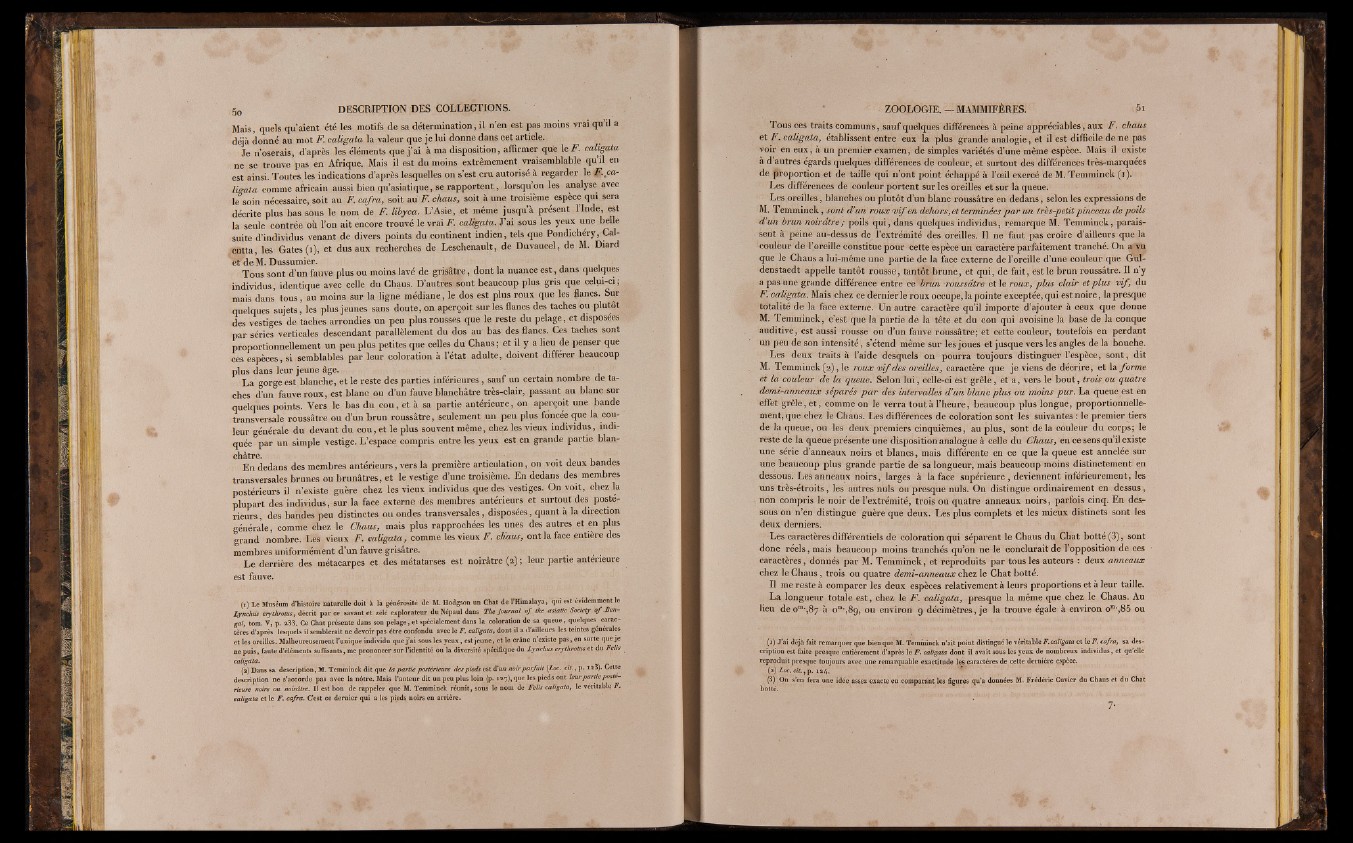
Mais, quels qu’aient été les motifs de sa détermination, il n’en est pas moins vrai quil a
déjà donné au mot F. caligata la valeur que je lui donne dans cet article.
Je n’oserais, d’après les éléments que j’ai à ma disposition, affirmer qu’e le F. caligata
ne se trouve pas en Afrique. Mais il est du moins extrêmement vraisemblable qu’il en
est ainsi. Toutes les indications d’après lesquelles on s’est cru autorisé à regarder le $ tçaligata
comme africain a u s s i bien qu’asiatique, se rapportent . lorsqu’on les analyse avec
le soin nécessaire, soit au F.cafra, soit au F.chaus, soit aune troisième espèce qui sera
décrite plus bas sous le nom de F. libyca. L’Asie, et même jusqu’à présent l’Inde, est
la seule contrée oit l'on ait encore trouvé le vrai i l caligata. J’ai sous les yeux une belle
suite d’individus venant de divers points du continent indien, tels que Pondichéry, Calcutta,
les Gates (i), et dus aux recherches de Leschenault, de Duvaucel, de M. Diard
èrde M. Dussumier.
Tous sont d’un fauve plus ou moins lavé de grisâtre, dont la nuance est, dans quelques
individus, identique avec celle du Chaus. D’autres sont beaucoup plus gris que celui-ci;
mais dans tous, au moins sur la ligne médiane, le dos est plus roux que les (lancs. Sur
quelques sujets, les plus jeunes sans doute, on aperçoit sur les flancs des taches ou plutôt
des vestiges de taches arrondies un peu plus rousses que le reste du pelage, et disposées
par séries verticales descendant parallèlement du dos au bas des flancs. Ces taches sont
proportionnellement un peu plus petites que celles du Chaus; et il y a heu de penser que
ces espèces, si semblables par leur coloration à l’état adulte, doivent différer beaucoup
plus dans leur jeune âge.
La gorge est blanche, et le reste des parties inférieures , sauf un certain nombre de taches
d’un fauve roux, est blanc ou d’un fauve blanchâtre très-clair, passant au blanc sur
quelques points. Vers le bas du cou, et à sa partie antérieure, on aperçoit une bande
transversale roussâtre ou d’un brun roussâtre, seulement tin peu plus foncée que la couleur
générale du devant du cou, et le plus souvent même, chez les vieux individus, indiquée
par un simple vestige. L’espace compris entre les yeux est en grande partie blanchâtre.
. .
En dedans des membres antérieurs, vers la première articulation, on voit deux bandes
transversales brunes ou brunâtres, et le vestige d’une troisième. En dedans des membres
postérieurs il n’existe guère chez les vieux individus que des vestiges. On voit, chez la
plupart des individus, sur la face externe des membres antérieurs et surtout des postérieurs,
des bandes peu distinctes ou ondes transversales, disposées, quant à la direction
générale, comme chez le Chaos, mais plus rapprochées les unes des autres et en plus
grand nombre. Les vieux F. caligata, comme les vieux F. cKaüs, ont la face entière des
membres uniformément d’un fauve grisâtre.
Le derrière des métacarpes et des métatarses est noirâtre (a) ; leur partie antérieure
est fauve.
(i) Le Muséum d'histoire naturelle doit à la générosité de M. Hodgson un Chat de l’Himalaya, qui est évidemment le
Lynchtis érythrotus, décrit par ce savant et zélé ezplorateur du Népaul dans The journal o f the asialic Society- o f .Ben-
gal, tom. V , p. »33. Ce Chat présente dans son pelage, et spécialement dans la coloration de sa queue, quelques caractères
d’après lesquels il semblerait ne devoir pas être confondu avec le F . caligata, dont il a d ailleurs les teintes générales
et les oreilles. Malheureusement l'unique individu que j ’ai sous les yeu x , est jeune, et le crâne n’existe pas, en sorte que je
ne puis, faute d’éléments suffisants, me prononcer sur l’identité ou la diversité spécifique du Lynches érythrotus et du Felis
caligata. , . ’
(à) Dans sa description, M. Temminck dit que la partie postérieure ries pieds est d'un noir parfait [Loc. cit., p. i» 3j. Cette
description ne s'accorde pas avec la nôtre. Mais l’auteur dit un peu plus loin (p. 107), que les pieds ont leur partie postérieure
noire ou noirâtre. II est bon de rappeler que M. Temminck réunit, sous le nom de Felis caligata, le véritable F.
caligata et le F . cafra. C’est ce dernier qui a les pieds noirs en arrière.
Tous ces traits communs, sauf quelques différences à peine appréciables, aux F ; chaus
et F. caligata, établissent entre eux la plus grande analogie, et il est difficile de ne pas
voir en eux, à un premier examen, de simples variétés d’une même espèce. Mais il existe
à d’autres égards quelques différences de couleur, et surtout des différences très-marquées
de proportion et de taille qui n’ont point échappé à l’oeil exercé de M. Temminck (i).
Les différences de couleur portent sur les oreilles et sur la queue.
Les oreilles, blanches ou plutôt d’un blanc roussâtre en dedans, selon les expressions de
M. Temminck, sont d’un roux vif en dehors,et terminées par un très-petit pinceau de poils
d’un brun noirâtre ; poils qui, dans quelques individus, remarque M. Temminck, paraissent
à peine au-dessus de l’extrémité des oreilles. Il ne faut pas croire d’ailleurs que la
couleur de l’oreille constitue pour cette espèce un caractère parfaitement tranché. On a vu
que le Chaus a lui-même une partie de la face externe de l’oreille d’une couleur que Gül-
denstaedt appelle tantôt rousse, tantôt brune, et qui, de fait, est le brun roussâtre. Il n’y
a pas une grande différence entre cebrun roussâtre et le roux, plus clair et plus vif, du
F caligata. Mais chez ce dernier le roux occupe, la pointe exceptée, qui est noire, la presque
totalité de la face externe. Un autre caractère qu’il importe d’ajouter à ceux que donne
M. Temminck, c’est que la partie de la tête et du cou qui avoisine la base de la conque
auditive, est aussi rousse ou d’un fauve roussâtre; et cette couleur, toutefois en perdant
un peu de son intensité, s’étend même sur les joues et jusque vers les angles de là bouche.
Lès deux traits à l’aide desquels on pourra toujours distinguer l’espèce, sont, dit
M. Temminck (a), le roux vif des oreilles, caractère que je viens de décrire, et la forme
et la couleur de la queue. Selon lui, cclle-ci est grêle, et a, vers le bout, trois ou quatre
demi-anneaux séparés par des intervalles d’un blanc plus ou moins pur. La queue est en
effet grêle, et, comme on le verra tout à l’heure, beaucoup plus longue, proportionnellement,
que chez le Chaus. Les différences de coloration sont les suivantes : le premier tiers
de la queue, ou les deux premiers cinquièmes, au plus, sont delà couleur du corps; le
reste de la queue présente une disposition analogue à celle du Chaus, en ce sens qu’il existe
une série d’anneaux noirs et blancs, mais différente en ce que la queue est annelée sur
une beaucoup plus grande partie de sa longueur, mais beaucoup moins distinctement en
dessous. Les anneaux noirs, larges à la face supérieure, deviennent inférieurement, les
uns très-étroits, les autres nuls ou presque nuls. On distingue ordinairement en dessus -,
non compris le noir de l’èXtrémité, trois ou quatre anneaux noirs, parfois cinq. En dessous
on n’en distingue guère que deux. Les plus complets et les mieux distincts sont les
deux derniers.
Les caractères différentiels de coloration qui séparent le Chaus du Chat botté (3), sont
donc réels, mais beaucoup moins tranchés qu’on ne le conclurait de l’opposition de ces
caractères, donnés par M. Temminck, et reproduits par tous les auteurs : deux anneaux
chez le Chaus, trois ou quatre demi-anneaux chez le Chat botté.
Il me reste à comparer les deux espèces relativement à leurs proportions et à leur taille.
La longueur totale est, chez le F. caligata, presque la même que chez le Chaus. Au
lieu deom,,87 ^ °m'^9> ou environ 9 décimètres, je la trouve égale à environ om,,85 ou
(1) J’ai déjà fait remarquer que bien que M. Temminck n’ait point distingué le véritable F.caligata et le / 7, cafra, sa description
est faite presque entièrement d’après le F . caligata dont il avait sous lès yeux de nombreux individus, et qu’elle
reproduit presque toujours avec une remarquable exactitude les caractères de cette dernière espèce.
' (à) Loc. cit. , p. ia4.
(3) On s’en fera une idée, assez exacte en comparant les figures qu’a données M. Frédéric Cuvier du Chaus et du Chat
botté.