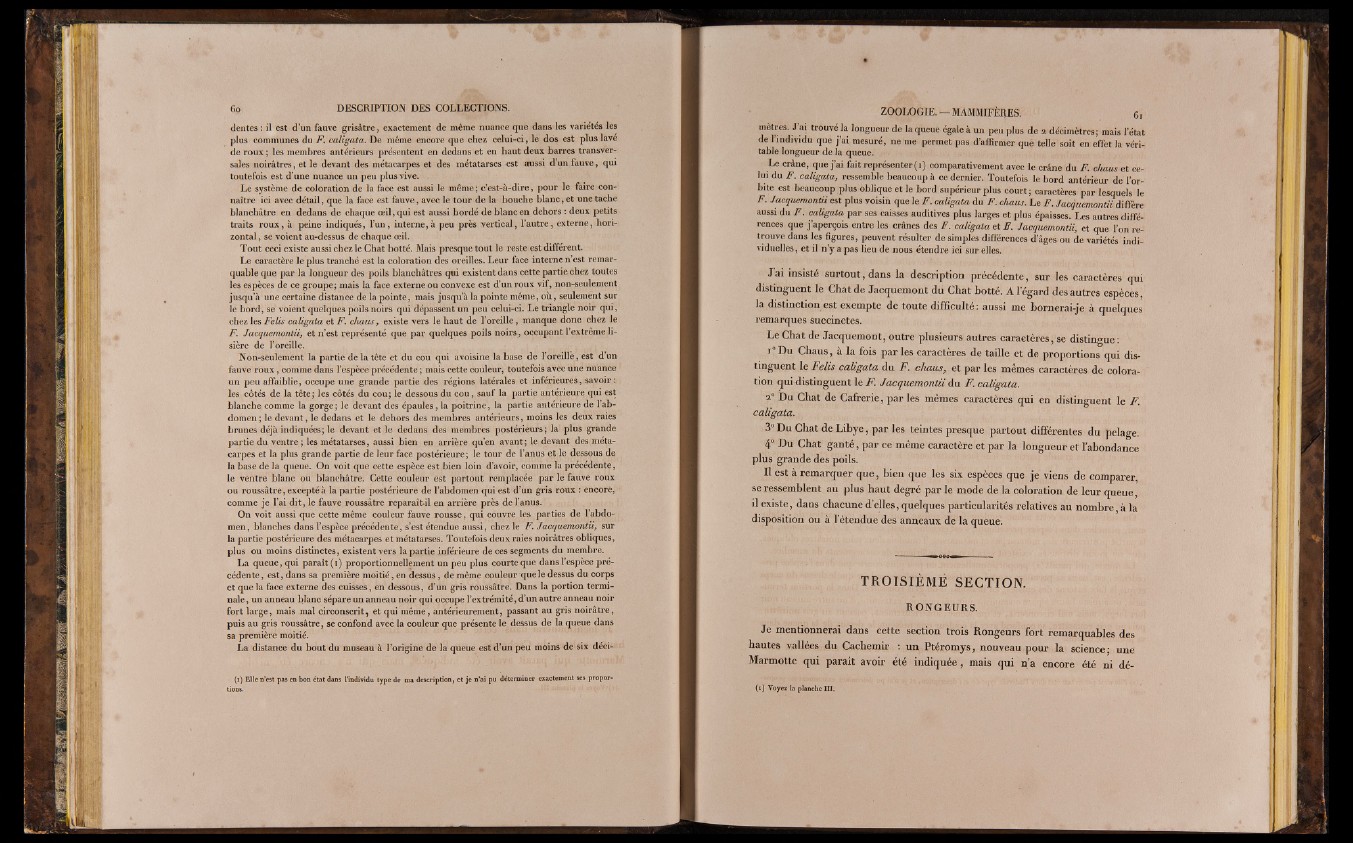
dentes : il est d’un fauve grisâtre, exactement de même nuance que dans les variétés les
plus communes du F. caligata. De même encore que chez celui-ci, le dos est plus lave
de roux ; les membres antérieurs présentent en dedans et en haut deux barres transversales
noirâtres, et le devant des métacarpes et des métatarses est aussi d’un fauve, qui
toutefois est d’une nuance un peu plus vive. ,
Le système de coloration de la face est aussi le même; c’est-à-dire, pour le faire connaître
ici avec détail, que la face est fauve, avec le tour de la bouche blanc, et une tache
blanchâtre en dedans de chaque oeil, qui est aussi bordé de blanc en dehors : deux petits
traits roux, à peine indiqués, l’un, interne,à peu près vertical, l’autre, externe, horizontal
, se voient au-dessus de chaque oeil.
Tout ceci existe aussi chez le Chat botté. Mais presque tout le reste est différent.
Le caractère le plus tranché est la coloration des oreilles. Leur face interne n’est remarquable
que par la longueur des poils blanchâtres qui existent dans cette partie chez toutes
les espèces de ce groupe; mais la face externe ou convexe est d’un roux vif, non-seulement
jusqu’à une certaine distance de la pointe, mais jusqu’à la pointe même, où, seulement sur
le bord, se voient quelques poils noirs qui dépassent un peu celui-ci. Le triangle noir qui,
chez les Felis caligata et F. chaus, existe vers le haut de l’oreille, manque donc chez le
F. Jacquemontii, et n’est représenté que par quelques poils noirs, occupant l’extrême lisière
de l’oreille.
Non-seulement la partie de la tête et du cou qui avoisine la base de l'oreille, est d’un
fauve roux, comme dans l’espèce précédente ; mais cette couleur, toutefois avec une nuance
un peu affaiblie, occupe une grande partie des régions latérales et inférieures, savoir:
les côtés de la tête; les côtés du cou; le dessous du cou, sauf la partie antérieure qui est
blanche comme la gorge; le devant des épaules, la poitrine, la partie antérieuré de l’abdomen;
le devant, le dedans et le dehors des membres antérieurs, moins les deux raies
brunes déjà indiquées; le devant et le dedans des membres postérieurs; la plus grande
partie du ventre; les métatarses, aussi bien en arrière qu’en avant; le devant des métacarpes
et la plus grande partie de leur face postérieure; le tour de l’anus et le dessous de
la base de la queue. On voit que cette espèce est bien loin d’avoir, comme la précédente,
le ventre blanc ou blanchâtre. Cette couleur est partout remplacée par le fauve roux
ou roussâtre, excepté à la partie postérieure de l’abdomen qui est d’un gris roux : encore,
comme je l’ai dit, le fauve roussâtre reparaît-il en arrière près de l’anus.
On voit aussi que cette même couleur fauve rousse, qui couvre les parties de l’abdomen,
blanches dans l’espèce précédente, s’est étendue aussi, chez le F. Jacquemontu, sur
la partie postérieure des métacarpes et métatarses. Toutefois deux raies noirâtres obliques,
plus ou moins distinctes, existent vers la partie inférieure de ces segments du membre.
La queue, qui paraît (i) proportionnellement un peu plus courte que dans l’espèce précédente,
est, dans sa première moitié, en dessus, de même couleur que le dessus du corps
et que la face externe des cuisses, en dessous, d’un gris roussâtre. Dans la portion terminale
, un anneau blanc sépare un anneau noir qui occupe l’extrémité, d’un autre anneau noir
fort large, mais mal circonscrit, et qui même, antérieurement, passant au gris noirâtre,
puis au gris roussâtre, se confond avec la couleur que présente le dessus de la queue dans
sa première moitié.
La distance du bout du museau à l’origine de la queue est d’un peu moins de six déci(
i) Elle n’est pas en bon état dans l’individu type de ma description, et je n’ai pu déterminer exactement ses propormètres.
J ai trouvé la longueur de la queue égale à un peu plus de 2 décimètres ; mais l’état
de l’mdividu que j’ai mesuré, ne me permet pas d’affirmer què telle soit en effet la véritable
longueur de la queue.
Le crâne, que j’ai fait représenter (1) comparativement avec le crâne du F. chaus et celui
du F . caligata, ressemble beaucoup à ce dernier. Toutefois le bord antérieur de l’orbite
est beaucoup plus oblique et le bord supérieur plus court ; caractères par lesquels le
F. Jacquemontii est plus voisin que le F. caligata du F. chaus. Le F. Jacquemontii diffère
aussi du F . caligala par ses caisses auditives plus larges et plus épaisses. Les autres différences
que j’aperçois entre les crânes des F. caligata et F. Jacquemontii, et que l’on retrouve
dans les figures, peuvent résulter de simples différences d’âges ou de variétés individuelles,
et il n’y a pas lieu de nous étendre ici sur elles.
J a i insisté surtout, dans la description précédente, sur les caractères qui
distinguent le Chat de Jacquemont du Chat botté. A l’égard des autres espèces,
la distinction est exempte de toute difficulté: aussi me bornerai-je à quelques
remarques succinctes.
Le Chat de Jacquemont, outre plusieurs autres caractères, se distingue :
i°Du Chaus, à la fois parles caractères de taille et de proportions qui distinguent
le Felis caligata du F. chaus, et par les mêmes caractères de coloration
qui distinguent le F. Jacquemontii du F. caligata.
2° Du Chat de Cafrerie, par les mêmes caractères qui en distinguent le F.
caligata.
3° Du Chat de Libye, par les teintes presque partout différentes du pelage.
4° Du Chat ganté, par Ce même caractère et par la longueur et l’abondance
plus grande des poils.
Il est à remarquer que, bien que les six espèces que je viens de comparer,
se ressemblent au plus haut degré par le mode de la coloration de leur queue,
il existe, dans chacune d’elles, quelques particularités relatives au nombre, à la
disposition ou à l’étendue des anneaux de la queue.
T R O I S IÈ M E S E C T IO N .
RONGEURS.
Je mentionnerai dans cette section trois Rongeurs fort remarquables des
hautes vallées du Cachemir : un Ptéromys, nouveau pour la science; une
Marmotte qui paraît avoir été indiquée, mais qui n’a encore été ni dé-
(1) Voyez la planche III.