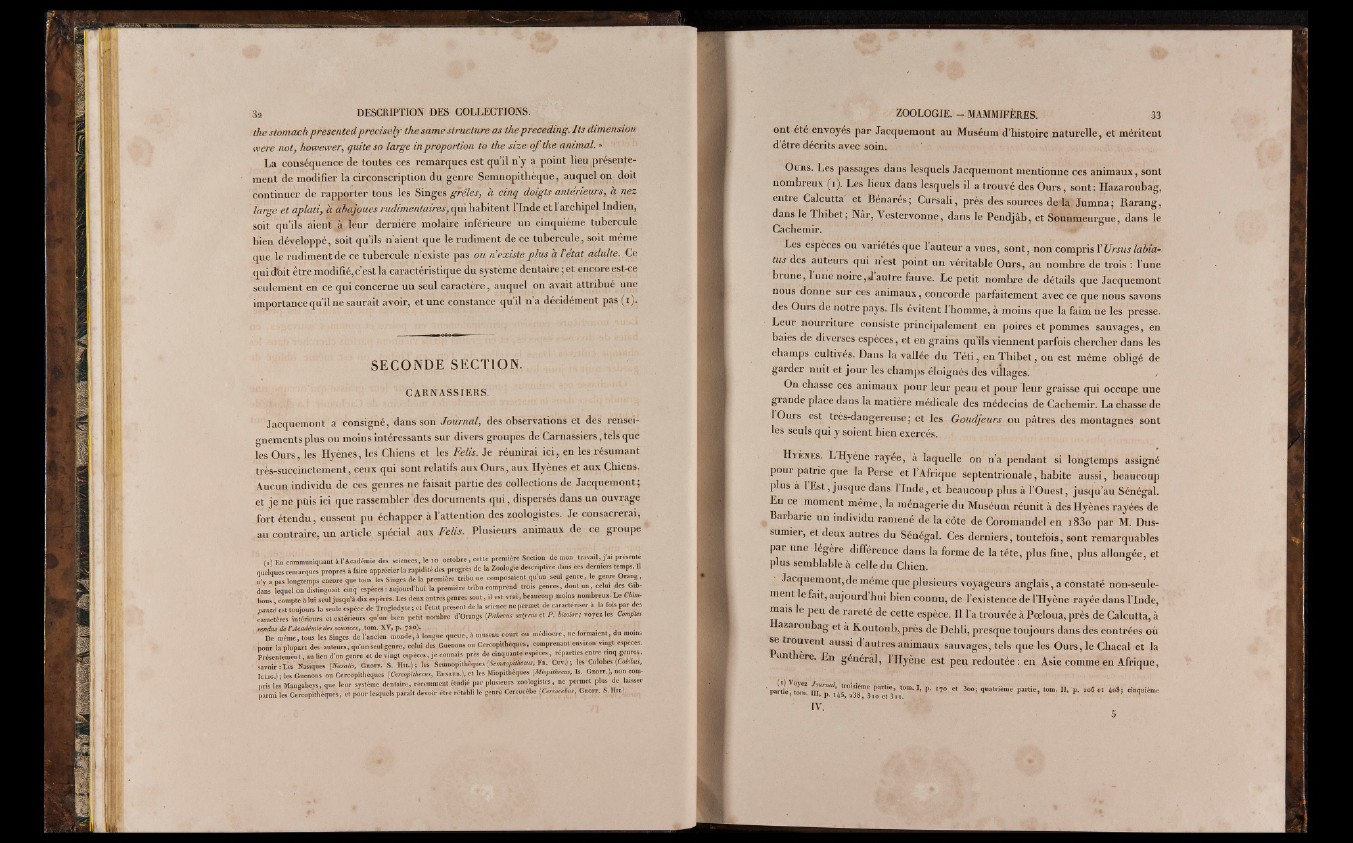
the stomach presented precisely the same structure as the preceding. Its dimension
were not, howewer, quite so large in proportion to the size o f the animal. »
La conséquence de toutes ces remarques est qu’il n’y a point lieu présentement
de modifier la circonscription du genre Semnopithèque, auquel on doit
continuer de rapporter tous les Singes grêles, à cinq doigts antérieurs, à nez
large et aplati, a ahajçues rudimentaires, qui habitent l’Inde etl’archipel Indien,
soit qu’ils aient à leur dernière molaire inférieure un cinquième tubercule
bien développé, soit qu'ils n’aient que le rudiment de ce tubercule, soit même
que le rudiment de ce tubercule n’existe pas ou n’existe plus a l’état adulte. Ce
quidbit être modifié, c’est la caractéristique du système dentaire; et encore est-çe
seulement en ce qui concerne un seul caractère, auquel on avait attribué une
importance qu’il ne saurait avoir, et une constance qu’il n’a décidément pas (i).
S E C O N D E S E C T IO N .
CARNASSIERS.
Jacquemont a consigné, dans son Journal, des observations et des renseignements
plus o u moins intéressants sur divers groupes de Carnassiers, tels qué
les Ours, les Hyènes, les Chiens et les Felis. Je réunirai ici, en les résumant
très-succinctement, ceux qui sont relatifs aux Ours, aux Hyènes et aux Chiens.
Aucun individu de ces genres ne faisait partie des collections de Jacquemont;
et je ne puis ici que rassembler des documents qui, dispersés dans un ouvrage
fort étendu, eussent pu échapper à l’attention des zoologistes. Je consacrerai,
au contraire, un article spécial aux Felis. Plusieurs animaux de ce groupe
i , ' En communiquant à l’Académie des sciences, le o c o b r e I c e t te première Section de mon travail, j'ai présenté
quelques remarques propres à faire apprécier la rapidité des progrès de la Zoologie descriptive dans ces demie» temps. Il
n’y a pas longtemps encore que tons. les Singés de la première tribu ne composaient qn un seul genre, le genre Orang
dans lequel on distinguait cinq espèces : aujourd’hui la première tribu comprend trois genres, dont un celui d e s g ib bons
compte à lui seul jusqu’à dix espèces. Les deux autres genres sont, il est vrai,beaucoup moins nombreux. Le C4.ni-
paneé est toujoum la seule espèce de Troglodyte; et l’état présent delà science ne permet de caractériser à la fois par des
caractères intérieurs et extérieurs qu'un bien petit nombre d’Orangs (PMecu, mtrrus et P : Ucolor; voyez les Compte,
rendus de l’Académie des sciences, tom. XV, p. 720). . a ' , • . V
De même, tous («Singes, de l’ancien monde, à longue queue, à museau court ou mediocre, ne formaient, du n o u s
pour la plupart des auteurs, qu’onèeulgenre, celui des.Guenons ou Cercopithèques, comprenant environ vingt espèc«.
Présentement, au lien d'un genre et de vingt espèces, je connais près de cinquante especes, reparties entre cmq genres,
savoir ■ Les Nasiquès (Nasalis, G zo ff. S. H i l.); les Semnopithèques (Semnoptthecus, Fa. Cevr) ; les CokAet (CM«» ,
Ii l ig ) • les Guenons ou Cercopithèque! (Cereopithecm, E zx im .), et les Miopithèques {MiopUhecm, Is. Gzo ff.), non compris
1« Mangabeys, que leur système dentaire, récemment éludjé par plusieurs zoologistes, ne permet plus de laisser
parmi les Cercopithèques, et pour lesquels paraît devoir être rétabli le-genre Cerçoeèbe (Cercocebus, G*ore. S.
ont été envoyés par Jacquemont au Muséum d’histoire naturelle, et méritent
d’être décrits avec soin.
O u r s . Les passages dans lesquels Jacquemont mentionne ces animaux, sont
nombreux (h). Les lieux dans lesquels il a trouvé des Ours, sont : Hazaroubag,
entre Calcutta et Bénarés ; Cursali, près des sources de la Jumna ; Rarang,
dans le Thibet; Nâr, Vestervonne, dans le Pendjâb, et Sounmeurgue, dans le
Càchemir.
Les espèces ou variétés que 1 auteur a vues, sont, non compris XUrsus labia-
tus des auteurs qui n est point un véritable Ours, au nombre de trois : l’une
brune, 1 une noire, Jautre fauve. Le petit nombre de détails que Jacquemont
nous donne sur ces animaux, concorde parfaitement avec ce que nous savons
des Ours de notre pays. Ils évitent l’homme, à moins que la faim ne les presse.
Leur nourriture consiste principalement en poires et pommes sauvages, en
baies de diverses espèces, et en grains qu’ils viennent parfois chercher dans les
champs cultives. Dans la vallée du Téti, en Thibet, on est même obligé de
garder nuit et jour les champs éloignés des villages. /
On chasse ces animaux pour leur peau et pour leur graisse qui occupe une
grande place dans la matière médicale des médecins de Cacbemir. La chasse de
1 Ours est très-dangereuse ; et les Goudjeurs ou pâtres des montagnes sont
les seuls qui y soient bien exercés.
H y è n e s . LHyène rayée, à laquelle on n’a pendant si longtemps assigné
pour patrie que la Perse et 1 Afrique septentrionale, habite aussi, beaucoup
plus à lEst, jusque dans lln d e , et beaucoup plus à l’Ouest, jusqu’au Sénégal.
En ce moment même, la ménagerie du Muséum réunit à des Hyènes rayées de
Barbarie un individu ramené de la côte de Coromandel en i 83o par M. Dus-
sumier, et deux autres du Sénégal. Ces derniers, toutefois, sont remarquables
par une légère différence dans la forme de la tête, plus fine, plus allongée, et
plus semblable à celle du Chien.
Jacquemont,de même que plusieurs voyageurs anglais, a constaté non-seulement
le fait, aujourd hui bien connu, de l’existence de l’Hyène rayée dans l’Inde,
mais le peu de rareté de cette espèce. Il l’a trouvée à Poeloua, près de Calcutta, à
Hazaroubag et à Koutoub, près de Dehli, presque toujours dans des contrées où
se trouvent aussi d autres animaux sauvages, tels que les Ours, le Chacal et la
anthère. En général, 1 Hyène est peu redoutée : en Asie comme en Afrique,
partie, tom partie, tom. I , p. i 7o et 3oû; quatrième pa rtie , tom. I l , p. 106 et 408; cinquième
> . au, p. 2oo, 3io et 311.
IV. ■■ 5