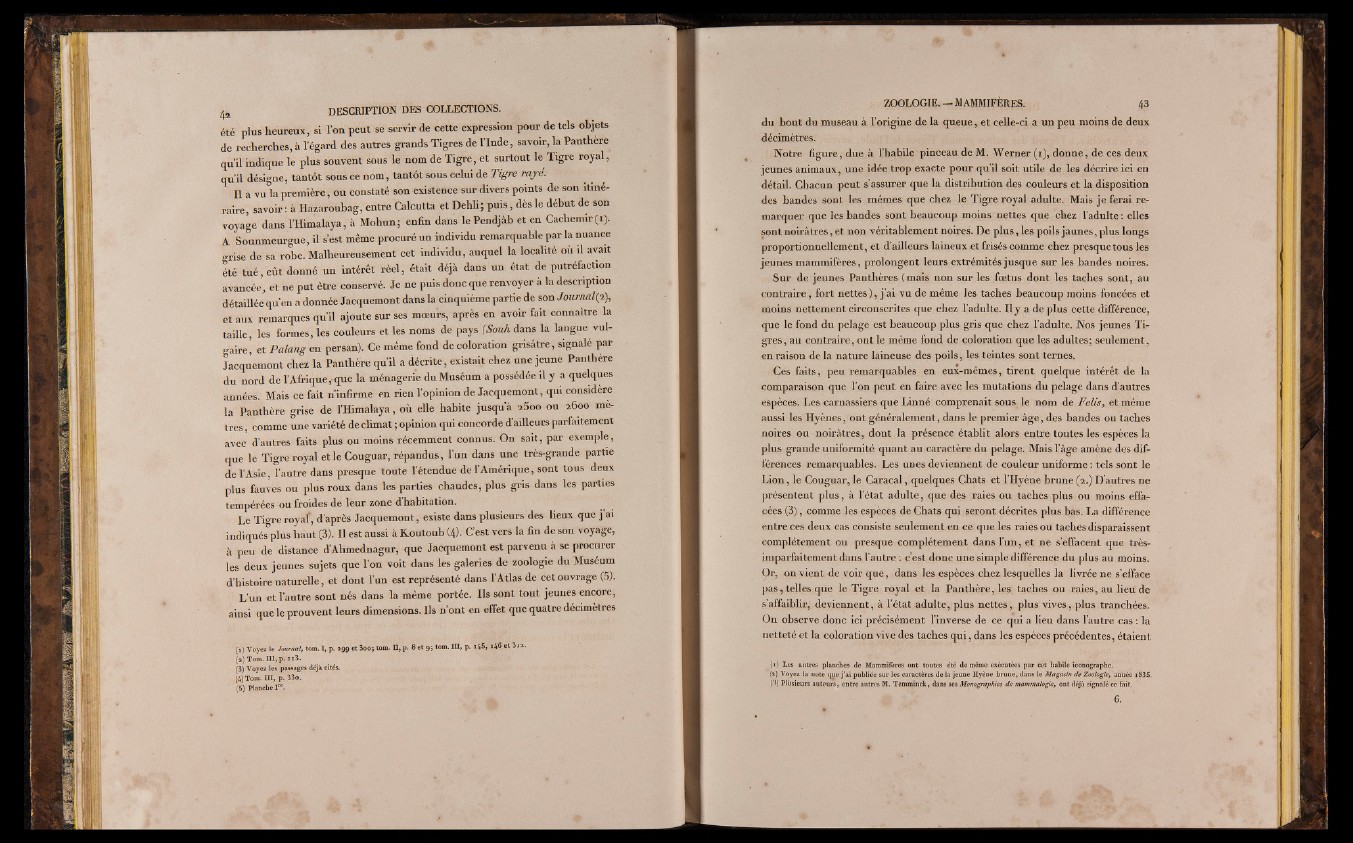
été plus heureux, si l’on peut se servir de cette expression pour de tels objets
de recherches, à l’égard des autres grands Tigres de l’Inde, savoir, la Panthere
qu'il indique le plus souvent sous le nom de Tigre, et surtout le Tigre royal,
qu'il désigne, tantôt sous ce nom, tantôt sous celui de Tigre rayé.
Il a vu la première, ou constaté son existence sur divers points de son itinéraire,
savoir : à Hazaroubag, entre Calcutta et Dehli ; puis, dès le début de son
voyage dans l’Himalaya, à Mohun; enfin dans le Pendjâb et en Cachemir(i).
A Sounmeurgue, il s’est même procuré un individu remarquable par la nuance
crise de sa robe. Malheureusement cet individu, auquel la localité où il avait
été tué, eût donné un intérêt réel, était déjà dans un état de putréfaction
avancée, et ne put être conservé. Je ne puis donc que renvoyer à la description
détaillée qu’en a donnée Jacquemont dans la cinquième partie de son Journal{2),
et aux remarques qu’il ajoute sur ses moeurs, après en avoir fait connaître la
taille, les formes, les couleurs et les noms de pays (Souh dans la langue vulgaire,
et Palang en persan). Ce même fond décoloration grisâtre, signale par
Jacquemont chez la Panthère qu’il a décrite, existait chez une jeune Panthère
du nord de l’Afrique ,-que la ménagerie du Muséum a possédée il y a quelques
années. Mais ce fait n’infirme en rien l’opinion de Jacquemont, qui.considère
la Panthère grise de l’Himalaya, où elle habite jusquà ï 5oo ou 2600 mètres
, comme une variété de climat ; opinion qui concorde d’ailleurs parfaitement
avec d’autres faits plus ou moins récemment connus. On sait, par exemple,
que le Tigre royal et le Couguar, répandus, l’un dans une très-grande partie
de l'Asie, l’autre dans presque toute l’étendue de l’Amérique, sont tous deux
plus fauves ou plus roux dans les parties chaudes, plus gris dans les parties
tempérées ou froides de leur zone d’habitation.
Le Tigre royal’, d’après Jacquemont, existe dans plusieurs des lieux que j ai
indiqués plus haut (3). Il est aussi à Koutoub (4). C’est vers la fin de son voyage,
à peu de distance d’Ahmednagur, que Jacquemont est parvenu à se procurer
les deux jeunes sujets que l’on Voit dans les galeries de zoologie du Muséum
d’histoire naturelle, et dont l’un est représenté dans l’Atlas de cet ouvrage (5).
L’un et l’autre sont nés dans la même portée. Ils sont tout jeunes encore,
ainsi que le prouvent leurs dimensions. Ils n’ont en effet que quatre décimètres
(1) Voyez le Journal, tom. I, p. 299 et 3o o ; tom. II, p. 8 et 9 ; tom. III, p. 146, »46 et 3»2.
(2) Tom. III, p. i» 3.
(3) Voyez les passages déjà cités.
(4) Tom. III, p. 33o.
(5) Planche l re.
du bout du museau à l’origine de la queue, et celle-ci a un peu moins de deux
décimètres.
Notre figure, due à l’habile pinceau de M. Werner (i), donne, de ces deux
jeunes animaux, une idée trop exacte pour qu’il soit utile de les décrire ici en
détail. Chacun peut s’assurer que la distribution des couleurs et la disposition
des bandes sont les mêmes que chez le Tigre royal adulte. Mais je ferai remarquer
que les bandes sont beaucoup moins nettes que chez l'adulte : elles
sont noirâtres, et non véritablement noires. De plus, les poils jaunes, plus longs
proportionnellement, et d’ailleurs laineux et frisés comme chez presque tous les
jeunes mammifères, prolongent leurs extrémités jusque sur les bandes noires.
Sur de jeunes Panthères (mais non sur les foetus dont les taches sont, au
contraire, fort nettes), j’ai vu de même les taches beaucoup moins foncées et
moins nettement circonscrites que chez l’adulte. Il y a de plus cette différence,
que le fond du pelage est beaucoup plus gris que chez l’adulte. Nos jeunes Tigres,
au contraire, ont le même fond de coloration que les adultes; seulement,
en raison de la nature laineuse des poils, les teintes sont ternes.
Ces faits, peu remarquables en eux-mêmes, tirent quelque intérêt de la
comparaison que l’on peut en faire avec les mutations du pelage dans d’autres
espèces. Les carnassiers que Linné comprenait sous le nom de F élis, et même
aussi les Hyènes, ont généralement, dans le premier âge, des bandes ou taches
noires pu noirâtres, dont la présence établit alors entre toutes les espèces la
plus grande uniformité quant au caractère du pelage. Mais l’âge amène des différences
remarquables. Les unes deviennent de couleur uniforme : tels sont le
Lion, le Couguar, le Caracal,,quelques Chats et l’Hyène brune (2.) D’autres ne
présentent plus, à l’état adulte, que des raies ou taches plus ou moins effacées
(3), comme les espèces de Chats qui seront décrites plus bas. La différence
entre ces deux cas consiste seulement en ce que les raies ou taches disparaissent
complètement ou presque complètement dans l’un, et ne s’effacent que très-
imparfaitement dans l’autre : c’est donc une simple différence du plus au moins.
Or, on vient de voir que, dans les espèces chez lesquelles la livrée ne s’efface
pas, telles qiie le Tigre royal et la Panthère, les taches ou raies, au lieu de
s’affaiblir, deviennent, à l’état adulte, plus nettes, plus vives, plus tranchées.
On observe donc ici précisément l’inverse de ce qui a lieu dans l’autre cas : la
netteté et la coloration vive des taches qui, dans les espèces précédentes, étaient
(1) Les autres planches de Mammifères ont toutes été de même exécutées par cet habile iconographe.
(2) Voyez la note que j ’ai publiée sur les caractères de la jeune Hyène brune, dans le Magasin de Zoologie, année »835,
(3) Plusieurs auteurs, entre autres M. Temminck, dans ses Monographies de mammalogie, ont déjà signalé ce fait.