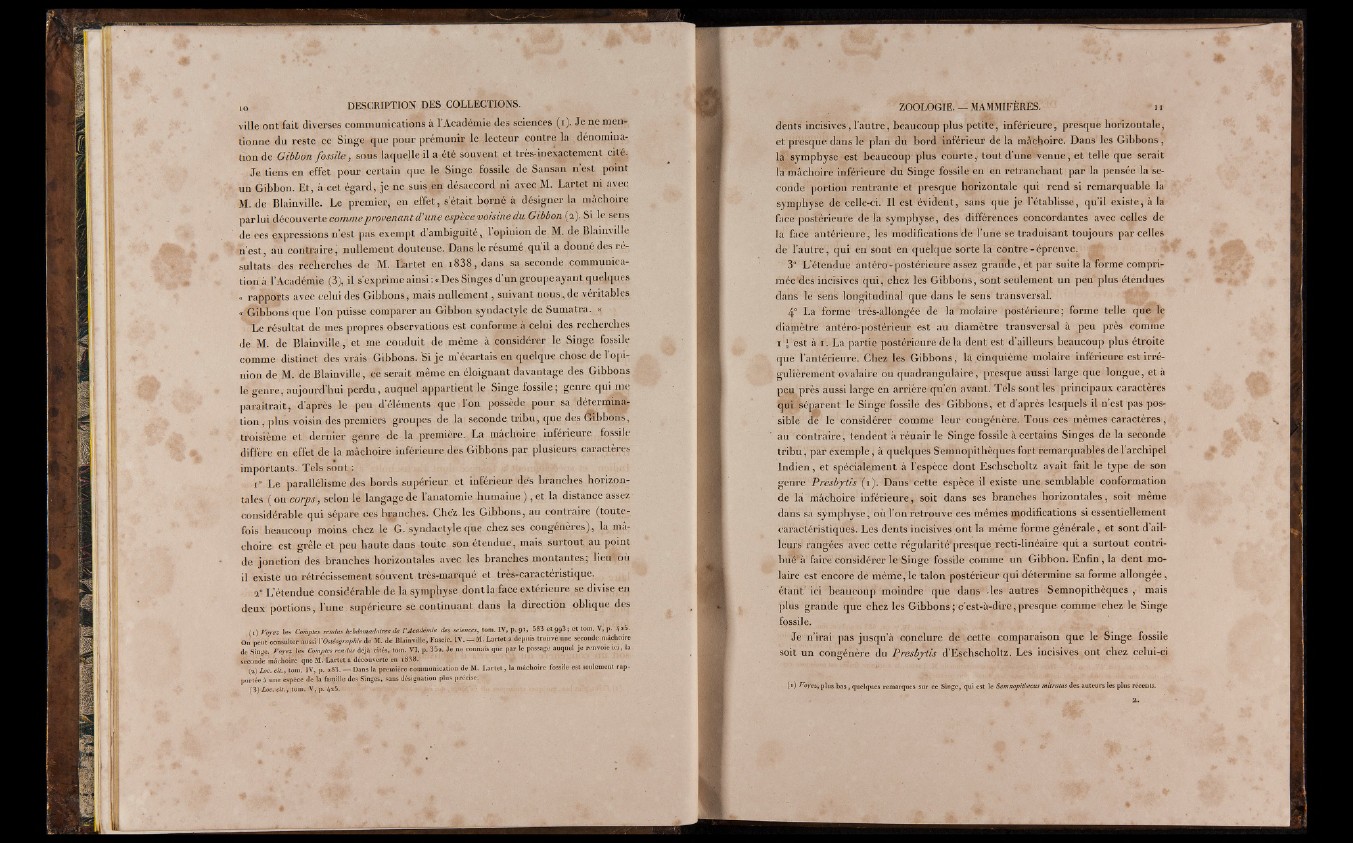
ville ont fait diverses communications à l’Académie des sciences (i). Je ne rrien-
tionne du reste ce S in g e , que pour prémunir le .lecteur contre la dénomination
de Gibbon fossile, sous laquelle il a été souvent et très-inexactement cité.
Je tiens en effet pour certain que le Singe fossile de Sansan n’est point
un Gibbon. Et, à cet égard, je ne suis {en désaccord ni avec,M. Lartet ni avec
M. de Blainville. Le premier, en effet, s’était borné à désigner la mâchoire
parlui découverte comme provenant d’une espèce voisine du Gibbon (pi). Si le sens
de ces expressions n’est pas exempt d’ambiguïté, l’opinion de M. de Blainville
n’est, au contraire , nullement douteuse. Dans le.résumé.quil a donnédes résultats
des recherches de M. Lartet en i 838, dans sa seconde communication
à l'Académie (3), il s'exprime ainsi : «Des Singes d’un groupeayant quelques
« rapports avec celui des Gibbons, mais nullement, suivant nous, de véritables
« Gibbons que l’on puisse comparer au Gibbon syndactyle de Sumatra. »
Le résultat de mes propres observations est conforme à celui des recherches
de M. de Blainville, et me conduit de même à considérer le Singe fossile
comme distinct des vrais Gibbons. Si je m'écartais en quelque chose de l’opinion
de M. de Blainville, cè serait même en éloignant davantage des Gibbons
le genre, aujourd’hui perdu, auquel appartient le Singe fossile; genre qui nie
paraîtrait, d’après le peu d’éléments que l’on possède pour sa détermination
, plus voisin dés premiers groupes de la, seconde tribu, que des Gibbon.s.
troisième et dernier genre de la première. La mâchoire inférieure fossile
diffère en effet de la mâchoire inférieure des Gibbons par plusieurs caractères
importants. Tels sODt,:
T Le parallélisme des bords supérieur et inférieur dés branches horizontales
( ou corps, selon le langage de l’anatomie humain«?:), et la distance assez
considérable qui sépare ces branches. Chez les Gibbons, au contraire (toutefois
beaucoup moins chez le G.'.syndactyle que chez ses congénères), la mâchoire
est grêle et peu haute dans toute son etendue, mais surtout au point
de: jonction des branches horizontales avec les branches montantes.; ..lied? où
il existe un rétrécissement souvent très-marqué' et très-caracteristique.
2« L’étendue considérable de la symphyse dont la face extérieure se divise en
deux portions, l’une supérieure se continuant dans la direction oblique des
b ) Voyez les Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences, tom. IV, p. 91, 583 « 9 9 3 ; et tom. V, p. 426.
On peut consùltér'àussi'l’OsieegtïV’Aie de M. de Blainville, F u e te . IV. — M. Lartet a depuis trouvé une seconde mâchoire
de Singe. V o y e lle s Comptes pmius déjà cités, tom. VI, p. 35a. Jeme connais que p£r le passage auquel je ren vo ie ici, la
seconde mâchoire qué M. Lartét a découverte en i 838.
(2) Loc. cit., tom. IV, p. a 83. — Dans la première communication de M. L a r te t, la mâchoire fossile est seulement rapportée
à une espèce de la famille des Singes, sans désignation plus précise; ^
( 3) Loc.-.dt.'iiXoxa.N, p.
dents incisives, l’autre, beaucoup plus petite, inférieure, presque horizontale,
et presque dans le plan du bord inférieur delà mâchoire. Dans les Gibbons,’
la ¿symphyse est beaucoup plus courte, tout d’unéVenue, et telle que serait
la mâchoire inférieure du Singe fossile en en retranchant par la pensée la seconde
portion rentrante et presque horizontale qui rend si remarquable la
symphyse de celle-ci. Il est évident, sans qùe je l’établisse, qu’il existe, à la
face postérieure de la symphyse, des différences concordantes avec celles de
la face antérieure, les modifications de l’une se traduisant toujours parcelles
de l’autre, qui en sont en quelque sorte la contre-épreuve. 1
3° L’étendue a ntéro-postérieure assez grande, et par suite la forme comprimée'des
incisives qui, chez les Gibbons, sdnt seulement un peu plus étendues
dans le sens longitudinal que dans le sens transversal.
4° La forme très-allongée de la molaire postérieure; forme telle que le
diamètre antérO-postérieur est au diamètre transversal à peu près comme
\ 2 est à i. La partie postérieure delà dent est d’ailleurs beaucoup plus étroite
que l’antérieure. Chez les Gibbons, cinquième molaire inférieure est irrégulièrement
ovalaire ou quadrangulairé, presque aussi large que longue, et à
peu près aussi large en arrière qu’en avant. Tels sont les principaux caractères
qui Réparent le Singe fossile des Gibbons , et d’après lesquels il n’est pas possible
de le considérer comme leur congénère. Tous ces mêmes caractères,
au contraire , tendent à réunir le Singe fossile à certains Singes de la seconde
tribu, par exemple, à quelques Semnopithèques fort remarquables de l’archipel
Indien, et spécialement à l’espèce dont Eschscholtz avait fait le type de son
genre Presby'tis\iy:iY)&ns cette espèce il existe une semblable conformation
de là mâchoire inférieure, soit dans ses branches horizontales, soit meme
dans sa symphyse, où l’on retrouve ces mêmes modifications si essentiellement
caractéristiques. Les dents incisives ont la même forme générale, et sont d’ailleurs
rangées avec cette régularité*presque recti-linéaire qui a surtout contribué^
faire considérer le Singe fossile comme un Gibbon. Enfin, la dent molaire
est encore de même, le talon postérieur qui détermine sa forme allongée,
étant ici beaucoup moindre que dans -les autres Semnopithèques, mais
plus grande que chez les Gibbons ; c’est-à-dire, presque comme chez le Singe
fossile.
Je n’irai pas jusqu’à conclure de cette comparaison que le Singe fossile
soit un congénère du Presbytis d’Eschscholtz. Les incisives ont chez celui-ci
(*) ^oyez,plus ba s, quelques remarques sur ce Singe, qui est le Scmnopithecus mttralusdes auteurs les plus récents.