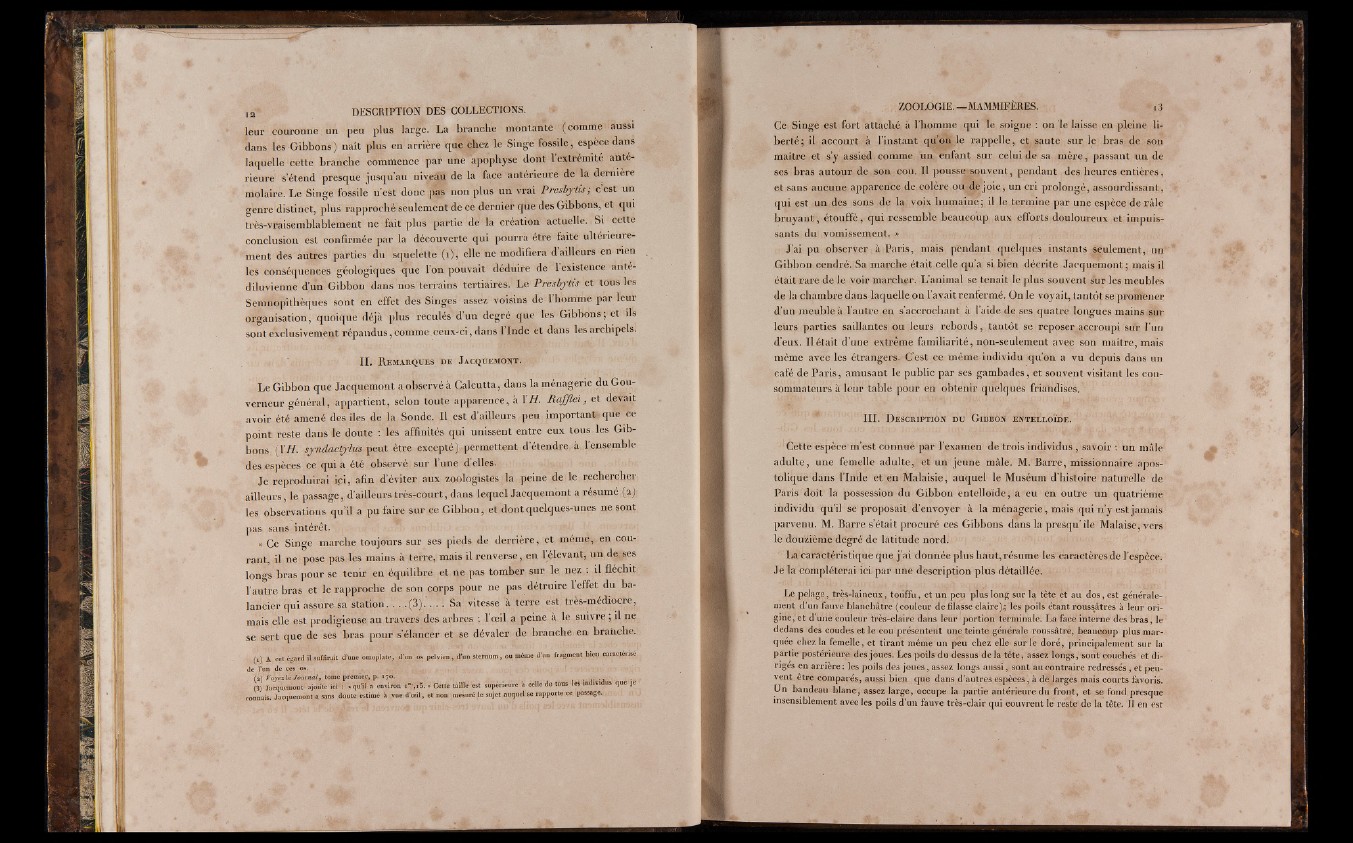
leur couronne un peu plus large. La branche montante (comme aussi
dans les Gibbons') naît plus en arrière que chez le Singe fossile , espèce dans
laquelle cette branche cbmmence par une apophyse dont 1 extrémité antérieure
s’étend presque jusqu’au niveau de la face antérieure de la dernière
molaire. Le Singe fossile u’est donc pas non plus un vrai Presbytis; c est un
genre distinct, plus rapproché seulement de ce dernier que des Gibbons, et qui
très-vraisemblablement ne fait plus partie de la création actuelle. Si cette
conclusion est confirmée par la découverte qui pourra etre faite ultérieurement
des autres parties du squelette (i), elle ne modifiera dailleurs en rien
les conséquences géologiques que l’on pouvait déduire de 1 existence ante-
diluvienne d’un Gibbon dans nos terrains tertiaires. Le Presbytis et tous lés
Semnopithèques sont en effet des Singes assez voisins de l’homme par leur
organisation, quoique déjà plus reculés d’un degré que les Gibbons : et ils
sont exclusivement répandus, comme.ceux-ci, dans 1 Inde et dans les archipels.
II. R e m a r q u e s d e J a c q u e m o u t .
Le Gibbon que Jacquemont a observé à Calcutta, dans la ménagerie du Gouverneur
général, appartient, selon toute apparence, à 1 H. Rafflei, et devait
avoir été amené des îles de la Sonde. Il est d ailleurs peu important que ce
point reste dans le doute : les affinités qui unissent entre eux tous les Gibbons,
(l’/i. syndactylus peut être excepté ) permettent d’étendre. à l’ensemble
des espèces ce qui a été observé sur l’une d’elles.
Je reproduirai ici, afin d’éviter aux zoologistes la peine de le recbercher
ailleurs, le passage, d’ailleurs très-court, dans lequel Jacquemont a résumé
les observations qu’il a pu faire sur ce Gibbon, et dont quelques-unes ne, sont
pas sans intérêt.
« Ce Singe marche toujours sur ses pieds de derrière, et m ê m e , en courant,
il ne pose pas les mains à terre, mais il renverse , en lelevant, un denses
]oîies bras pour se tenir en équilibre et ne pas tomber sur le nez : il fléchit
l’autre bras et le rapproche de son corps pour ne pas détruire 1 effet du balancier
qui assure 'sa station. . . . (3) . . ! . Sa vitesse à terre est très-médiocre^
mais.elle est prodigieuse au travers des arbres : l’oeil a peine à le suivre ; il ne
se sert que de ses bras pour s’élancer et se dévaler de branche en branche.
( î) L cet égard i\. suffirait d’une omoplate, d’un os pelvien, d’un sternum, ou même d’un fragment bien caractérisé
de l’un de ces .os. j
(2) Voyez le Journal, tome premier, p. 170. . . .........
(3) Jacqu.emont ajoute ici : « qu’il a environ a - - ,r5i » Cette taille est supérieure à celle de tous les individus que je
connais. Jacquemont a sans doute estimé à vue d’oe il, et non mesuré le sujet auquel se rapporte ce passage.
Ce Singe est fort attaché à l’homme qui le soigne : on le laisse en pleine liberté;
il accourt à l’instant qu’on le rappelle, et,«saute sur le bras de son
maître et s’y assied comme un enfant sur celui de sa mère, passant un de
ses bras autour de son cou. Il pousse^quvent, pendant des heures entières,
et sans aucune apparence de colère ou de joie, un cri prolongé, assourdissant,
qui est un des sons de la voix humaine; il le termine par une espèce de râle
bruyant, étouffé, qui ressemble beaucoup aux efforts douloureux et impuissants
du vomissement. »
J’ai pu observer à Paris, mais pendant quelques instants seulement, un
Gibbon cendré. Sa marche était celle qu’a si bien décrite Jacquemont; mais il
était rare de le voir marcher. L’animal se tenait le plus souvent sur les meubles
de la chambre dans laquelle on l’avait renfermé. On le voyait, tantôt se promener
d’un meuble à l’autre en s’accrochant à l’aide de ses quatre longues mains sur
leurs parties saillantes ou leurs rebords, tantôt se reposer accroupi sur l’un
d’eux. Il était d’une extrême familiarité, non-seulement avec son maître, mais
même avec les étrangers. C est ce même individu qu’on a vu depuis dans 1111
café de Paris, amusant le public par ses gambades, et souvent visitant les consommateurs
à leur table pour en obtenir quelques friandises.
III. D e s c r i p t i o n d u G i b b o n e n t e l l o ï d e .
Cette espèce m’est connue par l’examen de trois individus, savoir : un mâle
adulte, une femelle adulte, et un jeune mâle. M. Barre, missionnaire apostolique
dans l’Inde et en Malaisie, auquel le Muséum d’histoire naturelle de
Paris doit la possession du Gibbon entelloïde j a eu en outre un quatrième
individu qu’il se proposait d’envoyer à la ménagerie, mais qui n’y est jamais
parvenu. M. Barre s’était procuré ces Gibbons dans la presqu’ île Malaise, vers
le douzième degré de latitude nord.
La caractéristique que j ’ai donnée plus haut, résume les caractères de l’espèce.
Je la compléterai ici- par une description plus détaillée.
Le pelage, très-laineux, touffu, et un peu plus long sur la tête ét au dos, est générale- -
ment d’un fauve blanchâtre (couleur défilasse claire),;‘les poils étant roussâtres à leur origine,
7 ét d’une couleur très-claire dans leur portion terminale. La face interne des bras, lé
dedans des coudes et le éou présentent une teinte générale roussâtre, beaucoup plus marquée
chez la femelle, et tirant même un peu chez elle sur le doré, principalement sur la'
partie postérieure des joues. Les poils du dessus delà tête, assez longs, sont couchés et diriges
en arriéré : les poils des joues, assez longs aussi, sont au contraire redressés , et peuvent
être comparés, aussi bien que dans d’autres espèces, à de larges mais courts favoris.
Un bandeau blanc, assez large, occupe la partie antérieure du front, et se fond presque
insensiblement avec les poils d’un fauve très-clair qui couvrent le reste de la tête. Il en est