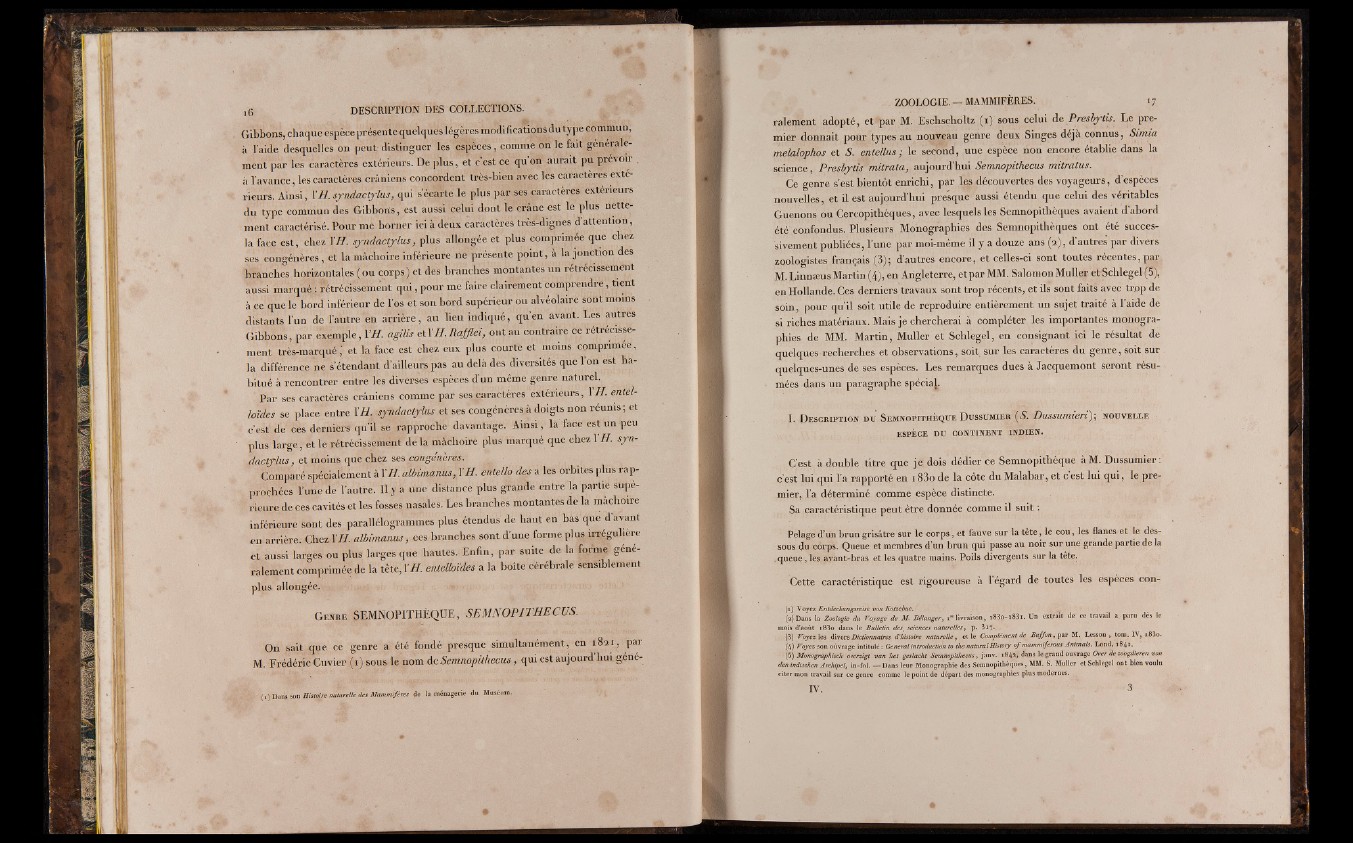
l6 description des colle ctions.
Gibbons, chaque espèce présente quelques légères modificàtionsdutype commun,
à l’aide desquelles on peut distinguer les espèces, comme on le fàit généralement
par les caractères extérieurs. De plus, et c’est ce qu on aurait pu prévoir .
à l’avance, les caractères crâniens concordent très-bien avec lès caracteres extérieurs.
Ainsi, l'H.syndactylus, qui s'écarte le plus par ses caractères extérieurs
du type commun des Gibbons, est aussi celui dont le crâne est le plus nettement
caractérisé. Pour me borner ici à deux caractères tréâ-dignes d’attention,
la face est, chez l’77. syndactylus, plus allongée et plus comprimée que chez
ses congénères, et la mâchoire inférieure ne présente point, à la jonction des
branches horizontales (ou corps) et des branches montantes un rétrécissement
aussi marqué «rétrécissement qui, pour me faire clairement comprendre, tient
à ce que le bord inférieur de l’os et son bord supérieur ou alvéolaire sont moins
distants l’un de l’autre en arrière, au lieu indiqué, qu’en avant. Les autres
Gibbons, par exemple, Y H. agilis elYII.Iiafflei, ont au contraire ce rétrécissement
très-marqué J et la face est chez eux plus courte et moins comprimée,
la différence ne s’étendant d’ailleurs pas au delà des diversités que 1 on est habitué
à rencontrer entre les diverses espèces d’un même genre naturel.
Par ses caractères crâniens comme par ses Caractères extérieurs, 1 77. entelloïdes
se place'entre Y H. syndactylus et ses congénères à doigts non réunis; et
• c’est de ces derniers qu’il ¡æ rapproche davantage. Ainsi, la face est un peu
plus large," et le rétrécissement delà mâchoire plus marqué que chez 17/. syn-
dactflus, et moins que chez ses congénères.
Comparé spécialement à l’TZ. albimanus, Y H. tintello des a les orbites plus rapprochées
lune de'l'autre.-Il y a une distance plus grande entre la partie supérieure
de ces cavités et les fosses nasales. Les branches montantes de la mâchoire
inférieure sont des parallélogrammes plus étendus de haut en bas que d avant
en arrière. Chez Y H. albimanus, ces branches sont d’une forme plus irçgplière
et aussi larges ou plus larges que hautes. Enfin, par suite de la formep généralement
comprimée de la tête, l’77. entelloïdes a la boite cérébrale sensiblement
plus allongée.
G e n r e SEMNOPITHÈQUE, SEMNOPITHECUS.
On sait que cè, genre a. été fondé presque simultanément, en i8 a i, par
M. Frédéric Guvier (i) sous le nom de Semnopithecus , qui est aujourd hui géiié-
( i) Dans son Histoire naturelle des Mammifères de la ménagerie du Muséum.
ralement adopté, et par M. Eschsçholtz (1) sous celui de Presbytis. Le premier
donnait pour types au nouveau genre deux Singes déjà connus, Simia
melalophos et S. entellus ; le second, une espèce non encore établie dans la
science, Presbytis mitrata, aujourd’hui Semnopithecus mitratus.
Ce genre s’est bientôt enrichi, par les découvertes des voyageurs, d’espèces
nouvelles, et il est aujourd’hui presque aussi étendu que celui des véritables
Guenons ou Cercopithèques, avec lesquels les Semnopithèques avaient d'abord
été confondus. Plusieurs Monographies des Semnopithèques ont été successivement
publiées, l’une par moi-meme il y a douze ans (a), d autres par divers
zoologistes français (3); d’autres encore, et celles-ci sont toutes récentes, par
M. Linnæus Martin (4) , en Angleterre, et par MM. Salomon Muller ct Schlegel (5),
en Hollande. Ces derniers travaux sont trop récents, et ils sont faits avec trpp de
soin, pour qu’il soit utile de reproduire entièrement un sujet traité à l’aide de
si riches matériaux. Mais je chercherai à compléter les importantes monographies
de MM. Martin, Muller et Schlegel, en consignant ici le résultat de
quelques recherches et observations, soit sur les caractères du genre, soit sur
quelques-unes de ses espèces. Les remarques dues à Jacquemont seront résumées
dans un paragraphe spécial.
I . D e s c r i p t i o n d u S e m n o p i t h è q u e D u s s u m i e r (S. E)ussumieri); n o u v e l l e -
e s p è c e d u c o n t i n e n t i n d i e n .
Gest à double titre que j< dois dédier ce Semnopithèque à M. Dussumier :
c’est lui qui l’a rapporté en 183o de la côte du Malabar, et c est lui qui, le premier,
l’a déterminé comme espèce distincte.
Sa caractéristique peut être donnée comme il suit :
Pelage d’un brun grisâtre sur le corps, et fauve sur la tete, le cou, les Bancs et le dessous
du corps. Queue et membres d’un brun qui passe au noir sur une grande partie de la
.queue, les avant-bras et les quatre mains. Poils divergents sur la tête.
Cette caractéristique est rigoureuse à l’égard de toutes les espèces con-
(1) Voyez Entdeckungsreise von Kotzebuc.
(2) Dans la Zoologie du Voyagé de M. Bélanger, 1 " livraison, i 83o - i83i . Un extrait de ce travail a paru dès le
mois d’aoùt i 83o dans le Bulletin desf sciences naturelles, p.. 317.
- (3) Voyez les divers Dictionnaires d ’histoire naturelle, e lle Complément de Buffon, par M. Lesson , tom. IV, i 83o.
(4) Voyez son oùVrage intitulé : General introduction to the naturai History o f mammiferous Animais. Lond. 1841.
(5) Monographisch overzigt van het geslacht Semnopithecus, janv. 1842» dans le grand ouvrage Over dezoogdieren von
denindischen Archipel, in-fol. — Dans leur Monographie des Semnopithèques, MM. S. Muller et Schlegel ont bien voulu
citer mon travail sur ce genre comme le point de départ des monographies plus modernes.
IV. - I I I I '" 3-