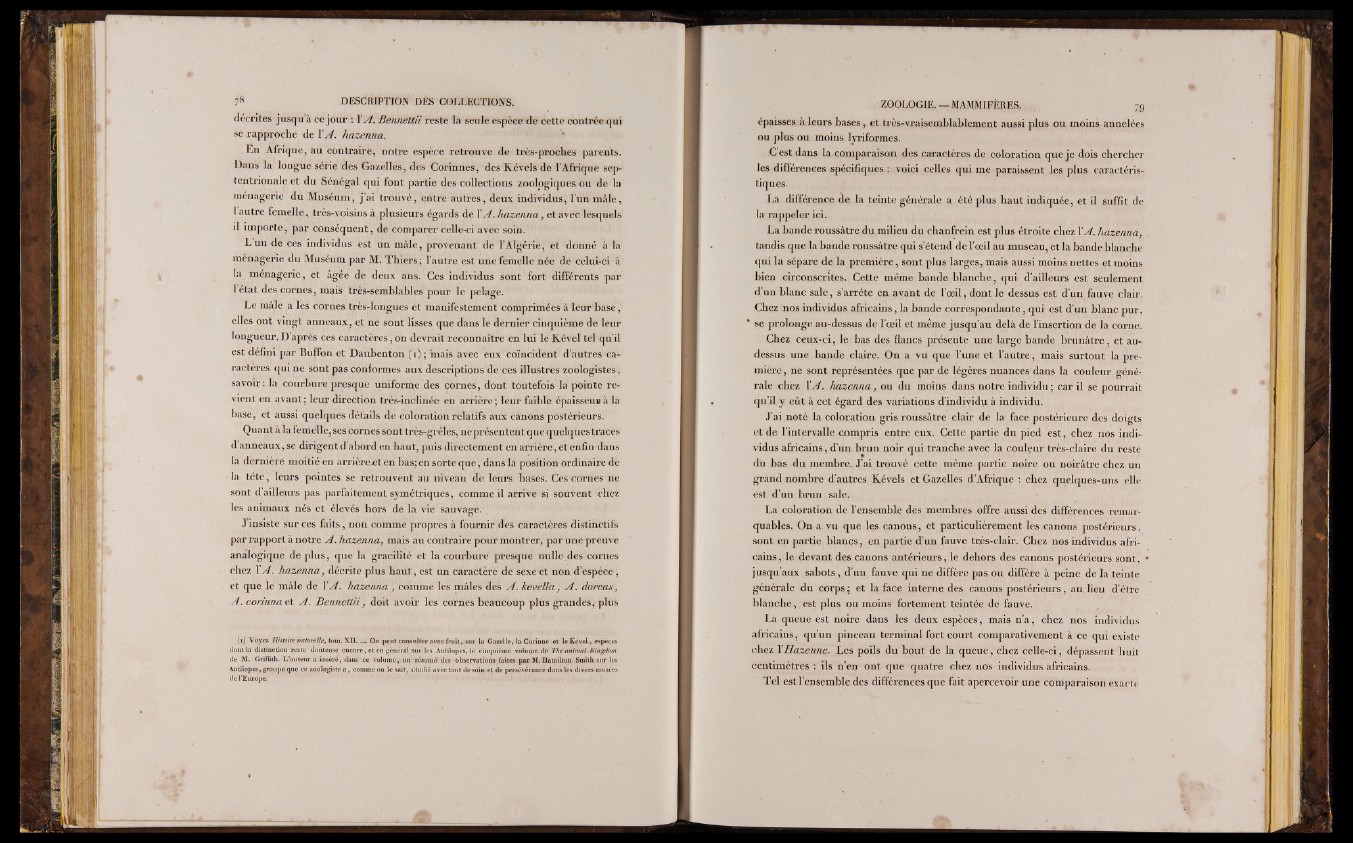
décrites jusqu à ce jour : XA. Bennettii reste la seule espèce de cette contrée qui
se rapproche de XA. hazenna.
En Afrique, au contraire, notre espèce retrouve de très-proches parents.
Dans la longue série des Gazelles, des Corinnes, des Kévels de l’Afrique septentrionale
et du Sénégal qui font partie des collections zoologiques ou de la
ménagerie du Muséum, j ’ai trouvé, entre autres, deux individus, l’un mâle,
1 autre femelle, très-voisins à plusieurs égards de XA. hazenna, et avec lesquels
il importe, par conséquent, de comparer celle-ci avec soin.
Lun de ces individus est un mâle, provenant de l’Algérie, et donné à la
ménagerie du Muséum par M. Thiers; l’autre est une femelle née de celui-ci à
la ménagerie, et âgée de deux ans. Ces individus sont fort différents par
1 état des cornes, mais très-semblables pour le pelage.
Le mâle a les cornes très-longues et manifestement comprimées à leur base,'
elles ont vingt anneaux, et ne sont lisses que dans le dernier cinquième de leur
longueur. D’après ces caractères, on devrait reconnaître en lui le Kével tel qu’il
est défini par Buffon et Daubenton (i); mais avec eux coïncident d’autres caractères
qui ne sont pas conformes aux descriptions de ces illustres zoologistes,
savoir : la courbure presque uniforme des çorûes, dont toutefois la pointe revient
en avant; leur direction très-inclinée en arrière; leur faible épaisseur à la
base, et aussi quelques détails de coloration relatifs aux canons postérieurs.
Quant à la femelle, ses cornes sont très-grêles, ne présentent que quelques traces
d’anneaux, se dirigent d’abord en haut, puis directement en arrière, et enfin dans
la dernière moitiéen arriérent en bas; en sorte que, dans la position ordinaire de
la tête, leurs pointes se retrouvent au niveau de leurs bases. Ces cornes ne
sont d’ailleurs pas parfaitement symétriques, comme il arrive si souvent chez
les animaux nés et élevés hors de la vie sauvage.
Jinsiste sur ces faits, non comme propres à fournir des caractères distinctifs
par rapport à notre A . hazenna, mais au contraire pour montrer, par une preuve
analogique de plus, que la gracilité et la courbure presque nulle des cornes
chez XA. hazenna, décrite plus haut., est un caractère de sexe et non d’espèce ,
et que le mâle de XA. hazenna, comme les mâles des A . kevella, A . dorcas,
A . corinnaet A. Bennettii, doit avoir les cornes beaucoup plus grandes, plus
(i) Voyez Histoire naturelle, tom. XII. — On peut consulter avec fruit, sur la Gazelle, la-Corinne e t le K c v e l, espèces
dont la distinction reste douteuse encore, et en général sur les Antilopes, le cinquième volume de The animal Kingdom
de M. Griffith. L ’auteur a inséré, dans ce volume, un résumé des observations faites par M. Hamilton Smith sur les
Antilopes, groupe que ce zoologiste a , comme on le sait, étudié avec tant de soin et de persévérance dans les divers musées
de l'Europe.
épaisses à leurs bases , et très-vraisemblablement aussi plus ou moins annelées
ou plus ou moins lyriformes.
C’est dans la .comparaison des caractères de coloration que je dois chercher
les différences spécifiques : voici celles qui me paraissent les plus caractéristiques.
La différence de la teinte générale a été plus haut indiquée, et il suffit de
la rappeler ici.
La bande roussâtre du.milieu du chanfrein est plus étroite chez XA. hazenna,
tandis que la bande roussâtre qui s’étend de l’oeil au museau, et la bande blanche
qui la sépare de la première, sont plus larges, mais aussi moins nettes et moins
bien circonscrites. Cette même bande blanche, qui d’ailleurs est seulement
d’un blanc sale, s’arrête en avant de l’oeil, dont le dessus est d’un fauve clair.
Chez nos individus africains, la bande correspondante, qui est d’un blanc pur,
se prolonge au-dessus de l’oeil et même jusqu’au delà de l’insertion de la corne.
Chez ceux-ci, le bas des flancs présente une large bande brunâtre, et au-
dessus une bande claire. On a vu que l’une et l’autre, mais surtout la première,
ne sont représentées que par de légères nuances dans la couleur générale
chez XA. hazenna, ou du moins dans notre individu ; car il se pourrait
qu’il y eût à cet égard des variations d’individu à individu.
J’ai noté la coloration gris roussâtre clair de la face postérieure des doigts
et de l’intervalle compris entre eux. Cette partie du pied est, chez nos individus
africains, d’un brun noir qui tranche avec la couleur très-claire du reste
du bas du membre. J’ai trouvé cette même partie noire ou noirâtre chez un
grand nombre d’autres Kévels et Gazelles d’Afrique : chez quelques-uns elle
est d’un brun sale.
La coloration de l’ensemble des membres offre aussi des différences remarquables.
On a vu que les canons, et particulièrement les canons postérieurs,
sont en partie blancs, en partie d’un fauve très-clair. Chez nos individus africains,
le devant des canons antérieurs, le dehors des canons postérieurs sont 1
jusqu’aux sabots, d’un fauve qui ne diffère pas ou diffère à peine de la teinte
générale du corps; et la face interne des canons postérieurs, au.lieu d’être
blanche, est plus ou moins fortement teintée de fauve.
La queue est noire dans les deux espèces, mais n’a, chez nos individus
africains, qu’un pinceau terminal fort court comparativement à ce qui existe
chez XHazenne. Les poils du bout, de la queue, chez celle-ci, dépassent huit
centimètres : ils n’en ont que quatre chez nos individus africains.
Tel estl’ensemble des différences que fait apercevoir une comparaison exacte