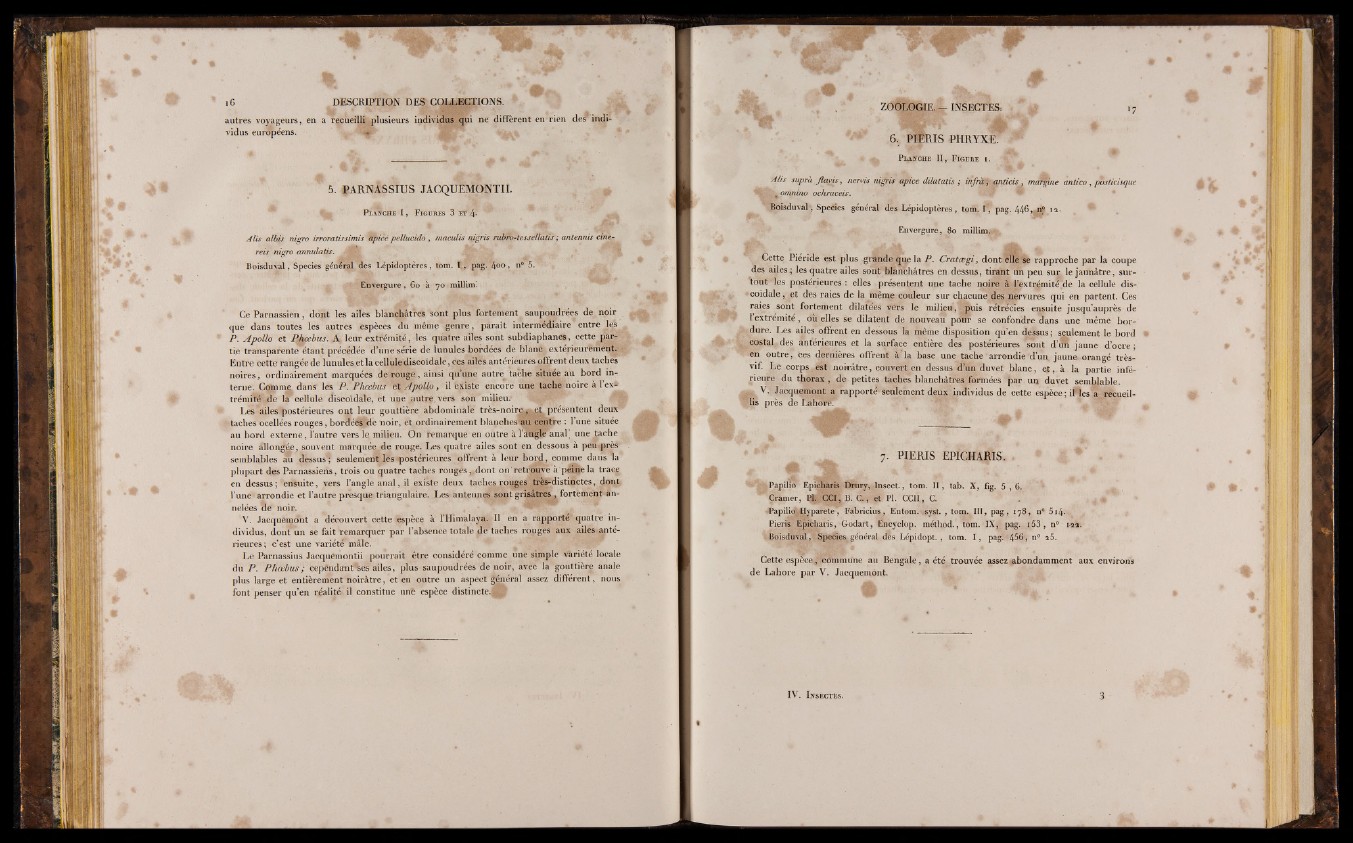
autres voyageurs, en a recueilli plusieurs individus qui ne diffèrent en rien dea individus
européens.
5. PARNÂSSIUS JACQUEMONTII.
P l a n c h e I , F ig u r e s 3 e t 4 -
Alis albis nigro irroratissimis apicé pellucido , macidis nigris rubfo-tessellatis ; antennis cine-
reis nigro annulatis. A
Boisduval, Species général des Lépidoptères, tom. I , pag. 4°°? n° 5.
Envergure, 6o à 70 millim.
Ce Parnassien, dont les ailes blanchâtres sont plus fortement saupoudrées de noir
que dans toutes les autres espèces du même genre, parait intermédiaire entre les .
P. A polio et Phoebus. A leur extrémité, les quatre ailes sont subdiaphanes, cette partie
transparente étant précédée d’une série de lunules bordées de blanc - exterieurëment.
Entre cette rangée de lunules et la cellule discoïdale, ces ailes antérieures offrent deux tachés
noires, ordinairement marquées de rouge, ainsi qu’une autre tache situee au bord interne.
Coïnma dans les P. Phoebus* et A p o llo , il existe encore une tachemoire à l’ex*
trémïfë de la cellule discoïdale, et une autre vers son milieu.*
Les*ailes$jpostérieures ont leur gouttière abdominale très-noirt^^et présentent deux
»taches ocellées rouges, bordéêSvde noir, et ordinairement blanches’au centre : l’une située
au bord externe, l’autre vers le milieu. On remarque en outre à 1 angle anal’ une tache
noire allongée, souvent marquéude rouge. Les quatre ailes sont en dessous à peu près
semblables au dessus* seulement les «postérieures offrent à leur bord, comme dans 1a
plupart des Parnassiens, trois ou quatre taches rouges ^dont on retrouve à peine la trace
en dessus; ensuite, vers l’angle anal, il existe deux ta ch es^ rouges très-distinctes, dont
l’une arrondie et l’autre presque triangulaire. Les- antennes sont grisâtres,, fortement a Ficelées
de noir.
V. Jacquèmont a découvert cette espèce à l’Himalaya. Il en a rapporte quatre individus,
dont un se fait remarquer par l’absence totale de taches rouges aux ailes antérieures
; c’est une variété mâle.
Le Parnassius Jacquémontii pourrait être considéré comme une simple variété locale
du P. Phoebus; cepêndant^es ailes, plus saupoudrées de noir, avec la gouttièr| anale
plus large et entièrement noirâtre, et en outre un aspect général assez différent, nous
font penser qu’en réalité il constitue unê espèce distincte.**
6 , p iÉ R i s p h r y x e ; ;
I ^ P l a n c h e I I , F ig u r e i .
Alis supra Jlagis, nervis nigris apice dilatatis > infrà?$, anticis, matgine antico , posticisque
, omnino ochraceis.
Boisduval’, Speéies général des Lépidoptères, tom. I* pag. 446, ^ 1a-
Envergure, 80 millim.
Cette Piéride est plus grande que la P. Cratoegi, dont elle se rapproche par la coupe
des ailes; les quatre ailes sont blanchâtres en dessus, tirant un peu sur le jaunâtre, surto
u t Iles postérieures: elles présentent une tache noire à l’extrémitede la cellule discoïdale
, et des raies de la même couleur sur chacune des nervures qui en partent. Ces
raies sont fortement dilatées vers le milieu , puis rétrécies ensuite jusqu’auprès de
1 extrémité, ou elles se dilatent de nouveau poüï* se confondre dans une même bordure.
Les ailes offrent en dessous la même disposition qu’en dessus ; seulement le bord
costal des antérieures et la surface entière des postérieures sont d’un jaune d’ocre ;
en outre, Ces dernières offrent à la base une tache arrondie'd’un, jaune orangé très-
vif. Le corps,est noirâtre, couvert en dessus d’un duvet blanc, est, à la partie inférieure
du thorax, de petites taches blanchâtres formées >?par un duvet semblable.
Ht V. Jacquèmont a rapporté seulement deux individus de cette espèce; iï*les'a recueillis
près de Lahoré.
7. PIERIS EPICHARIS.
I^Papilio Epicharis Drury, Insect., tom. I l, tab. X, fig. 5 , 6.
Çramer, Pl. CCI , B. C., et Pl. CC1I , C. .
«rPapilio^Hyparete, Fabricius, En torn. syst. , torn. III, pag, 178, n° 514. j|
Pieris Epicharis, Godart, Encyclop. method., torn. IX, pag. i 53 , n° raa.
Boisduval, Species^ général des Lépidopt., torn. I , pag.-’ 4^6 , n° a 5.
Cette espèce,^commune au Bengale, a été trouvée assez.abondamment aux environs
de Lahore par V. Jacquèmont.
IV. I n s è c î é s . 3