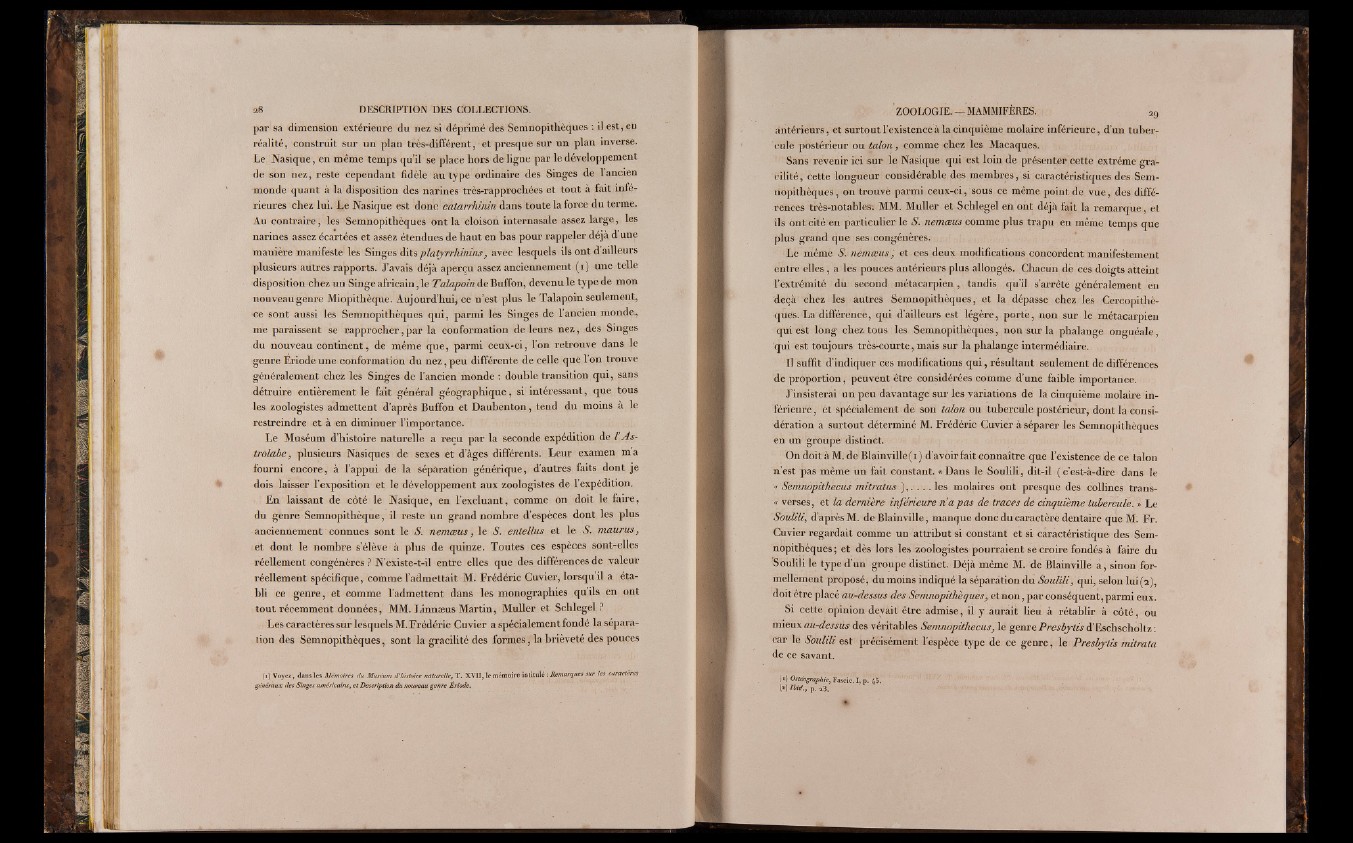
par sa dimension extérieure du nez si déprimé des Semnopithèques : il est, en
réalité, construit sur un plan très-différent, et presque sur un plan inverse.
Le Nasique, en même temps qu'il se place hors de ligne par le développement
de son nez, reste cependant fidèle au type ordinaire des Singes de 1 ancien
monde quant à la disposition des narines très-rapprochées et tout à fait inférieures
chez lui. Le Nasique est donc catarrhinin dans toute la force du terme.
Au contraire, les Semnopithèques ont la cloison internasale assez large, les
narines assez écartées et assez étendues de haut en bas pour rappeler déjà d une
mauière manifeste les Singes dits platyrrhinins, avec lesquels ils ont d’ailleurs
plusieurs autres rapports. J’avais déjà aperçu assez anciennement (i) une telle
disposition chez un Singe africain ,1e Talapoin de Billion. devenu le type de mon
nouveaugenre Miopithèque. Aujourd’hui,-ce n’est plus le Talapoin seulement,
ce sont aussi les Semnopithèques qui, parmi les Singes de l’ancien monde,
me paraissent se rapprocher, par la conformation de leurs nez, des Singes
du nouveau continent , de même que, parmi ceux-ci, l’on retrouve dans le
genre Ériodeune conformation du nez, peu différente de celle que Ion trouve
généralement chez les Singes de l’ancien monde : double transition qui, sans
détruire entièrement lé fait général géographique, si intéressant, que tous
les zoologistes admettent d’après Buffon et Daubenton, tend du moins à le
restreindre et à en diminuer l’importance.
Le Muséum d’histoire naturelle a reçu par la seconde expédition de l’Astrolabe
, plusieurs Nasiques de sexes et d’âges différents. Leur examen ma
fourni encore, à l’appui de la séparation générique, d’autres faits dont je
dois laisser l’exposition et le développement aux zoologistes de l’expédition.
En laissant de côté le Nasique, en l’excluant, comme on doit le faire,
du genre Semnopithèque, il reste un grand nombre d’espèces dont les plus
anciennement connues sont le S. nemoeus, le S. entellus et le S. maurus,
et dont le nombre s’élève à plus de quinze. Toutes ces espèces sont-elles
réellement congénères ? N’existe-t-il entre elles que des différences de valeur
réellement spécifique, comme l’admettait M. Frédéric Cuvier, lorsqu il a établi
ce genre, et comme l’admettent dans les monographies qu’ils en ont
tout récemment données, MM. Linnæus Martin, Muller et Schlegel ?
Les caractères sur lesquels M. Frédéric Cuvier a spécialement fondé la séparation
des Semnopithèques, sont la gracilité des formes, la brièveté des pouces
(i) Voyez , dans les Mémoires élu Muséum d’histoire naturelle, T. XVII, le mémoire intitulé : Remarques sur les caractères
¡généraux des Singes américains, et Description du nouveau genre Ériode.
antérieurs, et surtout l’existence à la cinquième molaire inférieure, d’un tubercule
postérieur ou talon., comme chez les Macaques.
Sans revenir ici sur le Nasique qui est loin de présenter cette extrême gracilité,
cette longueur considérable des membres, si caractéristiques des Semnopithèques
, on trouve parmi ceux-ci, sous ce même point de vue, des différences
très-notables. MM. Muller et Schlegel en ont déjà fait la remarque, et
ils ont Cité en particulier le S. nemoeus comme plus trapu en même temps que
plus grand que ses congénères.
■ ¡‘Lé même S. nemoeus, et ces deux modifications concordent manifestement
entre elles, a lés pouces antérieurs plus allongés. Chacun dè ces doigts atteint
l’ëxtrémité du second métacarpien, tandis qu’il s’arrête généralement en
deçà chez les autres Semnopithèques, et la dépasse chez les Cercopithèques.
La différence, qui d’ailleurs est légère, porté, non sur lé métacarpien
qui est long chez tous les Semnopithèques, non sur la phalange onguéale,
qui est toujours très-courte, mais sur la phalange intermédiaire.
Il suffit d’indiquer ces modifications qui, résultant seulement de différences
de proportion, peuvent être considérées comme d’une faible importance.
J’insisterai un pèu davantage sur les variations de la cinquième molaire inférieure
, et spécialement de son talon ou tubercule postérieur, dont la considération
a surtout déterminé M. Frédéric Cuvier à séparer les Semnopithèques
en un groupe distinct.
On doit à M. de Blainville(i) d’avoir fait connaître que l’existence de ce talon
n’est pas même un fait constant. « Dans le Soulili, dit-il ( ç’est-à-dire dans le
v'Semnopithecus mitratus ) , . . . . les molaires ont presque des collines trans-
«’ verses, et la dernière inférieure n’a pas de traces dé cinquième tubercule. » Le
Soulili, d’après M. de Blainville, manque donc du caractère dentaire que M. Fr.
Cuvier regardait comme un attribut si constant et si caractéristique des Semnopithèques
; et dès lors les zoologistes pourraient se croire fondés à faire du
Soulili le type d’un groupe distinct. Déjà même M. de Blainville a, sinon formellement
proposé, du moins indiqué la séparation du Soulili, qui, selon lui (a),
doit être placé au-dessus des Semnopithèques, ét non, par conséquent, parmi eux.
Si cette opinion devait être admise, il y aurait heu à rétablir à côté, ou
mieux au-dessus des véritables Semnopithecus, le genre Presbvtis d’Esehscholtz:
car le Soulili est précisément l’espèce type de ce genre, le Presbytis mitrata
de ce savant.
(i) Ostéographie, Fascic. I, p. /,5.
(a) Ibid., p. a 3.