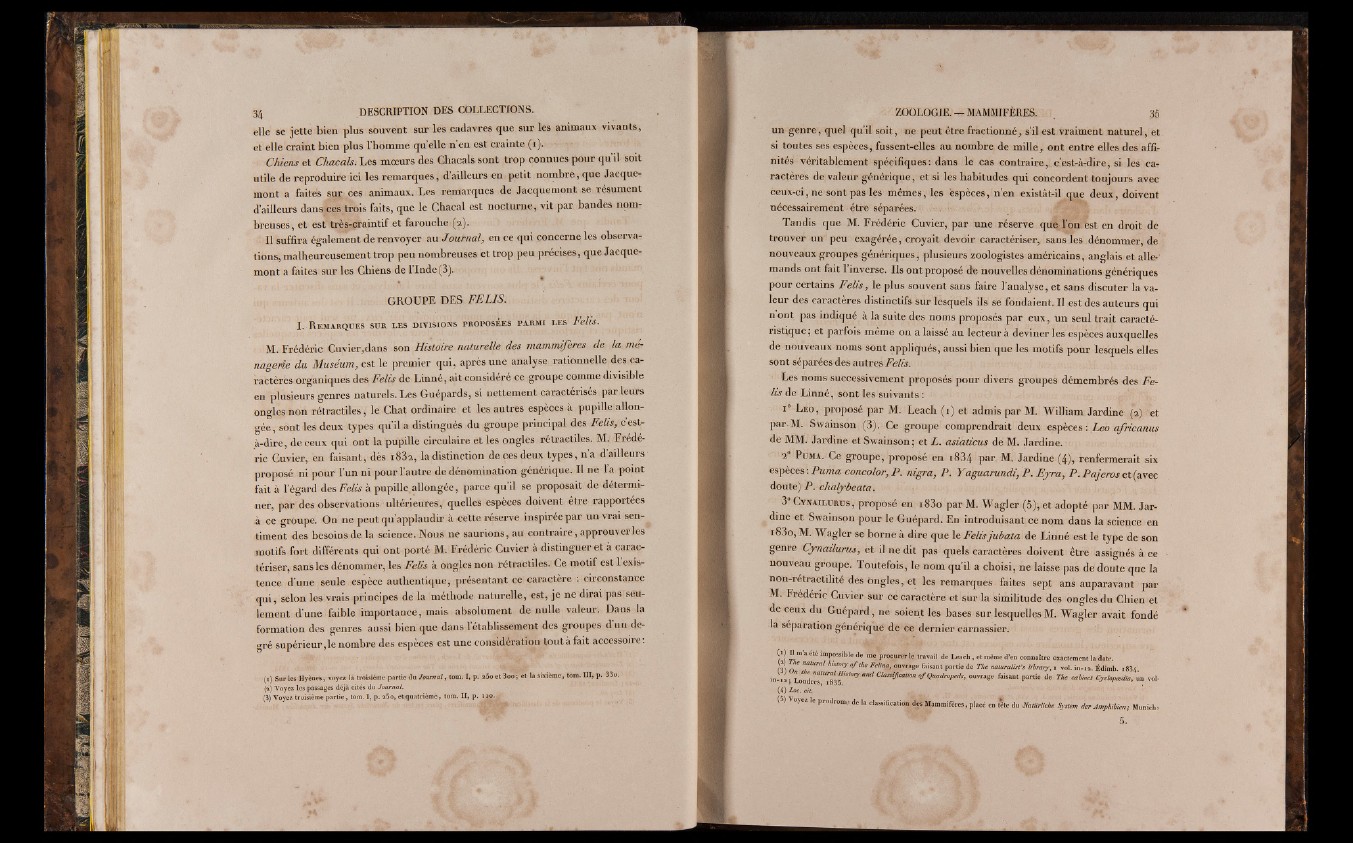
elle se jette bien plus souvent sur les cadavres que sur les animaux vivants,
et elle craint bien plus l’homme qu’elle n’en est crainte (ï).
Chiens et Chacals. Les moeurs des Chacals sont trop connues pour qu’il soit
utile de reproduire ici les remarques, d’ailleurs en petit nombre, que Jacquemont
a faites sur ces animaux. Les remarques de Jacquemont se résument
d’ailleurs dansjces trois faits, que le Chacal est nocturne, vit par bandes nombreuses,
et est très-craintif et farouche (2).
Il suffira également de renvoyer au Journal, en ce qui concerne les observations,
malheureusement trop peu nombreuses et trop peu précises, que Jacquemont
a faites sur les Chiens de l’Inde (3).
GROUPE DES FELIS,
I . R e m a r q u e s s u r l e s d i v i s i o n s p r o p o s é e s p a r m i l e s i e h s .
M. Frédéric Cuvier,dans son Histoire naturelle des mammifères de la ■ménagerie
du Muséum, est le premier qui, après une analyse rationnelle des.ca-
ractères organiques des Felis de Linné, ait considéré ce groupe comme divisible
en plusieurs genres naturels. Les Guépards, si nettement caractérisés parleurs
ongles non rétractiles, le Chat ordinaire et les autres espèces à pupille allongée,
sont les deux types qu’il a distingués du groupe principal des Felis, c’est-
à-dire, de ceux qui ont la pupille circulaire et les ongles rétractiles. M. Frédéric
Cuvier, en faisant, dès i 832, la distinction de ces deux types, n’a d’ailleurs
proposé ni pour l’un ni pour l’autre de dénomination générique. Il ne la point
fait à l’égard des Felis à pupille.allongée, parce quil se proposait de déterminer,
par des observations ultérieures, quelles espèces doivent être rapportées
à ce groupe. On ne peut qu’applaudir à cette réserve inspirée par un vrai sentiment
des besoins de la science. Nous 11e saurions, au contraire, approuver les
motifs fort différents qui ont porté M. Frédéric Cuvier à distinguer et à caractériser,
sans les dénommer, les Felis à ongles non rétractiles. Ce motif est 1 existence.
d’une seule espèce authentique, présentant ce caractère : circonstance
qui, selon les vrais principes de la méthode naturelle, est, je ne dirai pas seulement
d’une faible importance, mais absolument de nulle valeur. Dans la
formation des genres aussi bien que dans 1 établissement des groupes d un degré
supérieur ,1e nombre des espèces est une considération tout a fait accessoire.
(1) Sur les HyèneS, voyez la troisième partie du Journal, tom. I, p. 25o et 3o o ; et la sixième, tom. III, p. 33o.
(à) Voyez les passages déjà cités du Journal.
(3) V oyez troisième partie, tom. I, p. a5o, etquatrièmè, tom. II , p. * 10.
un genre, quel qu’il soit, ne peut être fractionné, s'il est vraiment naturel, et
si toutes ses espèces, fussent-elles au nombre de mille, ont entre elles des affinités
véritablement spécifiques: dans le cas contraire,, c’est-à-dire, si les caractères
de valeur générique, et si les habitudes qui concordent toujours avec
ceux-ci, ne sont pas les mêmes, les espèces, n’en existât-il que deux, doivent
nécessairement • être séparées.
Tandis que M. Frédéric Cuvier, par une réserve que. l’ou est en droit de
trouver un peu exagérée, croyait devoir caractériser, sans les dénommer, de
nouveaux groupes génériques, plusieurs zoologistes américains, anglais et allemands
ont fait l’inverse. Us ont proposé de nouvelles dénominations génériques
pour certains Felis, le plus souvent sans faire l’analyse, et sans discuter la valeur
des caractères distinctifs sur lesquels ils se fondaient. Il est des auteurs qui
n o n t pas indiqué à la suite des noms proposés par eux, un seul trait caractéristique;
et parfois même on a laissé au lecteur à deviner les espèces auxquelles
de nouveaux noms sont appliqués, aussi bien que les motifs pour lesquels elles
sont séparées des autres Felis.
• Les noms successivement proposés pour divers groupes démembrés des Felis
de Linné, sont les suivants :
i i° Léo, proposé par M. Leach (ï) et admis par M. William Jardine (a) et
par.M. Swainson (3). Ce groupe comprendrait deux espèces : ,Leo africanus
de MM. Jardine et Swainson; et L. asiaticus de M. Jardine.
2° P u m a . Ce groupe, proposé en t834 par. M. Jardine (4), renfermerait six
espèces : Puma concolor,P. nigra, P. Yaguaruridi, P. Eyra, P. Pajeros et (avec
doute) P. chalybeata.
3° Gtna i l u r u s , proposé en i83o parM. Wagler (5); et adopté par MM. Jardine
et Swainson pour le Guépard. En introduisant ce nom dans la science en
i83o,M. Wagler se borneà dire que le Felis jubata de Linné est le type de son
genre Cynailurus, et il ne dit pas quels caractères doivent être assignés à ce
nouveau groupe. Toutefois, le nom qu’il a choisi, ne laisse pas de doute que la
non-rétractilité des Ongles, et les remarques faites sept ans auparavant par
M. Frédéric Cuvier sur ce caractère et sur la similitude des ongles du Chien et
de ceux du Guépard, ne soient les bases sur lesquelles M. Wagler avait fondé
la séparation générique de ce dernier carnassier.
■< j II™ aa ta ^ po ssible de me procurer le travail de Leach , et même d’en connaître exactement la date.
(3) f ) € n.atUral hùt° r r ° f the Fclina, puyrage faisant partie de The naturalisas library, i vol. in -ia . Édimb. i 83a1
in -12 ; and Classïfication ° f Qwdrupeds, ouvrage faisant partie de The cabinet Cyclopoedia, un vol-
• ;(4) Loc. cit.
(5) Voyez le prodrome de la classificatidç d e f kammifères, placé en Sic du Jfatürliche System der Jmphibien; Munich,
5.