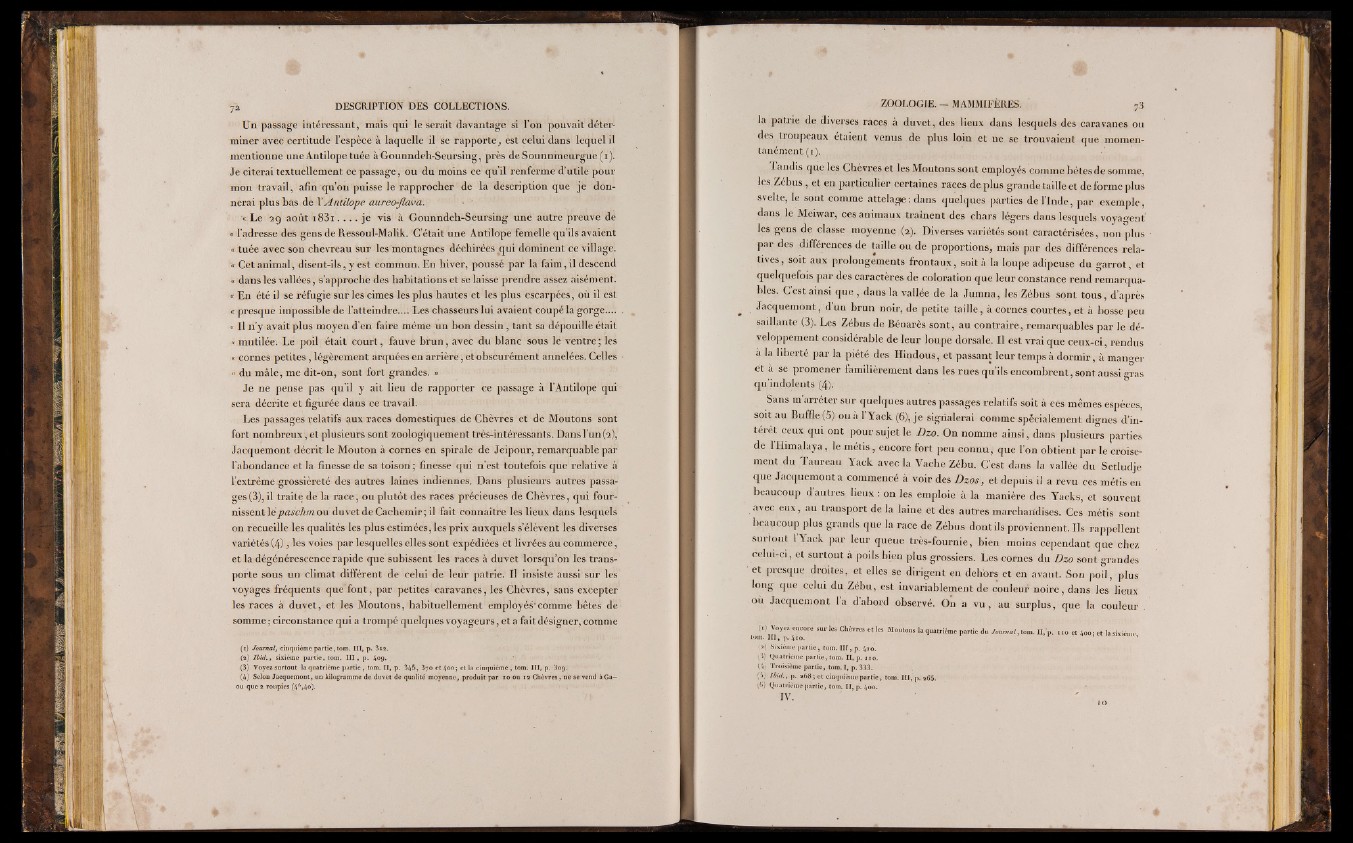
Un passage intéressant, mais qui le serait davantage si l’on pouvait déterminer
avec certitude l’espèce à laquelle il se rapporte, est celui dans lequel il
mentionne une Antilope tuée àGounndeh-Seursing, près de Sounnmeurgue (i).
Je citerai textuellement ce passage, ou du moins ce qu’il renferme d’utile pour
mon travail, afin qu’on puisse le rapprocher de la description que je donnerai
plus bas de X Antilope aureo-flava. • '
« Le 29 août i 8 3 i . . . . je vis à Gounndeh-Seursing une autre preuve de
« l’adresse des gens de Ressoul-Malik. C’était une Antilope femelle qu’ils avaient
« tuée avec son chevreau sur les montagnes déchirées tqui dominent ce village.
« Cet animal, disent-ils, y est commun. En hiver, poussé par la faim, il descend
« dans les vallées, s’approche des habitations et se laisse prendre assez aisément.
« En été il se réfugie sur les cimes les plus hautes et les plus escarpées, où il est
« presque impossible de l’atteindre.... Les chasseurs lui avaient coupé la gorge....
« Il n’y avait plus moyen d’en faire même un bon dessin, tant sa dépouille était
« mutilée. Le poil était court, fauve brun, avec du blanc sous le ventre ; les
« cornes petites, légèrement arquées en arrière, et obscurément annelées. Celles
« du mâle, me dit-on, sont fort grandes. »
Je ne pense pas qu’il y ait lieu de rapporter ce passage à l’Antilope qui
sera décrite et figurée dans ce travail.
Les passages relatifs aux races domestiques de Chèvres et de Moutons sont
fort nombreux, et plusieurs sont zoologiquement très-intéressants. Dans l’un (2),
Jacquemont décrit le Mouton à cornes en spirale de Jeipour, remarquable par
l’abondance et la finesse de sa toison; finesse qui n’est toutefois que relative à
l'extrême grossièreté des autres laines indiennes. Dans plusieurs autres passages
(3), il traite de la race, ou plutôt des races précieuses de Chèvres, qui fournissent
lé paschmoxi duvet de Cachemir ; il fait connaître les lieux dans lesquels
on recueille les qualités les plus estimées, les prix auxquels s’élèvent les diverses
variétés(4), les voies par lesquelles elles sont expédiées et livrées au commerce,
et la dégénérescence rapide que subissent les races à duvet lorsqu’on les transporte
sous un climat différent de celui de leur patrie. Il insiste aussi sur les
voyages fréquents que font, par petites caravanes, les Chèvres, sans excepter
les races à duvet, et les Moutons, habituellement employés*comme bêtes de
somme ; circonstance qui a trompé quelques voyageurs, et a fait, désigner, comme
(1) Journal, cinquième partie, tom. III, p. 3ia .
(a) Ibid., sixième partie, tom. I I I , p. 409.
(3) Voyez surtout la quatrième partie, tom. II, p. 345, 370 et 400; et la cinquième , tom. III, p. 309.
(4) Selon Jacquemont, un kilogramme de duvet de qualité moyenne, produit par 10 ou ta Chèvres, ne se vend àGa—
ou que a roupies (4f‘,4o). :
la patrie de diverses races à duvet, des lieux dans lesquels des caravanes ou
des troupeaux étaient venus de plus loin et ne se trouvaient que momentanément
(1). . m . ¿ â v , .. j. .. •'
tandis que les Chèvres et les Moutons sont employés comme hétesde somme,
les Zébus , et en particulier certaines races déplus grande taille et de forme plus
svelte, le sont comme attelage: dans quelques parties de l’Inde, par exemple,
dans le Meiwar, ces animaux trament des chars légers dans lesquels voyagent
les gens de classe moyenne (2). Diverses variétés sont caractérisées, non plus
par des différences de taille ou de proportions, mais par des différences relatives,
soit aux prolongements frontaux, soit à la loupe adipeuse du garrot, et
quelquefois par des caractères de coloration que leur constance rend remarquables.
Cest ainsi que , dans la vallée de la Jumna, les Zébus sont tous, d’après
Jacquemont, d un brun noir, de petite taille, à cornes courtes, et à bosse peu
saillante (3). Les Zébus de Bénarès sont, au contraire, remarquables par le développement
considérable de leur loupe dorsale. Il est vrai que ceux-ci, rendus
à la liberté par la piété des Hindous, et passant leur temps a dormir, à manger
et à se promener famibèrement dans les rues qu’ils encombrent, sont aussi gras
qu’indolents (4).
Sans m’arrêter sur quelques autres passages relatifs soit à ces mêmes espèces,
soit au Buffle (5) ou à 1 Yack (6), je signalerai comme spécialement dignes d’intérêt
ceux qui ont pour sujet le Dzo. On nomme ainsi, dans plusieurs parties
de IHimalaya, le métis, encore fort peu connu, que l’on obtient par le croisement
du Taureau Yack avec la Vache Zébu. C’est dans la vallée du Setludje
que Jacquemont a commencé à voir des Dzos, et depuis il a revu ces métis en
beaucoup d autres lieux : on les emploie à la manière des Yacks, et souvent
avec eux, au transport de la laine et des autres marchandises. Ces métis sont
beaucoup plus grands que la race de Zébus dont ils proviennent. Ils rappellent
surtout l’Yack par leur queue très-fournie, bien moins cependant que chez
celui-ci, et surtout à poils bien plus grossiers. Les cornes du Dzo sont grandes
et presque droites, et elles se dirigent en dehors et en avant. Son poil, plus
long que celui du Zébu, est invariablement de couleur noire, dans les lieux
où Jacquemont la d abord observé. On a vu , au surplus, que la couleur
lum \ u 0yeZ4” C0r' SUrlCS ChèVreS * * leS Moulons ' a quatrième partie du Journal, tom. II , p. 110 et 400; et la sixième,
(a) Sixième partie , fom. I I I , p. 410.
^3) Quatrième partie, tom. II, p. 110.
(4} Troisième partie, tom. I, p. 333.
(:») 1 bid, , p. a68 ; et cinquième partie, tom. I II, p. a65.
(i>) Quatrième partie, loin. II, p. 400.