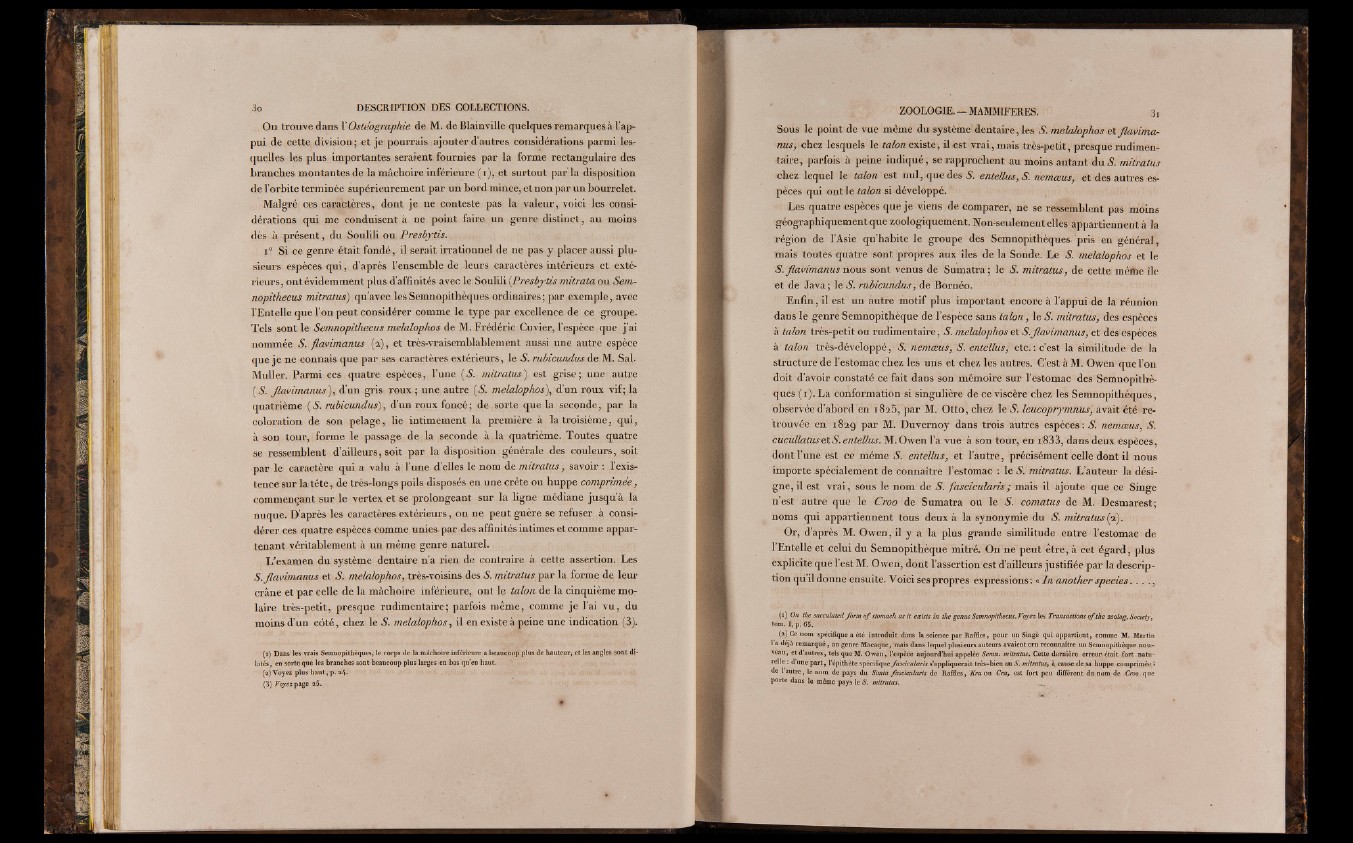
On trouve dans l’Ostéographie de M. de Blainville quelques remarques à l’appui
de cette division; et je pourrais ajouter d’autres considérations parmi lesquelles
les plus importantes seraient, fournies par la forme rectangulaire des
branches montantes de la mâchoire inférieure £ i);i et surtout par la disposition
de l’orbite terminée supérieurement par un bord mince, et non par un bourrelet.
Malgré ces caractères, dont je ne conteste pas la valeur, voici les considérations
qui me conduisent à ne point faire un genre distinct, au moins
dès à présent, du Soulili ou Presbytis.
i° Si ce genre était fondé, il serait irrationnel de ne pas y placer aussi plusieurs
espèces qui, d’après l’ensemble de leurs caractères intérieurs et extérieurs,
ont évidemment plus d’affinités avec le Soulili (Presbytis mitrataon Sem-
nopithecus mitratus) qu’avec les Semnopithèques ordinaires ; par exemple, avec
l’Entelle que l’on peut considérer comme le type par excellence de ce groupe.
Tels sont le Semnopithecus melalophos de M. Frédéric Cuvier, l’espèce que j’ai
nommée S. flavimanus (a), et très-vraisemblablement aussi une autre espèce
que je ne connais que par ses caractères extérieurs, le S. rubicundus de M. Sal.
Muller. Parmi ces. quatre, espèces, l’une (S. mitratus) est grise; une autre
(S. flavimanus), d’un gris roux; une autre (S. melalophos), d’un roux vif; la
quatrième (S. rubicundus), d'un roux foncé; de sorte que la seconde, par la
coloration de son pelage, lie intimement la première à la troisième, qui,
à son tour, forme le passage de la seconde à la quatrième. Toutes quatre
se ressemblent d’ailleurs, soit par la disposition générale des couleurs, soit
par le caractère qui a valu à l’une d’elles le nom de mitratus, savoir : l’existence
sur la tête, de très-longs poils disposés en une crête ou huppe comprimée,
commençant sur le vertex et se prolongeant sur la ligne médiane jusqu’à la
nuque. D’après les caractères extérieurs, on ne peut guère se refuser à considérer
ces quatre espèces comme unies par des affinités intimes et comme appartenant
véritablement à un même genre naturel.
L’examen du système dentaire n’a rien de contraire à cette assertion. Les
S. flavimanus et S. melalophos, très-voisins des S. mitratus par la forme de leur
crâne et par celle de la mâchoire inférieure, ont le talon de la cinquième molaire
très-petit, presque rudimentaire; parfois même, comme je l’ai vu, du
moins d’un côté, chez le S. melalophos, il en existe à peine une indication (3).
( i) Dans les vrais Semnopithèques, le corps de la mâchoire inférieure a beaucoup plus de hauteur, et lès angles sont dilatés,
en sorte que les branches sont beaucoup plus larges en bas qu’en haut.
’ :(a) Voyez plus haut; p. 24.
(3) Voyez page a5.
Sous le point de vue même du système dentaire, les S. melalophos et flavimanus,
chez lesquels le talon existe , il est vrai, mais trèspetit, presque rudimentaire,
parfois à peine indiqué, se rapprochent au moins autant duô'. mitratus
chez lequel le talon est nul, que des S. entellus, S. nemoeus, et des autres espèces
qui ont le talon si développé.
Les quatre espèces que je viens de comparer, ne se ressemblent pas moins
géographiquement que zoologiquement. Non-seulement elles appartiennent à la
région de l’Asie qu’habite le groupe des Semnopithèques pris en général,
mais toutes quatre sont propres aux îles de la Sonde. Le S. melalophos et le
S. flavimanus nous sont venus de Sumatra; le S. mitratus, de cette mêttie ile
et de Java; le S. rubicundus, de Bornéo.
Enfin, il est un autre motif plus important encore à l’appui de la réunion
dans le genre Semnopithèque de l’espèce sans talon, le S. mitratus, des espèces
à talon très-petit ou rudimentaire, S. melalophos et S.flavimanus, et deS’espèces
à talon très-développé, S. nemoeus, S. entellus, etc! : c’est la similitude de la
structure de l’estomac chez les uns et chez les autres. C’est à M. Owen que l’on
doit d’avoir constaté ce fait dans son mémoire sur l’estomac des Semnopithè-
quês (i). La conformation si singulière de ce viscère chez les Semnopithèques,
observée d’abord en 1825, par M. Otto, chez le S. leucoprymnus, avait été retrouvée
en 1829 par M. Duvernoy dans trois autres espèces: S. nemoeus, S.
cucullatusetS. entellus. M. Owen l’a vue à son tour, en i 833, dans deux espèces,
dont l’une est ce même S. entellus, et l’autre, précisément celle dont il nous
importe spécialement de connaître l’estomac : le S. mitratus. L’auteur la désigne,
il est vrai, sous le nom de S. fascicularis; mais il ajoute que ce Singe
n’est autre que le Croo de Sumatra où le S. comatus de M. Desmarest;
noms qui appartiennent tous deux à la synonymie du S. mitratus V;.
Or, d’après M. Owen, il y a la plus grande similitude entre l’estomac de
lEntelle et celui du Semnopithèque mitré. On ne peut être, à cet égard, plus
explicite que l’est M. Owen, dont l’assertion est d’ailleurs justifiée par la description
qu il donne ensuite. Voici ses propres expressions: «In another species. . . .',
(1) On the sacculaled form o f stomack as it exists in the genus Semnopithecus. Voyez les Transactions ofthe zoolog. Society,
tom. I, p. 65.
(a) Ce nom spécifique a été introduit dans la science par Raffles, pour un Singe qui appartient, comme M. Martin
1 a déjà remarqué, au genre Macaque, mais-dans lequel plusieurs auteurs avaient cru reconnaître un Semnopithèque.nouveau,
et d autres, tels que M. Owen, l’espèce aujourd’hui appelée Semn. mitratus. Cette dernière erreur-était fort naturelle
: d’une part, l’épithète spécifique fascicularis s’appliquerait très-bien au S. mitratus, ^ cause de sa huppe comprimée!
de 1 autre, le nom de pays du Simia fascicularis de Raffles, Kra ou Cra, est fprt peu différent du nom de Croo. que
porte dans le même pays le S. mitratus.