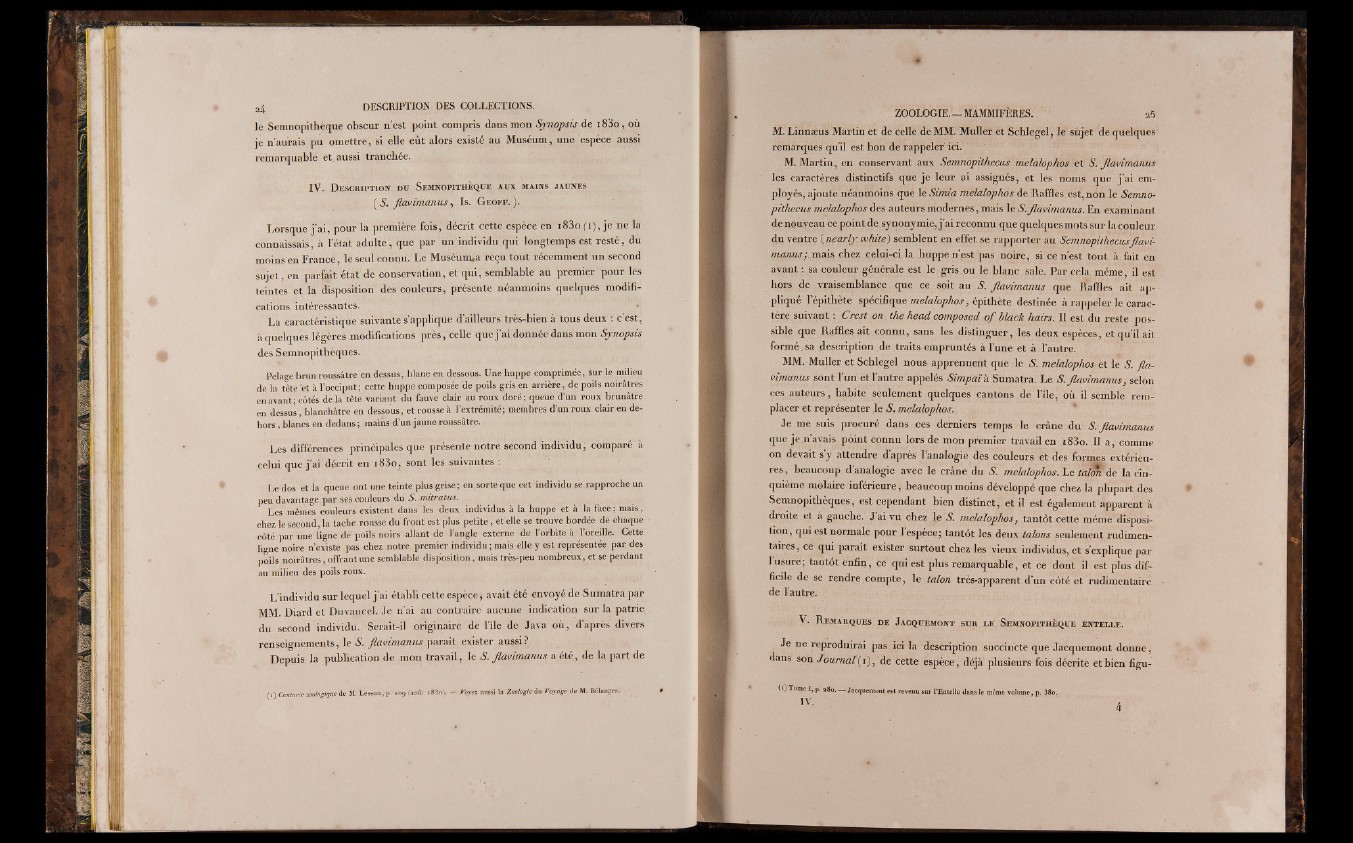
m
I
24 description des collections.
v ■ ; bH g I
le Semnopithèque obscur n’est point compris dans mon Synopsis de 183o , où
je n’aurais pu omettre, si elle eut alors existé au Muséum, une espèce aussi
remarquable et. aussi tranchée.
IV. D e s c r i p t i o n d u S e m n o p i t h è q u e a u x m a i n s j a u n e s
|jp f S. davinianus, Is. G e o f è . ).
Lorsque j ’aifpour la première fois, décrit cette espèce en i 83o.(i), je ne la
connaissais, à l’état adulte, que par un individu qui longtemps est resté, du
moins en France, le seul connu. Le Muséum«a reçu tout récemment un second
sujet, en parfait état de conservation, et qui, semblable au premier pour les
teintes et la disposition des couleurs, présente néanmoins quelques modifi-
cations intéressantes. ♦
La caractéristique suivante s’applique d’ailleurs très-bien à tous deux : c’est,
à quelques légères modifications près, celle que j ’ai donnée dans mon Synopsis
des Semnopithèques.
Pelage brun roussâtre en dessus, blanc en dessous. Une huppe comprimée, Sur le milieu
de la tête et à l’occiput; cette huppe composée de poils gris en arrière, de poils noirâtres
en avant; côtés delà 'tête variant du fauve clair au roux doré; queue d’un roux brunâtre
en dessus, blanchâtre en dessous, et rousse à l’extrémité; membres d’un roux clair en dehors
, blancs en dedans ; mains d’un jaune roussâtre.
Les différences principales que présente notre second individu, comparé à
celui que j ’ai décrit en i 83o; sont les suivantes :
Le dos et la queue ont une teinte plus grise ; en sorte que cet individu se rapproche un
peu davantage.par ses couleurs du. N. mitratus. , ,
Les mêmes couleurs existent dans les deux individus à la huppe et à la face ; mais,
c h e z le second, la tache rousse du front est plus petite , et elle se trouve bordée de chaque
côté par une ligne dé poils noirs allant de l’angle externe de l’orbite à l’oreille. Cette
ligne noire n’existe pas chez notre premier individu ; mais elle y est représentée par des
poils noirâtres, offrant une semblable disposition , mais très-peu nombreux, et se perdant
au milieu: des poils roux.
L’individu sur lequel j ’ai établi cette espèce, avait été envoyé de Sumatra par
MM. Diard et Duvaucel. Je n’ai au contraire aucune indication sur la patrie
du second individu. Serait-il originaire de l’île de Java où, d’après divers
renseignements, le S. flavimanus paraît exister aussi?
Depuis la publication de mon travail, le S. flavimanus a été, de la part de
( ,) Centurie zoologiqm 4e M. Lesson, p. 109 (àroÛi i 83iitfl'i- royez aussi la Zoologie du rcyagz de M. Bélanger.
■H
M. Linnæus Martin et de cellé de MM. Muller et Schlegel, Je sujet de quelques
remarques qu’il est bon de rappeler ici.
M. Martin, en conservant aux Semnopithecus melalophos eX S. flavimanus
les caractères distinctifs que je leur ai assignés, et les noms que j ’ai employés,
ajoute néanmoins que le Sirnia mèlalophos de Raffles. est, non le Semnopithecus
melalophos des auteurs modernes, mais le S.flavirnanus. Eii examinant
de nouveau ce point de synonymie, j ’ai reconnu que quelques mots sur la couleur
du ventre [nparly white) semblent en effet se rapporter au Semnopithecus flavimanus
chez celui-ci la huppe .n’est pas noire, si ce n’est tout àfait en
avant : sa couleur générale est le gris.ou le blanc sale. Par cela même, il est
hors de vraisemblance que ce soit au S. flavimanus que. Raffles ait appliqué
Fépithète spécifique melalophos, épithète destinée , à rappeler le caractère
suivant : Ci-est on.the head composed o f black hairs. Il est du reste possible
que Raffles ait connu, sans les distinguer, les deux espèces, et qu’il ait
formé ; sa description de traits empruntés à l’une et à l’autre.
MM. Mujler et Schlegel nous apprennent que le S. melalophos et le S. fla-
vifnanus sont l’un et l’autre appelés Simpaïk Sumatra. Le S. flavimanus, selon
ces auteurs, habite seulement quelques.cantons de l’île, où il semble remplacer
et représenter ,1e S. melalophos.
Je me suis procuré dans,ces derniers temps le crâne du S. flavimanus
que je.n’avais point connu lors de mon premier travail en i 83o. Il a, comme
on devait s’y attendre d’après l’analogie des couleurs et: des formes extérieures,
beaucoup d’analogie avec le crâne du & melalophos. Le talmàe la cinquième
molaire inférieure, beaucoup moins développé que chez la plupart des
Semnopithèques, est cependant bien distinct, et il est également apparent à
droite et à gauche. J ai vu chez le S. melalophos, tantôt cette même disposition,
qui est normale pour 1 espèce; tantôt les deux talons seulement rudimentaires,
ce qui paraît exister surtout chez les vieux individus, et s’explique par
1 usure; tantôt enfin, ce qui est plus remarquable, et ce dont il est plus difficile
de se rendre:compte, le talon très-apparent.d’un côté et rudimentaire,
de l’autre.
V. R e m a r q u e s d e J a c q u e m o n t s u r l e S e m n o p i t h è q u e e n t e l l e .
Je ne reproduirai pas ici la description succincte que Jacquemont donne,
ans son Joumal\i) , dé cette espèce , déjà plusieurs fois décrite et bien figu-
( i) Tome I , p. »80. — Jacquemont est revenu sur l'Entelle dans le même volume, p. 38o.
IV.