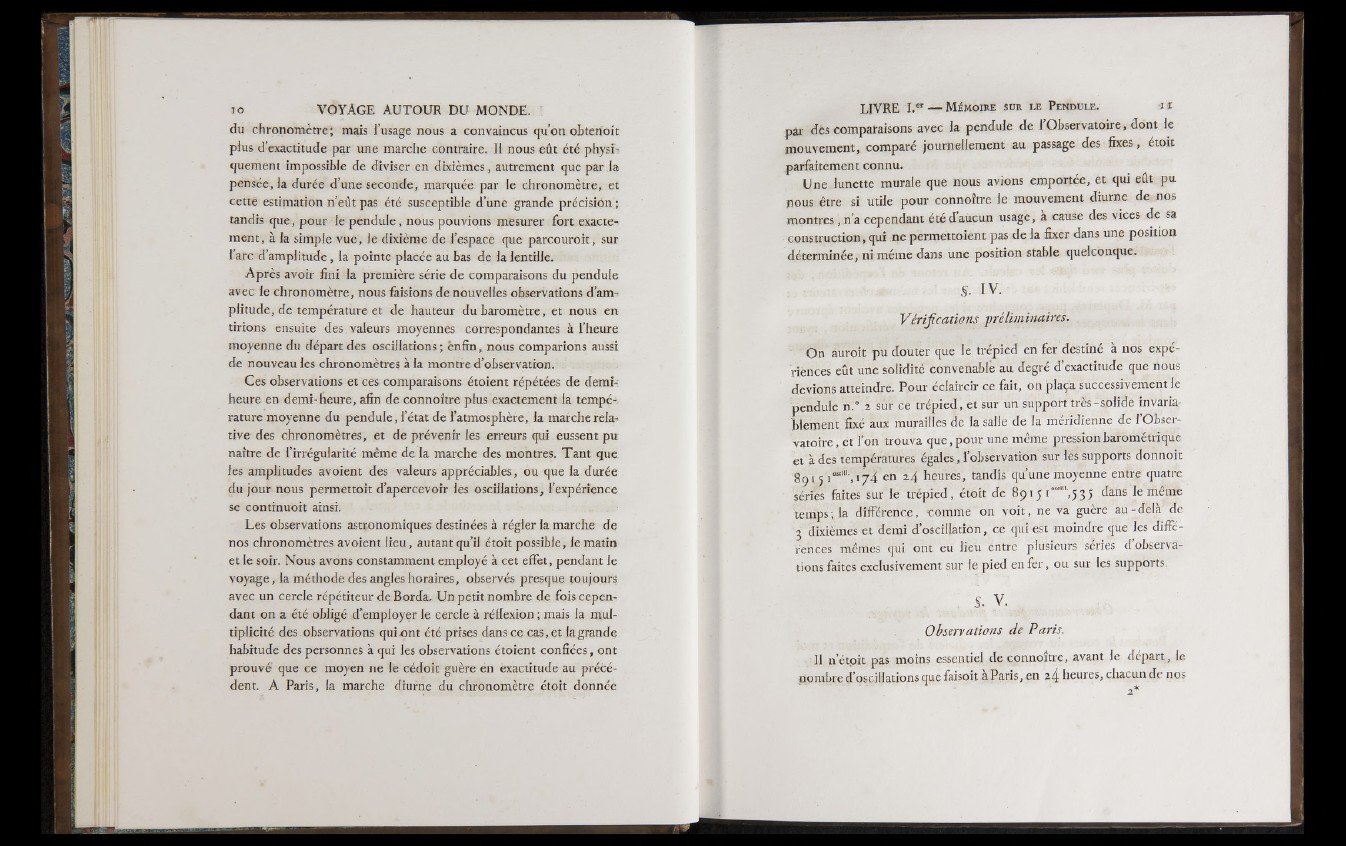
du chronomètre; mais l’usage nous a convaincus qu’on obtenoit
plus d’exactitude par une marche contraire. 11 nous eût été physiquement
impossible de diviser en dixièmes, autrement que par la
pensée, la durée d’une seconde, marquée par le chronomètre, et
cette estimation n’eût pas été susceptible d’une grande précision ;
tandis que, pour le pendule, nous pouvions mesurer fort exactement,
à la simple vue, le dixième de l’espace que parcouroit, sur
l’arc d’amplitude, la pointe placée au bas de la lentille.
Après avoir fini la première série de comparaisons du pendule
avec le chronomètre, nous faisions de nouvelles observations d’amplitude,
de température et de hauteur du baromètre, et nous en
tirions ensuite des valeurs moyennes correspondantes à l’heure
moyenne du départ des oscillations ; ènfin, nous comparions aussi
de nouveau les chronomètres à la montre d’observation.
Ces observations et ces comparaisons étoient répétées de demi-
heure en demi-heure, afin de connoître plus exactement la température
moyenne du pendule, l’état de l’atmosphère, la marche relative
des chronomètres, et de prévenir les erreurs qui eussent pu
naître de l’irrégularité même de la marche des montres. Tant que
les amplitudes avoient des valeurs appréciables, ou que la durée
du jour nous permettoit d’apercevoir les oscillations, l’expérience
se continuoit ainsi.
Les observations astronomiques destinées à régler la marche de
nos chronomètres avoient lieu , autant qu’il étoit possible, le matin
et le soir. Nous avons constamment employé à cet effet, pendant le
voyage, la méthode des angles horaires, observés presque toujours
avec un cercle répétiteur de Borda. Un petit nombre de fois cependant
on a été obligé d’employer le cercle à rcHexion ; mais la multiplicité
des observations qui ont été prises dans ce cas, et la grande
habitude des personnes à qui les observations étoient confiées, ont
prouvé que ce moyen ne le cédoit guère en exactitude au précédent,
A Paris, la marche diurne du chronomètre étoit donnée
par des comparaisons avec la pendule de l’Observatoire, dont le
mouvement, comparé journellement au passage des fixes, étoit
parfaitement connu.
Une lunette murale que nous avions emportée, et qui eût pu
nous être si utile pour connoître le mouvement diurne de nos
montres, n’a cependant été d’aucun usage, à cause des vices de sa
construction, qui ne permettoient pas de la fixer dans une position
déterminée, ni même dans une position stable quelconque.
S. IV .
Vérifications préliminaires.
On auroit pu douter que le trépied en fer destiné à nos expériences
eût une solidité convenable au degré d’exactitude que nous
devions atteindre. Pour éclaircir ce fait, on plaça successivement le
pendule n.° z sur ce trépied, et sur un support très-solide invariablement
fixé aux murailles de la salle de la méridienne de l’Observatoire
, et l’on trouva que, pour une même pression barométrique
et à des températures égales, l’observation sur les supports donnoit
891 5 en 24 heures, tandis qu’une moyenne entre quatre
séries faites sur le trépied, étoit de 8 9 1 5 35 dans le même
temps; la différence, comme on voit, ne va guère au-delà de
3 dixièmes et demi d’oscillation, ce qui est moindre que les différences
mêmes qui ont eu lieu entre plusieurs sériés d observations
faites exclusivement sur le pied en fe r , ou sur les supports.
S. V.
Observations de Paris.
11 n’ctpit pas moins essentiel de connoître, avant le départ, le
nombre d’oscillations que faisoit a Paris, en z 4 heures, chacun de nos