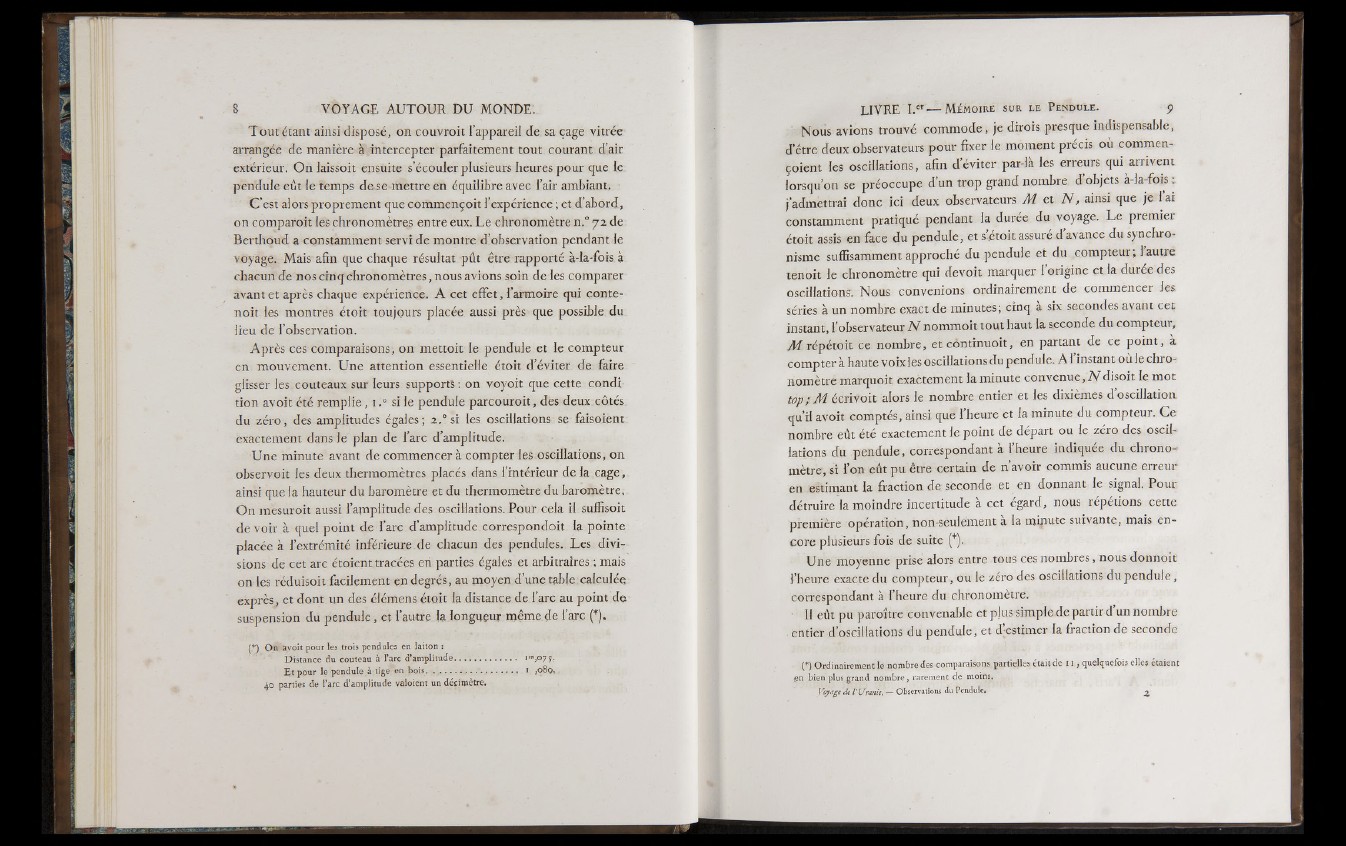
T out étant ainsi disposé, on couvroit l’appareil de sa cage vitrée
arrangée de manière à intercepter parfaitement tout courant d’air
extérieur. On iaissoit ensuite s’écouler plusieurs heures pour que le
pendule eût le temps de se mettre en équilibre avec l’air ambiant.
C ’est alors proprement que commençoit l’expérience ; et d’abord,
on comparoit les chronomètres entre eux. L e chronomètre n.° 72 de
Berthoud a constamment servi de montre d’observation pendant le
voyage. Mais afin que chaque résultat pût être rapporté à-la-fois à
chacun de nos cinq chronomètres, nous avions soin de les comparer
avant et après chaque expérience. A cet effet, l’armoire qui conte-
noit les montres étoit toujours placée aussi près que possible du
lieu de l’observation.
Après ces comparaisons, on mettoit le pendule et le compteur
en mouvement. Une attention essentielle étoit d’éviter de faire
glisser les couteaux sur leurs supports ; on voyoit que cette condition
avoit été remplie, 1 si le pendule parcouroit, des deux côtés
du zéro, des amplitudes égales; 2,° si les oscillations se faisoient
exactement dans le plan de l’arc d’amplitude.
Une minute avant de commencer à compter les oscillations, on
observoit les deux thermomètres placés dans l’intérieur de la cage,
ainsi que la hauteur du baromètre et du thermomètre du baromètre.
On mesuroit aussi l’amplitude des oscillations. Pour cela il suffisoit
de voir à quel point de l’arc d’amplitude correspondoit la pointe
placée à l’extrémité inférieure de chacun des pendules. Les divisions
de cet arc étoient tracées en parties égales et arbitraires ; mais
on les réduisoit facilement en degrés, au moyen d’une table calculée
exprès, et dont un des élémens étoit la distance de l’arc au point de
suspension du pendule, et l’autre la longueur même de l’arc 7).
(*) On avoit pour les trois pendules en laiton :
Distance du couteau à l’ arc d’ amplitude...............
E t pour le pendule à tige en b o is..............................
40 parties de l’ arc d’ amplitude valoient un décimètre.
i%07 5-
I ,o8q,
Nous avions trouvé commode, je dirois presque indispensable,
d’être deux observateurs pour fixer le moment précis où commen-
çoient les oscillations, afin d’éviter par-là les erreurs qui arrivent
lorsqu’on se préoccupe d’un trop grand nombre d objets à-Ia-fois.
j’admettrai donc ici deux observateurs M et N , ainsi que je l’ai
constamment pratiqué pendant la durée du voyage. L e premier
étoit assis en face du pendule, et s’étoit assuré d avance du syncliro-
nisme suffisamment approché du pendule et du compteur; 1 autre
tenoit le chronomètre qui devoit marquer l’origine et la durée des
oscillations. Nous convenions ordinairement de commencer les
séries à un nombre exact de minutes; cinq à six secondes avant cet
instant, l’observateur N nommoit tout haut la seconde du compteur,
rcpétoit ce nombre, etcontinuoit, en partant de ce point, à
compter à haute voix les oscillations du pendule. A i instant où le chronomètre
marquoit exactement la minute convenue,Ndisoit le mot
top ; M é cm o ït alors le nombre entier et les dixièmes d’oscillation
qu’il avoit comptés, ainsi que 1 heure et la minute du compteur. Ce
nombre eût été exactement le point de depart ou le zero des oscillations
du pendule, correspondant à l’heure indiquée du chronomètre,
si l’on eût pu être certain de n’avoir commis aucune erreur
en estimant la fraction de seconde et en donnant le signal. Pour
détruire la moindre incertitude à cet égard, nous répétions cette
première opération, non-seulement à la minute suivante, mais encore
plusieurs fois de suite f) .
Une moyenne prise alors entre tous ces nombres, nous donnoit
l’heure exacte du compteur, ou le zéro des oscillations du pendule,
correspondant à l’heure du chronomètre.
Il eût pu paroître convenable et plus simple de partir d’un nombre
entier d’oscillations du pendule, et d’estimer la fraction de seconde
(’“) Ordinairement le nombre des comparaisons partielles était de 1 1 , quelquefois elles étaien t
en bien plus grand nombre, rarement de moins.
Voj'age de VUranie, — Observations du Pendule, ^