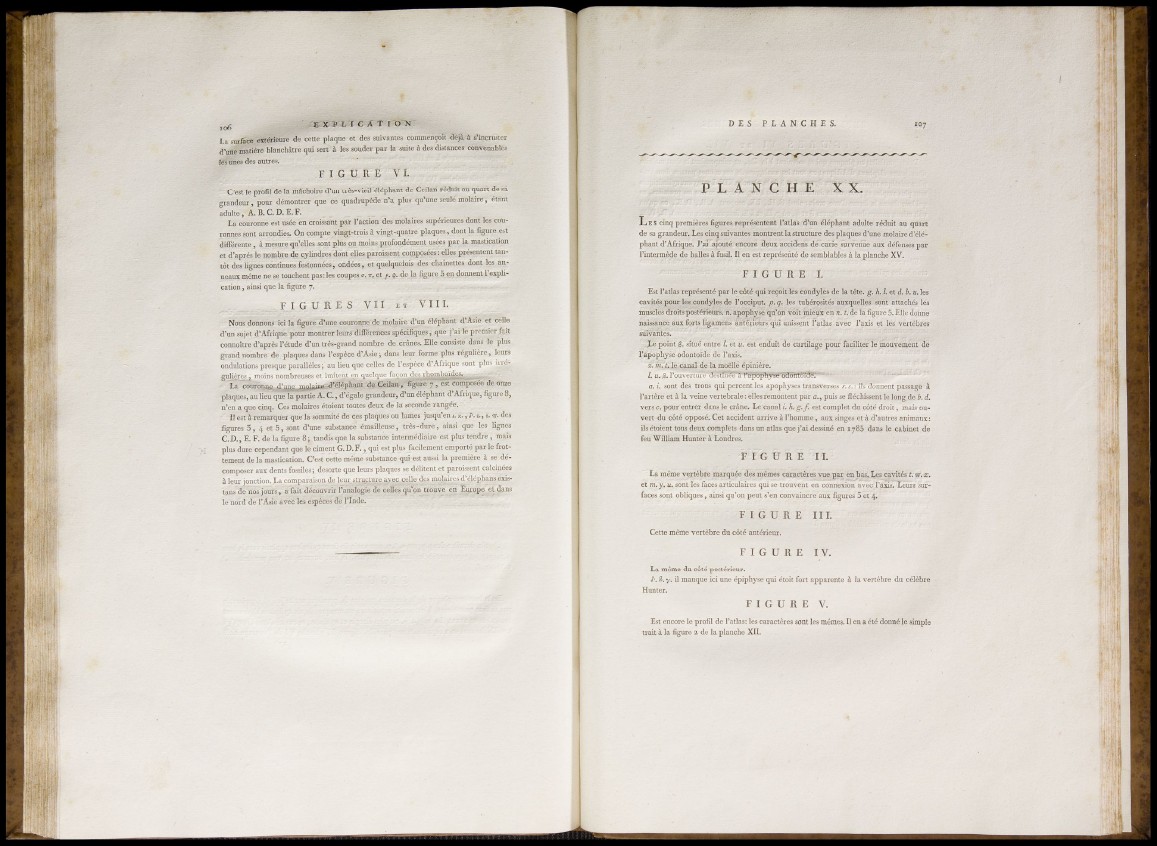
1'
l i ' ^ ''
I >
106
E X P L I C A T I O N
La surface extérieure de cette plaque et des suivantes comniençoit déjà à s'incnistcr
d ' u n e matière b l a n c h â t r e qui sert à les souder p a r la suite à des distances convenables
les unes des autres.
F I G U R E VI.
C'est le profil de l a mâchoire d ' u n très-vieil éléphant de Ceilan r é d u i t au q u a r t de sa
g r a n d e u r , pour démontrer que ce quadrupède n ' a plus qu'une seule m o l a i r e , étant
a d u l t e , A. 13. C. D. E. F.
La couronne est usée en croissant p a r l ' a c t i o n des molaires supérieures dont les couronnes
sont arrondies. On compte v i n g t - t r o i s à v i n g t - q u a t r e p l a q u e s , dont l a figure c=x
d i f f é r e n t e , à mesure qu'elles sont plus ou moins p r o f o n d é m e n t usées p a r la mastication
et d ' a p r è s le nombre d e cylindres dont elles paroissent composées: elles présentent t a n -
tôt des lignes continues festonnées, o n d é e s , et quelquefois des chaînettes dont les anneaux
même ne se touchent p a s : l e s coupes tr. T. e t f. d e l a iigure 5 en donnent l ' e x p l i -
c a t i o n , ainsi que la l i g u r e 7.
F I G U R E S V I I ET V I I I.
Nous donnons ici l a figtsie d ' u n e couronne de molaire d'un éléphant d'Asie et celle
d ' u n sujet d ' A f r i q u e pour montrer leurs diiTércnces spécifiques, que j'ai le p r e m i e r f a it
connoître d ' a p r è s l ' é t u d e d ' u n t r è s - g r a n d nombre de crânes. E l l e consiste dans le plus
g r a n d nombre de plaques dans l'espèce d'Asie ; dans leur forme plus r é g u l i è r e , leurs
ondulations presque p a r a l l è l e s ; au lieu que celles d e l ' e s p è c e d ' A f r i t i u e sont plus i r r é -
gulières^ moins nombreuses et imitent en quelque f a c on dos ^ l o n i b g i d e s^
La yi^^^^w^-rlVléphant de Ceilan , figure 7 , est composée de onze
plaques, a u lieu q u e la p a r t i e A. C . , d ' é g a l e g r a n d e u r , d ' u n é l é p h a n t d ' A f r i q u e , figure 8,
n ' e n a que cinq. Ces molaires étoient toutes deux de l a seconde r a n g é e.
Il est à r e m a r q u e r que l a sommité de ces p l a q u e s ou lames j u s q u ' e n x , . , S", e., 0. ir. des
ligures 3 , 4 et 5 , sont d'une substance émailleuse, t r è s - d u r e , ainsi que les lignes
C. D . , E. F. d e la figure 8 ; t a n d i s que la substance i n t e r m é d i a i r e est plus t e n d r e , mais
plus d u r e cependant que l e ciment G. D. F . , qui est plus facilement emporté p a r le f r o t -
tement de l a mastication. C'est cette même substance qui est aussi la p r e m i è r e à se décomposer
aux dents fossiles; desorte que leurs plaques se d é l i t e n t et paroissent calcinées
à l e u r jonction. L a comparaison de leur structure a v e c c e l b d c s molaires d ' é l é p h a u s existans
d e nos j o u i s , a f a i t d é c o u v r i r l ' a n a l o g i e de celles'qu'on trouve en Europe et dans
l e n o r d de l'Asie a v e c les espèces de l'Inde.
D E S P L A N C H E S .
P L A N C H E X X.
L e s cinq premières figures représentent l ' a t l a s d ' u n é l é p h a n t adulte r é d u i t au quart
de sa grandeur. Les cinq suivantes m o n t r e n t l a s t r u c t u r e des plaques d ' u n e molaire d ' é l é -
phant d ' A f r i q u e . J'ai ajouté encore deux accidens de c a r i e survenue aux défenses p ar
l ' i n t e r m è d e de balles à fusil. Il en est r e p r é s e n t é de semblables à l a p l a n c h e XV.
F I G U R E I.
Est l'atlas r e p r é s e n t é p a r le côté qui r e ç o i t les condyles de l a tête. g. h. l. et d. b. u. les
cavités p o u t les condyles de l'occiput, p. q. les tubérosités auxquelles sont attachés les
muscles d i o i t s postérieurs, n. a p o p h y se q u ' o n voit mieux en n. t. de la figure 5. E l l e donne
naissance aux forts ligamens antérieurs qui uiiissent l ' a t l a s avec l'asis et les v e r t è b r es
suivantes.
i - e point S- situé e n t r e l. et u. est enduit de c a r t i l a g e pour faciliter le mouvement de
l ' a p o p h y s e odontoïde de l'axis.
a. m. c. le canal de l a moelle épinière.
l. U.S. l'ouverturc"dJstiTêe'aTapophTSe'ScIÓTírííá^r' '
c. i. sont des trous qui p e r c e n t les apophyses transverses r.s!: îh Jonnent passage à
l ' a r t è r e et à l a v e i n e v e r t e b r a l e : elles r e m o n t e n t p a r i i . , p u i s se fléchissent le l o n g de b. d.
v e r s c. p o u r e n t r e r dans le crâne. Le canal i. h. g . f . est complet du côté d r o i t , mais ouv
e r t du côté opposé. Cet accident a r r i v e à l ' h o m m e , aux singes et à d ' a u l r e s animaux:
ils étoient tous deux complets dans un atlas que j ' a i dessiné en 1785 dans le cabinet de
f e u W i l l i am Hunter à Londres.
F I G U R E II.
La même v e r t è b r e marquée des mêmes c a r a c t è r e s v u e p a r en bas. Les cavités t. w.a:.
et m. y . u. sont les faces a r t i c u l a i r e s qui se t r o u v e n t en connexion avec l ' a i i s . Leurs surfaces
sont o b l i q u e s , ainsi q u ' o n peut s ' e n c o n v a i n c r e aux figures 5 et 4.
F I G U R E I I I.
Cette même v e r t è b r e d u c ô t é a n t é r i e u r.
F I G U R E IV.
La même du c ô t é postérieur.
J^. f3. y. il manque ici une épiphyse qui étoit f o r t a p p a r e n t e à la v e r t è b r e du célèbre
Hunter.
F I G U R E V.
Est encore le profil de l'atlas: les c a r a c t è r e s sont les mêmes. Il e n a é t é donné le simple
t r a i t à l a ligure 1 de l a p l a n c h e XII.
• i l
' - • i l
• ' ff
1 'S
1 '
Mí
• Ij
'ii
'ill
Él