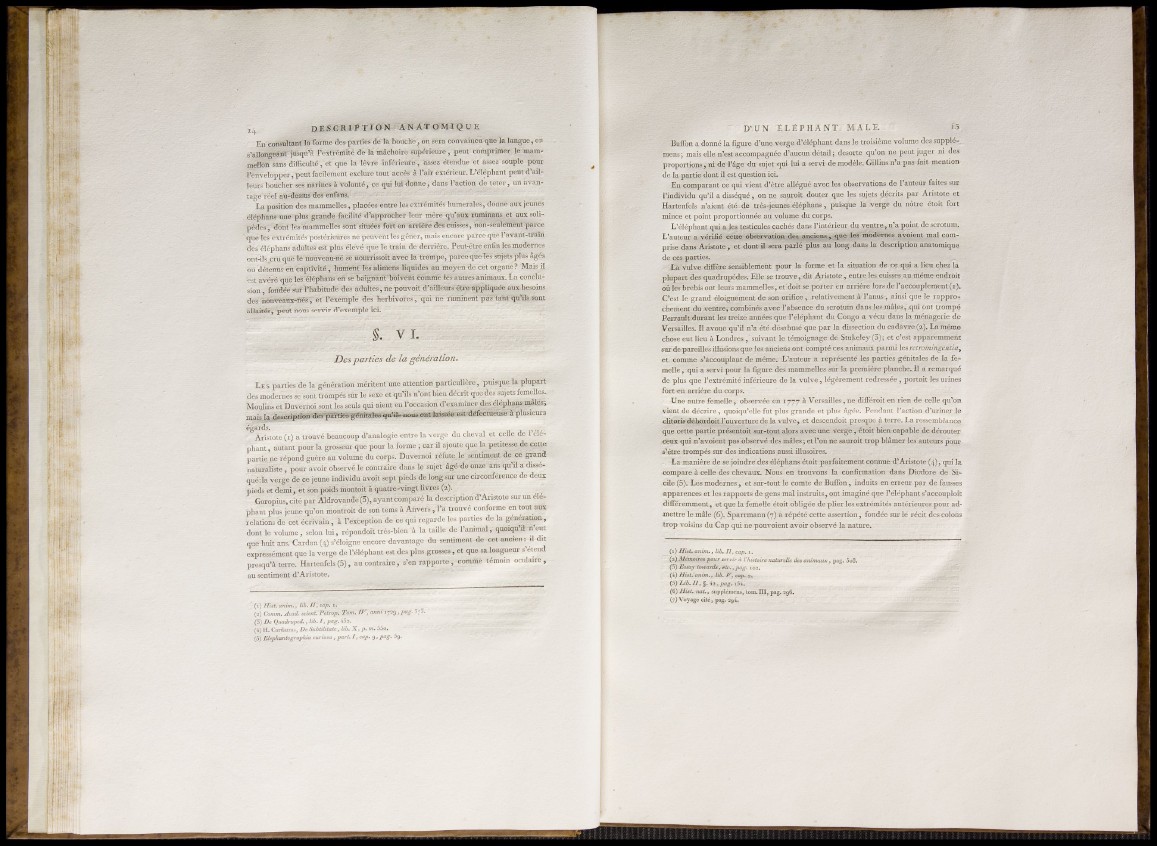
d e s c r i p t i o n a n a t o m i q u e
En consultant !a forme des parties de la boucho, on sera convaincu qne la langue, cn
s'allon-^eant jusqu'à Textrémité de la mâchoire supérieure, peut comprimer le mammellon
sans dilHcuIté, et que la lèvre inférieure, assez étendue et assez souple pour
l'ci'.\ elopper, peut facilement exclure tout accès à l'air extérieur. L'éléphant peut d'ailleurs
boucher ses narines à volonté, ce qui lui donne, dans l'action de teter, un av;iiitage
réel au-dessus des enfaiis.
La position des mammelles, placées entre les extrémités humerales, donne aux jeunes
Oléphans une plus grande facilité d'approcher Icnr mère qu'aux ruminans et aux solipèdes,
dont les mammelles sont situées fort en arrière des cuisses, non-seulement parce
que les extrémités postérieures ne peuvent les gêner, mais encore parce que l'avant-train
des éléphans adultes est plus élevé que le train de derrière. Peut-être enlîn les modernes
ont-ils cru que le nouveau-né se nourrissoit avec la trompe, parce que les sujets plus âgés
ou détenus en captivité, hument les alimens liquides au moyen de cet organe? Mais il
est avéré que les éléphans en se baignant boivent comme les autres animaux. La conclusion
fondée sur l'habitude des adultes, ne pouvoit d'ailleurs êu-e appliquée aux besoins
des nouveaux-nés, et l'exemple des herbivores, qui ne ruminent pas tant qu'Ds sont
allaités, peut nous servir d'exemple ici.
§. V I .
Des parties de la génération.
LE S parties de la génération méritent une attention particulière, puisque la plupart
des modernes se sont trompés sur le sexe et qu'ils n'ont bien décrit que des sujets femelles.
Moulins et Duvernoi sont les seuls qui aient eu l'occasion d'examiner des éléphans mâlcs^
mais la description des parties gériitalee qu'ik, nous ont laissée est défectueuse à plusieurs
''^Aristote ( i ) a trouvé beaucoup d'analogie entre la verge du cheval et celle de l'clcphant,
autant pour la grosseur que pour la forme ; car il ajoute que la petitesse de cette
partie ne répond guère au volume du corps. Duvernoi réfute le sentiment de ce grand
naturaliste, pour avoir observé le contraire dans le sujet âgé de onze ans qu'il a disséquera
verge de ce jeune individu avoit sept pieds de longsur une circonférence de dcui
pieds et demi, et son poids montoit à quatre-vingt livres (a).
Goropius, cité par Aldrovande (5), ayant comparé la description d'Aristote sur un éléphant
plus jeune qu'on montroit de son tems à Anvers, l'a trouvé conforme en tout aux
relations de cet écrivain, à l'exception de ce ciui regarde les parties de la générauou,
dont le volume, selon lui, répondoii très-bien à la taille de l'animal, quoiqu'il n'eut
qr.c huit ans. Cardan(4) s'éloigne encore davantage du sentiment de cet ancien: .1 dit
expressément que la verge de l'éléphant est des plus grosses, et que sa longueur s'etend
presqu'à terre. Hartenfels ( 5 ) , au contraire, s'en rapporte, comme témoin oculaire,
au sentiment d'Aristote.
• (1) IlUt. anim., Uh. II, cap. 1.
(2) Comm-Jcad. M-Uni. Vclrop. Tom. IV, annil'i , p
(3) De Quadruptd., hb. I, pag. 432.
(i) II. C'ardami-,, De HabiiltUtte, lib. X, p. rn. 5jo.
(5) El'pliantugraphia curiosa , pari. I, mp. y^ pag. Sg.
D ' U N É L É P H A N T M A L E . i5
Builbn a donné la figure d'une verge d'éléphant dans le troisième volume des supplémens
; mais elle n'est accompagnée d'aucun détail ; dcsorte qu'on ne peut juger ni des
proportions, ni de l'âge du sujet qui lui a servi de modèle. Gillius n'a pas fait mention
de la partie dont il est question ici.
En comparant ce qui vient d'etre allégué avec les observations de l'auteur faites sur
l'individu qu'il a disséqué, on ne saui'oit douter que les sujets décrits par Aristote et
Hartenfels n'aient été de très-jeunes éléphans, puisque la verge du nôtre étoit fort
mince et point proportionnée au volume du corps.
L'éléphant qui a les testicules cachés dans l'intérieur du ventre, n'a point de scrotum.
L'auteur a vérifié cette observation des anciens, que les modernes avoieut mal comprise
dans Aristote, et dont il sera parlé plus au long dans la description anatomique
de ces parties.
La vulve diiFère sensiblement pour la forme et la situation de ce qui a lieu chez la
plupart des quadrupèdes. Elle se (rouve, dit Aristote, entre les cuisses au même endroit
où les brebis ont leurs mammelles, et dohse porter en arrière lors de l'accouplement ( i ).
C'est le grand éloignement de son orifice, relativement à l'anus, ainsi que le rapprochement
du ventre, combinés avec l'absence du scrotum dans les mâles, qui ont U'ompé
Perrault durant les treize années que l'éléphant du Congo a vécu dans la ménagerie do
Versailles. Il avoue qu'il n'a été désabusé que par la dissection du cadavre (a). La même
chose eut lieu à Londres , suivant le témoignage de Stukeiey (3); et c'est apparemment
sur dépareillés illusions que les anciens ont compté ces animaux parmi ]esrctrom.ingentia,
et comme s'accouplant de même. L'auteur a représenté les parties génitales de la femelle
, qui a servi pour la figure des mammelles sur la première planche. Il a remarqué
de plus que l'extrémité inférieure de la vulve, légèrement redressée, portoit les urines
fort en arrière du corps.
Une autre femelle, observée en 1 7 7 7 à Versailles, ne difTéroit en rien de celle qu'on
vient de décrire, quoiqu'elle fut plus {grande et plus âf^éc. Pendant l'action d'uriner le
clitoris débordoit l'ouverture de la vulve, et descen.doit presque à terre. La ressemblance
que cette partie présentoit sur-tout alors avec une verge, étoit bien capable de dérouter
ceux qui n'avoient pas observé des mâles ; et l'on ne sauroit trop blâmer les auteurs pour
s'être trompés sur des indications aussi illusoires.
La manière de se joindre des éléphans étoit parfaitement connue d'Aristote (4), qui la
compare à celle des chevaux. Nous en trouvons la confirmation dans Diotlore de Sicile
(5). Les modernes, et sur-tout le comte de Buifon, induits en erreur par de fausses
apparences et les rapports de gens mal instruits, ont imaginé que l'éléphant s'accouploit
difiTéremmeiit, et que la femelle étoit obligée de plier les extrémités antérieures pour admettre
le mâle (6). Sparrmann (7) a répété cette assertion, fondée sur le récit des colons
trop voisins du Cap qui ne pouvoient avoir observé la nature.
(1) HiH. anim., Ub. II, cap. i.
(а) Mémoires pour tervir <1 fkUtoire naturelle di
(Í5) Mssay towards, eu-.,pag-. ma.
(4) HUt.-anim., Ub. V, cap. a.
(5) Lib.ll,%. i5i,.
(б) / / « i . ,iat., supplóiueiií, lorn.Ill, pag. 3g6.
(7)Voyago cité, pag. agi.