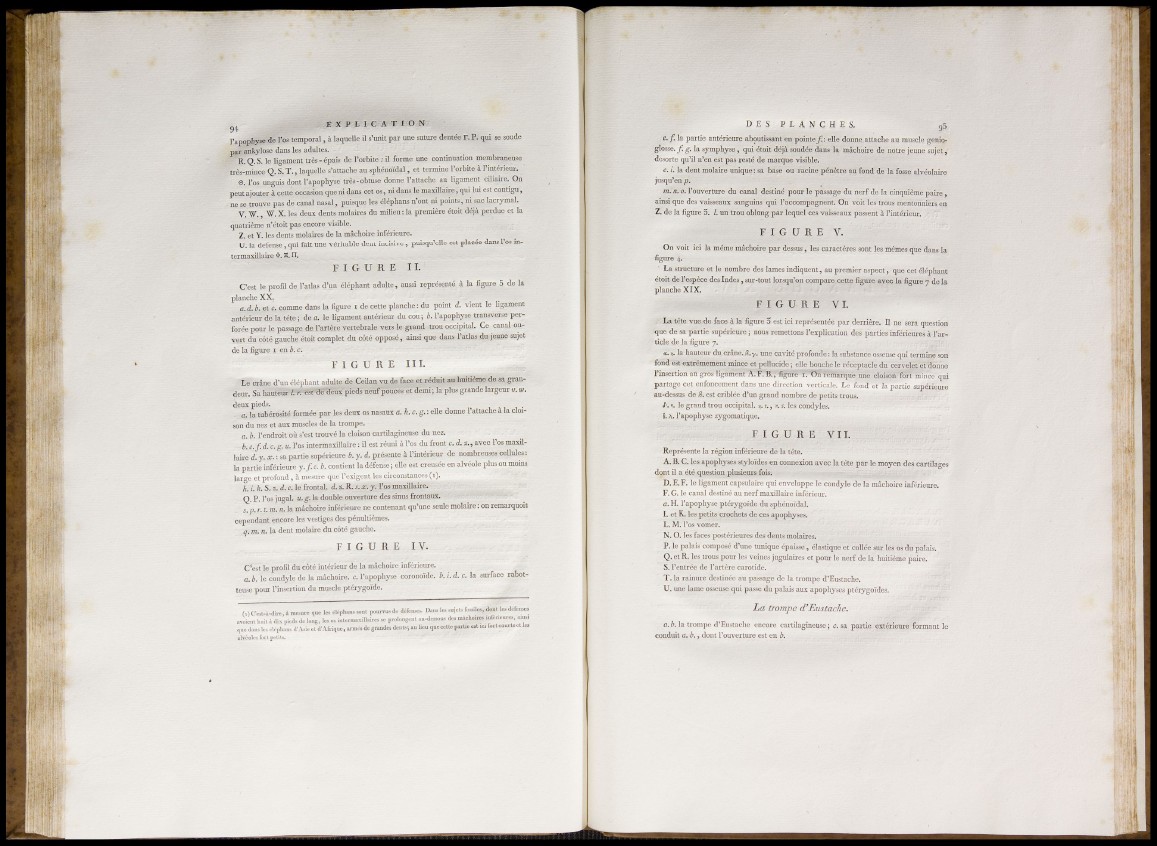
94
l'apophyse de l'i
par ankyl-
E X P L I C A T I O N
3 temporal, à laquelle il s'unit par une suiui-e dentée r. P. qui se soude
dans les adultes.
R . Q . S . le ligament très-épais de l'orbite ; il forme une continuation membraneuse
très-mince Q. S. T . , laquelle s'attache au sphenoidal, et termine l'orbite à l'intérieur.
0. l'os unguis dont l'apophyse très-obtuse donne l'attache au ligament ciliaire. On
peut ajouter à cette occasion que ni dans cet os, ni dans le maxillaire, qui lui est contigu,
ne se trouve pas de canal nasal, puisque les éléphans n'ont ni points, ni sac lacrymal.
V. \V., \V. X. les deux dents molaires du milieu : la première étoit déjà perdue et la
quatrième n'étoit pas encore visible.
Z. et Y. les dents molaires de la mâchoire inférieure.
U. la défense, qui fait une véritable dent incisive, puisqu'elle est placée dans l'os intermaxOlaire
3. n.
F I G U R E II.
C'est le profil de l'atlas d'un éléphant adulte, aussi représenté à la figure 5 de la
planche XX.
c. d. b. et c. comme dans la figure i de cette planche du point fi. vient le ligament
antérieur de la tête ; de a. le ligament antérieur du cou ; b. l'apophyse transverse perforée
pour le passage de i'artère vertebrale vers le grand trou occipiial. Ce canal ouvert
du côté gauche étoit complet du côté oppose, ainsi que dans l'atlas du jeune sujet
de la figure i en b. c.
F I G U R E I I I.
Le orane d'un éléphant adulte de Ceilan vu de face et réduit au liuitième de sa grandeur.
Sa hauteur /. r. est de deux pieds neuf pouces et demi ; la plus grande largeur v.
deux pieds.
a. la tubérosité formée par les deux os nasaux a. h. c. g. : elle donne l'attache à la cloison
du nez et aux muscles de la trompe.
a. b. l'endroit où s'est trouvé la cloison cartilagineuse du nez.
b. e.f. d. c. g. u. l'os intermaxillaire : il est réuni à l'os du front c. d. z . , avec l'os maxillaire
d. y. X. : sa partie supérieure b. y. d. présente à l'intérieur de nombreuses cellules:
la partie inférieure y.f. e. b. contient la défense ; elle est creusée en alvéole plus ou moins
large et profond , à mesure que l'exigent les circonstances (i).
h. i. k. S. s. d. c. le frontal, d. z. R. i. x. y. l'os maxillaire.
Q. P. l'os jugal. u. g. la double ouverture des sinus frontaux.
s. p. r. C. m. n. la mâchoire inférieure ne contenant qu'une seule molaire : on remarquoic
cependant encore les vestiges des pénultièmes.
cj. m. n. la dent molaire du côté gauche.
F I G U R E IV.
C'est le profil du côté intérieur de la mâchoire inférieure.
fi. b. le condyle de la mâchoire, c. l'apophyse coronoïde. b. L d. c. la surface rabotteuse
pour l'insertion du muscle ptérygoûle.
(,) CVs.-ù-aire, à mesure que les eléph.n. «>nl pourvu, cl. d^R-nses. Jlu. 1« sujeU lo^ik., do.U 1«.
avoi«al lii.il à <11-. pied, (le long, l e s « iiUcrmaxillair« 8c pivlonKc.l au-U«Si<.ua des miiclioii« jnlcr.curc», aiii».
iliiC les i-lephaa. d'-V^ic cl d'.\frique, arniw de S " " " ! "
bl iciloil couitoetic»
alvtolca full pirtits.
T
D E S P L A N C H E S . 95
e. f. la partie antérieure aboutissant en p o i n t e / : elle donne allache au muscle geniog
l o s s e . / g. la symphyse, qui étoit déjà soudée dans la mâchoire de notre jeune sujet,
desorte qu'il n'en est pas resté de marque visible.
e. i. la dent molaire unique : sa base ou racine pénètre au fond de la fosse alvéolaire
jusqu'en p.
m. n. 0. l'ouverture du canal destiné pour le passage du nerf do la cinquième paire,
ainsi que des vaisseaux sanguins qui l'accompagnent. On voit les trous mentonniers en
Z. de la figure 3. l. un trou oblong par lequel ces vaisseaux passent à l'intérieur.
F I G U R E V.
On voit ici la même mâchoire par dessus, les caractères sont les mêmes que dans la
figure 4.
La structure et le nombre des lames indiquent, au premier aspect, que cet éléphant
étoit de l'espèce des Indes, sur-tout lorsqu'on compare celte figure avec la figure 7 de la
planche XIX.
F I G U R E VI.
La tête vue de face à la figure 3 est ici représentée par derrière. Il ne sera question
que de sa partie supérieure ; nous remettons l'explication des parties inférieures à l'article
de la figure 7.
la hauteur du crâne. S.y. une cavité profonde : la substance osseuse qui termine son
fond est extrêmement mince et pellucide ; elle bouche le réceptacle du cervelet et donne
l'insertion au gros ligament A . F . B . , figure i. On remarque une cloison fort mince qui
partage eut enfoncement dans une direction verticale. Le fond et la partie supérieure
au-dessus de S. est criblée d'un grand nombre de petits trous.
J^. 1. le grand trou occipital, n. e., >1. s. les condyles.
6. A. l'apophyse zygomatique.
F I G U R E V I I.
Riiprésente la région inférieure de la tête.
A. B. C. les apophyses styloïdes en connexion avec la tête par le moyen des cartilages
dont il a été question plusieurs fois.
D. E. F. le ligament capsulaire qui enveloppe le condyle de la mâchoire inférieure.
F. G. le canal destiné au nerf maxillaire inférieur.
a. H. l'apophyse ptérygoïde du sphenoidal.
i. et K. les petits crochets de ces apophyses.
L. M. l'os vomer.
N. O. les faces postérieures des dents molaires.
P. le palais composé d'une tunique épaisse, élastique et collée sur les os du palais.
Q. et R. les trous pour les veines jugulaires et pour le nerf de la huitième paire.
S. l'entrée de l'artère carotide.
T. la rainure destinée au passage de la trompe d'Eustache.
U. une lame osseuse qui passe du palais aux apophyses ptérygoïdes.
La trompe d'Eiistachc.
(T. b. la trompe d'Eustache encore cartilagineuse ; c
conduit u. b., dont l'ouverture est en b.
'i
I partie extérieure formant le