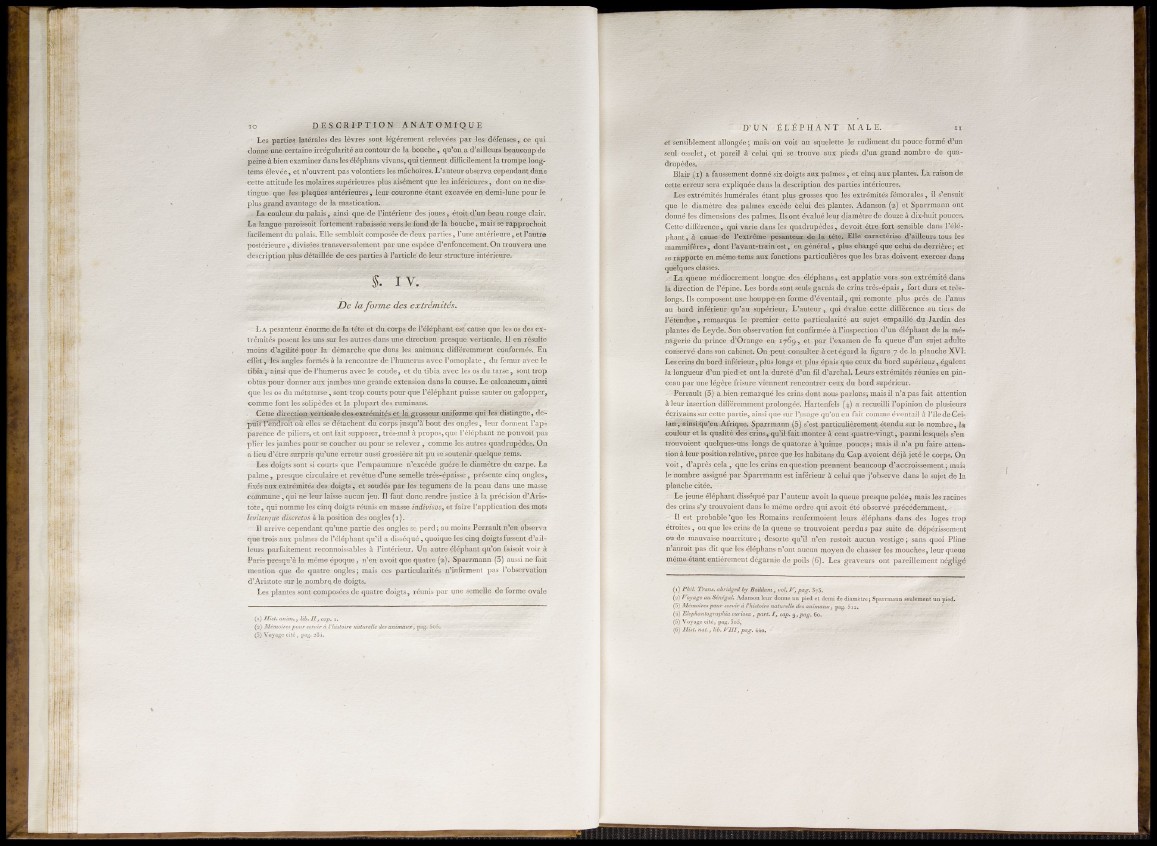
IO D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q UE
Les parties latérales des lèvres sont légèrement relevées par les défenses, ce qui
donne une certaine irrégularité au contour de la bouche, qu'on a d'ailleurs beaucoup de
peine à bien examiner dans les éléphans vivans, qui tiennent difficilement la trompe longtems
élevée, et n'ouvrent pas volontiers les mâchoires. L'auteur observa cependant dans
cette attitude les molaires supérieures plus aisément que les inférieures, dont on ne distingue
que les plaques antérieures, leur couronne étant excavée en demi-lune pour le
plus grand avantage de la mastication.
La couleur du palais, ainsi que de l'intérieur des joues, étoit d'un beau rouge clair.
La langue paroissoit fortement rabaissée vers le fond de la bouche, mais se rapprochoit
facilement du palais. Elle sembloit composée de deux parties, l'une antérieure, et l'autre
postérieure , divisées transversalement par une espèce d'enfoncement. On trouvera une
description plus détaillée de ces parties à l'article de leur structure ii
I V .
De la forme des extrémités.
L a pesanteur énorme de la tête et du corps de l'éléphant est cause que les os des extrémités
posent les uns sur les autres dans une direction presque verticale. Il en résulte
moins d'agilité pour la démarche que dans les animaux diiiëremment conformés. En
elTet, les angles formés à la rencontre de l'humerus avec l'omoplate, du ftîraur avec le
tibia, ainsi que de l'humerus avec le coude, et du tibia avec les os du tarse, sont trop
obtus pour donner aux jambes une grande extension dans la course. Le calcaneum, ainsi
que les os du métatarse, sont trop courts pour que l'éléphant puisse sauter ou galopper,
comme font les solipèdes et la plupart des ruminans.
Cette direction verticale des extrémités et Ja grosseur uniforme qui les distingue, depuis
l'endroit oii elles se détachent du corps jusqu'à bout des ongles, leur donnent l'apparence
de piliers, et ont fait supposer, très-ma! à propos, que l'éléphant ne pouvoit pas
plier les jambes pour se coucher ou pour se relever, comme les autres quadrupèdes. On
a lieu d'etre surpris qu'une erreur aussi grossière ait pu se soutenir quelque tems.
Les doigts sont si courts que l'empaumure n'excède guère le diamètre du carpe. La
palme, jiresque circulaire et revêtue d'une semelle très-épaisse, présente cinq ongles,
fixés aux extrémités des doigts, et soudés par les tegumens de la peau dans une masse
commune, qui ne leur laisse aucun jeu. Il faut donc rendre justice à la précision d'Aristote,
qui nomme les cinq doigts réunis on masse indivisos, et faire l'application des mots
leviterque discretos à la position des ongles ( i ).
Il arrive cependant qu'une partie des ongles se perd ; au moins Perrault n'en observa
que trois aux palmes de l'éléphant qu'il a disséqué, quoique les cinq doigts fussent d'ailleurs
parfaitement reconnoissables à l'intérieur. Un autre éléphant qu'on faisoit voir à
Paris presqii'à la même époque, n'en avoit que quatre (2). Sparrmann (3) au.ssi ne fait
mention que de quatre ongles; mais ces particularités n'infirment pas l'observation
d'Aristote sur le nombre? de doigts.
Les plantes sont composées de quatre doigts, réunis par qne semelle de forme ovale
(0 / / « i . anim., lib. Il, cap. 1.
(3) Minoirea paur nervir à l'/iuloire riatureUc île«
(5) Voyage citó,i.aa. 281.
D ' U N É L É P H A N T M A L E . 11
et sensiblement allongée ; mais on voit au squelette le rudiment du pouce formé d'un
seul osselet, et pareil à celui qui se trouve aux pieds d'un grand nombre de quadrupèdes.
Blair ( i ) a faussement donné six doigts aux palmes, et cinq aux plantes. La raison de
cette erreur sera expliquée dans la description des parties intérieures.
Les extrémités humérales étant plus grosses que les extrémités fémorales, il s'ensuit
que le diamètre des palmes excède celui des plantes. Adanson (a) et Sparrmann ont
donné les dimensions des palmes. Ils ont évalué leur diamètre de douze à dix-huit pouces.
Cette dilFcrcnce, qui varie dans les quadrupèdes, devoit être fort sensible dans l'élé-
])liant, à cause de l'extrême pesanteur de la lête. Elle caractérise d'ailleurs tous les
mammifères, dont l'avant-train est, en général, plus chargé que celui de derrière ; et
se rapporte en même tems aux fonctions particulières que les bras doivent exercer dans
quelques classes.
La queue médiocrement longue des éléplians, est applatie vers son extrémité dans
la direction de l'épine. Les bords sont seuls garnis de crins très-épais, fort durs et trèslong?.
Ils composent une houppe en forme d'éventail, qui remonte plus près de l'anus
au bord inférieur qu'au supérieur. L'auteur, qui évalue cette difference au tiers de
l'étendue, remarqua le premier cette particularité au sujet empaillé du Jardin des
plantes de Leyde. Son observation fut confirmée à l'inspection d'un éléphant de la ménagerie
du prince d'Orange en 1 7 6 9 , et par l'examen de la queue d'un sujet adulte
conservé dans son cabinet. On peut consulter à cet égard la figure 7 de la planche XVI.
Les crins du bord inférieur, plus longs et plus épais que ceux du bord supérieur, égalent
la longueur d'un pied et ont la dureté d'un fil d'archal. Leurs extrémités réunies en pinceau
par une légère frisure viennent rencontrer ceux du bord supérieur.
Perrault (5) a bien remarqué les crins dont nous parlons; mais il n'a pas fait attention
à leur insertion diilëremment prolongée. Hartenfels {4) a recueilli l'opinion de plusieurs
écrivains sur ce tie par lie, ainsi que sur l'iisn^e qu'on eu fuit comme éventail à l'île de Ceilan,
ainsi qu'en Afrique. Sparrmann (5) s'est . p . a j t i g j j l i ^ ^ e n t étendu sur le nombre, la
couleur et la qualité des crins, qu'il fait monter à cent quatre-vingt, parmi lesquels s'en
trouvoient quelques-uns longs de quatorze à^juinze pouces ; mais il n'a pu faire attention
à leur position relative, parce que les habitans du Cap avoient déjà jeté le corps. On
voit, d'après c e l a , que les crins en question prennent beaucoup d'accroissement ; mais
le nombre assigné par Sparrmann est inférieur à celui que j'observe dans le sujet de la
planche citée.
Le jeune éléphant disséqué par l'auteur avoit la queue presque pelée, mais les racines
des crins s'y trouvoient dans le même ordre qui avoit été observé précédemment.
Il est probable "que les Romains renfermoient leurs éléplians dans des loges trop
étroites, ou que les crins de la queue se trouvoient perdus par suite de dépérissement
ou de mauvaise nourriture ; desorte qu'il n'en restoit aucun vestige; sans quoi Pline
n'auroit pas dit que les éléplians n'ont aucun moyen de chasser les mouches, leur queue
même étant entièrement dégarnie de poils (6). Les graveurs ont pareillement négligé
{•) Phil. Trans, abrùig^l by Baddam. vol. V, pag. 3,-5.
(а) royage au Sénégal. Adaiisoii leur donne un pied et demi <le diamètre; Sjian tuaiiii seulement uu pied.
(3) Mènwireipour servir à l'histoire naturelle îles animaiix, pag. 512.
(t) EUpluuUogi-aphia curiosa , part, l, cap. ^.pag. 60.
(5) \ ûyagL- cité, pag. 5o5,
(б) Hist. nat.,lib. rm,pag. iio.
:ii I
m