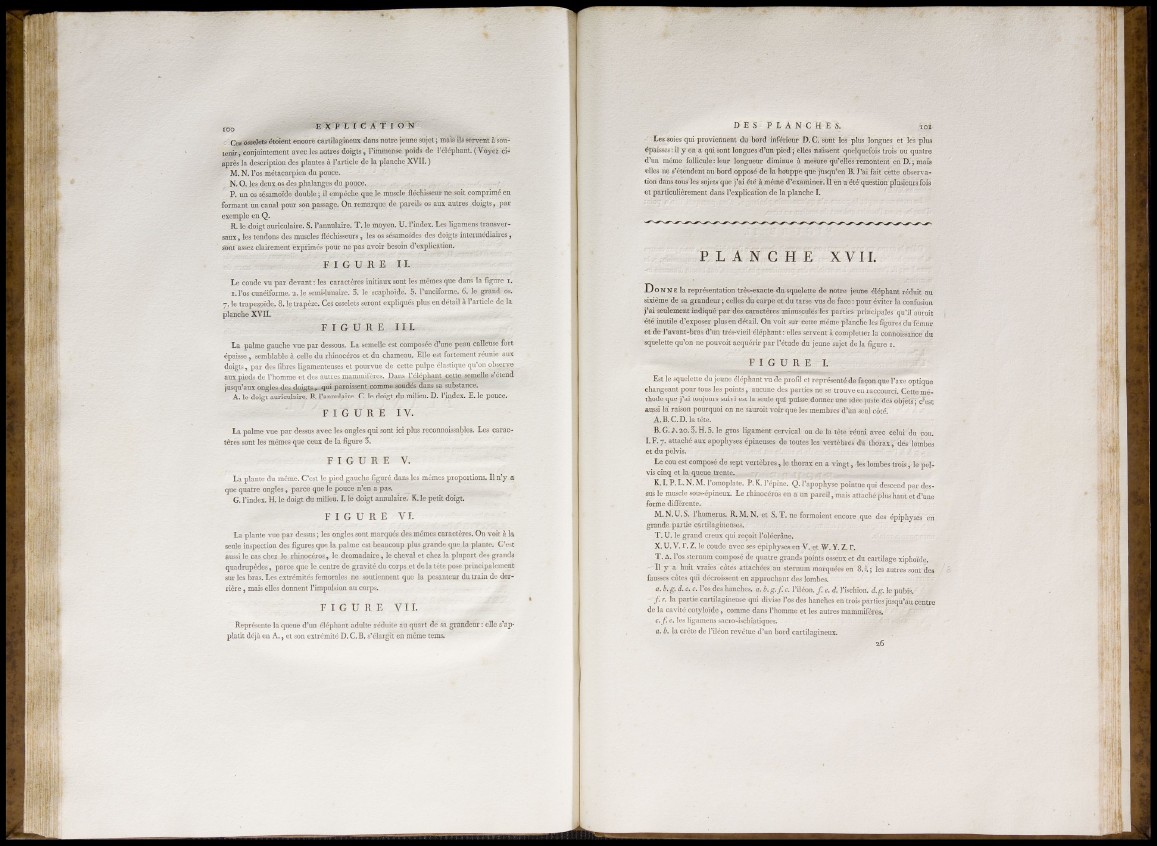
, 0 0 e x p l i c a t i on
Ces osselets étoient encore cartilagineux dans noire jeune sujet ; mais ils servent à sontenir,
conjointement avec les autres doigts, l'immense poids de l'éléphant. (Voyez ciaprès
la description des plantes à rarlicle de la planche XVII. )
M. N. l'os métacarpien du pouce.
N. O. les deux os des phalanges du pouce.
P. un os sésamoïde double ; il empéchc que le muscle fléchisseur ne soit comprimé en
formant un canal pour son passage. On remarque de pareils os aux autres doigts, par
exemple en Q.
R. le doigt auriculaire. S. l'annulaire. T . le moyen. U. l'index. Les ligamens transversaux
, les tendons des muscles fléchisseurs, les os sésamoïdes des doigts intermédiaires,
sont assez clairement exprimés pour no pas avoir besoin d'explication.
F I G U R E II.
Le coude vu par devant : les caractères initiaux sont les mêmes que dans la figure i.
i.roscunéiforme. 2. le semi-lunaire. 3. le scaphoïde. 5. l'unciforme. 6. le grand os.
7. le trapezoïde. 8. le U-apèze. Ces osselets seront expliqués plus en détail à l'article de la
planche XVIL
F I G U R E I IL
La palme gauche vue par dessous. La semelle est composée d'une peau calleuse fort
épaisse, semblable à celle du rhinocéros et du chameau. Elle est fortement réunie aux
doigts, par des fibres ligamenteuses et pourvue de cette pulpe élastique qu'on observe
aux pieds de l'homme et des autics mammiiéres. Dans l'éléphant cette semelle s'étend
jusqu'aux ongles des doigta ,|ggpBW»>soentjcomme soudés dans sa substance.
A. le doigt auriculaire. B. l'annulaire. C. le doigt du milieu. D. l'index. E. le pouce.
F I G U R E IV.
La palme vue par desst
teres sont les mêmes que c
ivec les ongles qui sont ici plus rcconnoissables. Les caracï
de la figure 3.
F I G U R E V.
La plante du même. C'est le pied gauche figuré dans les mêmes proportions. Il n'y a
que quatre ongles, parce que le pouce n'en a pas.
G. l'index. H. le doigt du milieu. I. le doigt annulaire. K. le petit doigt.
F I G U R E VI.
La plante vue par dessus ; les ongles sont marqués des mêmes caractères. On voit à la
seule inspection des figures que la palme est beaucoup plus grande que la plante. C'est
aussi le cas chez le rhinocéros, le dromadaire, le cheval et chez la plupart des grands
quadrupèdes, parce que le centre de gravité du corps et de la tête pose principalement
sut les bras. Les extrémités femorales ne soutiennent que la pesanteur du train de derrière
, mais eUcs donnent l'impulsion au corps.
F I G U R E V I I.
Représente la queue d'un éléphant adulte réduite au quart de sa grandeur : clic s'applatit
déjà en A . , et son extrémité D. C. B. s'élargit en même tcms.
D E S P L A N C H E S. loi
Les soies qui proviennent du bord inférieur D. C. sont les plus longues et les plus
épaisses:il y en a qui sont longues d'un pied; elles naissent quelquefois trois ou quaire
d'un même follicule : leur longueur diminue à mesure qu'elles remontent en D. ; mais
dies ne s'étendent an bord opposé de la houppe que jusqu'en B. J'ai fait cette observation
dans tous les sujets que j'ai été à même d'examiner. Il en a été question plusieurs fois
et particulièrement dans l'explication de la planche i.
P L A N C H E XVII.
D o N N E la représentation très-exacte du squelette de notre jeune éléphant réduit au
sixième de sa grandeur ; celles du carpe et du tarse vus de face : pour éviter la confusion
j'ai seulement indiqué par des caractères minuscules les parties principales qu'il auroit
été inutile d'exposer plus en détail. On voit sur cette même planche les figures du fémur
et de l'avant-bras d'un très-vieil éléphant: elles servent à completter la connoissance du
squelette qu'on ne pouvoit acquérir pat l'étude du jeune sujet de ia figure i.
F I G U R E I.
Est le squelette du jeune éléphant vu de profil et représenté de façon que l'axe optique
changeant pour tous les points, aucune des parties ne se trouve en raccourci. Cette méthode
que j'ai toujours suivi est la seule qid puisse donner une idée juste des objets; c'est
aussi la raison pourquoi on ne sauroit voir que les membres d'un seul côté.
A.B.C.D. la tête.
B. G. 20.5. H. 5. le gros ligament cervical ou de la tête réuni avec celui du cou.
I. F. 7. attaché aux apophyses épineuses de toutes les vertèbres du tlioras, des lombes
et du pelvis.
Le cou est composé de sept vertèbres, le thorax en a vingt, les lombes trois, le pelvis
cinq et la queue trente.
K. I. P. L. N. M. l'omoplate. P. K. l'épine. Q. l'apophyse pointue qui descend par dessus
le muscle sous-opincux. Le rhinocéros en a un pareil, mais attaché phis haut et d'une
forme diftêrente.
M. N. U. S. l'humérus. R. M. N. et S. T . ne formoient encore que des épiphyses en
grande partie cartilagineuses.
T. U. le grand creux qui reçoit l'olécràne.
X. U. V. r. Z, le coude avec ses épiphysee en V. et W, Y. Z. T.
T. A. l'os sternum composé de quatre grands points osseux et du cartilage xiphoïde.
Il y a huit vraies côtes attachées au sternum marquées en 8.9.; les autres sont des
fausses côtes qiii décroissent en approchant des lombes.
a. b.g.d.e. c. l'os des hanches, a.b.g.f.c. l'iléon. / c. </. l'ischion, d.g. le pubis.
f.r. la partie cartilagineuse qui divise l'os des hanches en trois parties jusqu'au centre
de la cavité cotyloide, comme dans l'iiommc et les autres mammifères.
c. f. e. les ligamens sacrn-iscliiatiquos.
a. b. la crête de l'iléon revêtue d'un bord cartilagineux.
aC