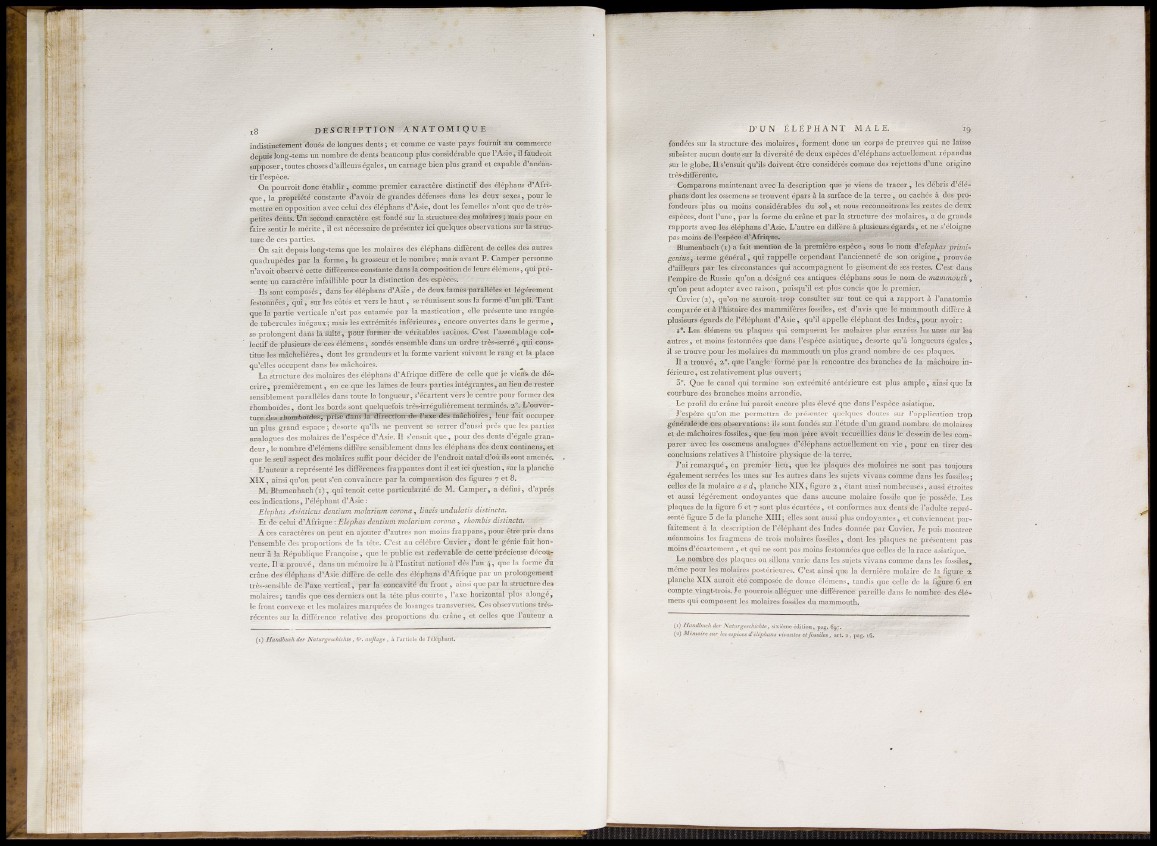
iV:
I8 DESCRIPTION A N A T O M I Q UE
indistinctement doués de longues dents ; et comme ce v a s t e p a y s fournit a u c
depuis long-iems un nombre de dents beaucoup plus considérable que l ' A s i e , i l f a u d r o it
s u p p o s e r , toutes choses d'ailleui's é g a l e s , un c a r n a g e bien plus g r a n d et c a p a b l e d'anéantir
l'espèce.
On pourroit donc é t a b l i r , comme p r e m i e r c a r a c t è r e distinctif des éléplians d ' A f r i -
q u e , la p r o p r i é t é constante d ' a v o i r de g r a n d e s défenses dans les deux s e x e s , pour le
mettre en opposition a v e c celui des éléphans d ' A s i e , dont les femelles n'ont que d e trèspetites
dents. U n second c a r a c t è r e est f o n d é sur l a structure des molaires ; m a i s pour en
f a i r e sentir l e m é r i t e , il est nécessaire d e p r é s e n t e r ici quelques observations sur l a structure
d e ces parties.
On sait depuis long-tems que les molaires des éléphans dilFèrent de celles des autres
q u a d r u p è d e s p a r la f o r m e , la grosseur et le n o m b r e ; mais avant P. C a m p e r personne
n ' a v o i t observé cette différence constante dans J a composition de leurs élémens, qui p r é -
sente un c a r a c t è r e infaillible pour la distinction des espèces.
I l s sont c o m p o s é s , dans les éléphans d ' A s i e , de deux lames p a r a l l è l e s et légèrement
f e s t o n n é e s , q u i , sur les côtés et vers l e h a u t , se réunissent sous l a formé d'un p l i . T a n t
que l a p a r t i e v e r t i c a l e n'est p a s entamée p a r la m a s t i c a t i o n , elle présente une r a n g ée
de tubercules i n é g a u x ; mais les extrémités i n f é r i e u r e s , encore ouvertes dans le g e r m e ,
s e prolongent dans l a s u i t e , pour former de v é r i t a b l e s racines. C ' e s t l ' a s s e m b l a g e coll
e c t i f d e plusieurs d e ces é l é m e n s , soudés ensemble dans un ordre t r è s - s e r r é , qui constitue
les m â c h e l i è r e s , dont les g r a n d e u r s et l a forme v a r i e n t suivant l e r a n g et la p l a ce
qu'elles occupent dans les mâchoires. ^
L a structure des molaires des éléphans d ' A f r i q u e d i f f è r e d e celle que j e viens- d e déc
r i r e , p r e m i è r e m e n t , en ce que les lames de leurs p a r t i e s i n t é g r a l i t é s , a u lieu de rester
sensiblement p a r a l l è l e s dans toute l a l o n g u e u r , s ' é c a r t e n t v e r s le centre pour former des
r h o m b o ï d e s , dont les b o r d s sont quelquefois très-irrégulièrement terminés, L'ouverture
des rhomboïdes," p r i s e dans l a dîrecrioTi -de l ' a x e des m â c h o i r e s , leur fait occuper
un i:)lus g r a n d espace ; desorte qu'ils ne peuvent se serrer d'aussi p r è s que les p a r t i es
analogues des molaires de l ' e s p è c e d'Asie. Il s'ensuit q u e , pour des dents d ' é g a l e g r a n -
d e u r , le nombre d'élcmens difï'ère sensiblement dans les éléphans des deux continens, et
que le seul aspect des molaires suffit p o u r décider de l'endroit natal d'où ils sont amenés.
L ' a u t e u r a r e p r é s e n t é les différences f r a p p a n t e s dont il est ici q u e s t i o n , sur l a planche
X I X , ainsi q u ' o n peut s'en convaincre p a r !a comparaison des f i g u r e s 7 et 8.
M. Blumenbach ( r ) , qui tenoit cette p a r t i c u l a r i t é de M. C a m p e r , a d é f i n i , d ' a p r ès
ces i n d i c a t i o n s , l'éléphant d ' A s i e :
Elcphas Asiaticus dentium molarium corona, lineis undiilatis distincta.
Et de celui d ' A f r i q u e : Elephas dentium molarium corona , rhombis distincta.
A ces c a r a c t è r e s on peut en ajouter d ' a u t r e s non moins f r a p p a n s , pour être p r i s dans
l'ensemble des proportions de la tête. C'est au célèl)re C u v i e r , dont le génie fait honneur
à la R é p u b l i q u e F r a n ç o i s e , <[ue le p u b l i c est r e d e v a b l e de cette p r é c i e u s e d<'Couv
c r t e . II a p r o u v é , dans un mémoire lu à l'In&titut national dès l ' an 4 , que la forme du
c r â n e des éléphans d ' A s i e d i f f è r e d e celle des éléphans d ' A f r i q u e p a r un prolongement
très-sensible de l ' a x e v e r t i c a l , p a r la concavité du f r o n t , ainsi que p a r la structure des
m o l a i r e s ; tandis q u e ces derniers ont l a tête plus c o u r t e , l ' a x e horizontal plus a l o n g é,
le front convexe et les molaires marquées de losanges transverses. Ces observations trèsréccntcs
sur la différence relative des proportions du c r â n e , et celles que l'auteur a
D ' U N É L É P H A N T M A L E . zc,
fondées sur l a structure des m o l a i r e s , forment donc un corps de preuves qui ne laisse
subsister aucuii doute sur l a diversité d e deux espèces d ' é l é p h a n s actuellement répandus
s\ir le globe. Il s'ensuit qu'ils doivent être considérés comme des rejettons d'une origine
trè.i-différente.
Comparons maintenant a v e c l a description que j e viens de t r a c e r , les débris d ' é l é -
phans dont les osscmens se trouvent épars à la s u r f a c e d e l a t e r r e , ou cachés à des profondeurs
plus ou moins considérables du s o l , et nous reconnoitrons les restes d e deux
espèces, dont l ' u n e , p a r l a f o r m e du crâne et p a r la structure des m o l a i r e s , a do g r a n ds
r a p p o r t s a v e c les éléphans d'Asie. L ' a u t r e e n d i l l e r e à plusieurs é g a r d s , et ne s ' é l o i g ne
p a s moins d e l ' e s p è c e d ' A f r i q u e.
Blumenbach (1) a f a i t mention d e la p r e m i è r e e s p è c e , sous le nom d'elephas primigenius,
terme g é n é r a l , qui r a p p e l l e cependant l'ancienneté de son o r i g i n e , prouvée
d'ailleurs p a r les circonstances qui accompagnent le gisement de ses restes. C'est dans
l ' e m p i r e de Russie qu'on a désigné ces antiques éléphans sous le nom de mammouth,
qu'on peut adopter a v e c r a i s o n , puisqu'il est plus concis q u e le premier.
C u v i c r ( 2 ) , qu'on ne sauroit trop consulter sur tout ce qui a r a p p o r t à l'anatomie
c o m p a r é e et à l'histoii-e des mammifères fossiles, est d ' a v i s que le mammouth d i f f è r e à
plusieurs é g a r d s d e l ' é l é p h a n t d ' A s i e , qu'il a p p e l l e éléphant des I n d e s , pour a v o i r:
I®. L e s éléinens ou plaques qui composent les molaires plus serrées les unes sur les
a u t r e s , et moins festonnées q u e dans l ' e s p è c e a s i a t i q u e , desorte q u ' à longueurs é g a l e s,
il se trouve pour les molaires du mammouth un plus g r a n d nombre de ces plaques.
Il a t r o u v é , 1". que l ' a n g l e formé p a r la rencontre des branches de l a mâchoire inf
é r i e u r e , est relativement p l u s ouvert ;
3 ° . Q u e le canal qui termine son extrémité antérieure est plus a m p l e , ainsi que la
courbure des branches moins arrondie.
L e profil du crâne lui p a r o i t encore plus é l e v é q u e dans l ' e s p è c e asiatique.
J ' e s p è r e qu'on m« permettra do préseiUei- q u e k j i i f s doulu.s sur i'.Tppliration trop
g é n é r a l e de ces o b s e r v a t i o n s : ils sont fondés sur l ' é t u d e d'un g r a n d nombre de molaires
et d e mâchoires f o s s i l e s , q u e f e u mon p è r e a v o i t recueillies dans l e dessein de les comp
a r e r avec les ossemens analogues d'éléphans actuellement e n v i e , pour en tirer des
conclusions r e l a t i v e s à l'histoire physique de l a terre.
J ' a i r e m a r q u é , en premier lieu, que les plaques des molaires ne sont p a s toujours
également serrées les unes sui- les autres dans les sujets v i \ a n s comme dans les f o s s i l e s;
celles d e l a molaire ae d, planche X I X , figure a , étant aussi nombreuses, aussi étroites
et aussi légèrement ondoyantes que dans aucune molaire fossile que je possède. Les
plaques de l a l i g u r e 6 et 7 sont plus é c a r t é e s , et conformes aux dents de l ' a d u l t e représenté
figure 3 de la planche X I I I ; elles sont aussi plus o n d o y a n t e s , et conviennent p a r -
faitement à l a description de l'élépluint des Indes donnée p a r Cuvier. J e puis montrer
néanmoins les fragmens de trois molaires f o s s i l e s , dont les plaques ne présentent pas
moins d ' é c a r t c m e n t , ri qui ne sont p a s moins festonnées q u e celles d e la r a c e asiatique.
L e nombre des plaques ou sillons v a r i e dans les sujets vi v a n s comme dans les fossiles,
même pour les molaires postérieures. C'est ainsi que la d e r n i è r e molaire de la figure a
planche X I X auroit é t é composée de douze élémens, tandis que celle do la /îgore 6 en
compte vingt-trois. J e pourrois alléguer une d i f f é r e n c e p a r e i l l e dans le nombre des élémens
qui composent les molaires fossiles d u mammouth.
(1) Handbuch tier Naturgeschkhte, C'. aujlage , à )"arliclc do l'ù)¿pliant.
(1) Ilnndbui hdtr V.ito/ywc/ii'o/iif, sixiiiuie cdilloii, jwg. 69;.
(a) Mémoire sur esj^ùvj (l'iUji/iaits vU'a/iles et fossiki, art. î