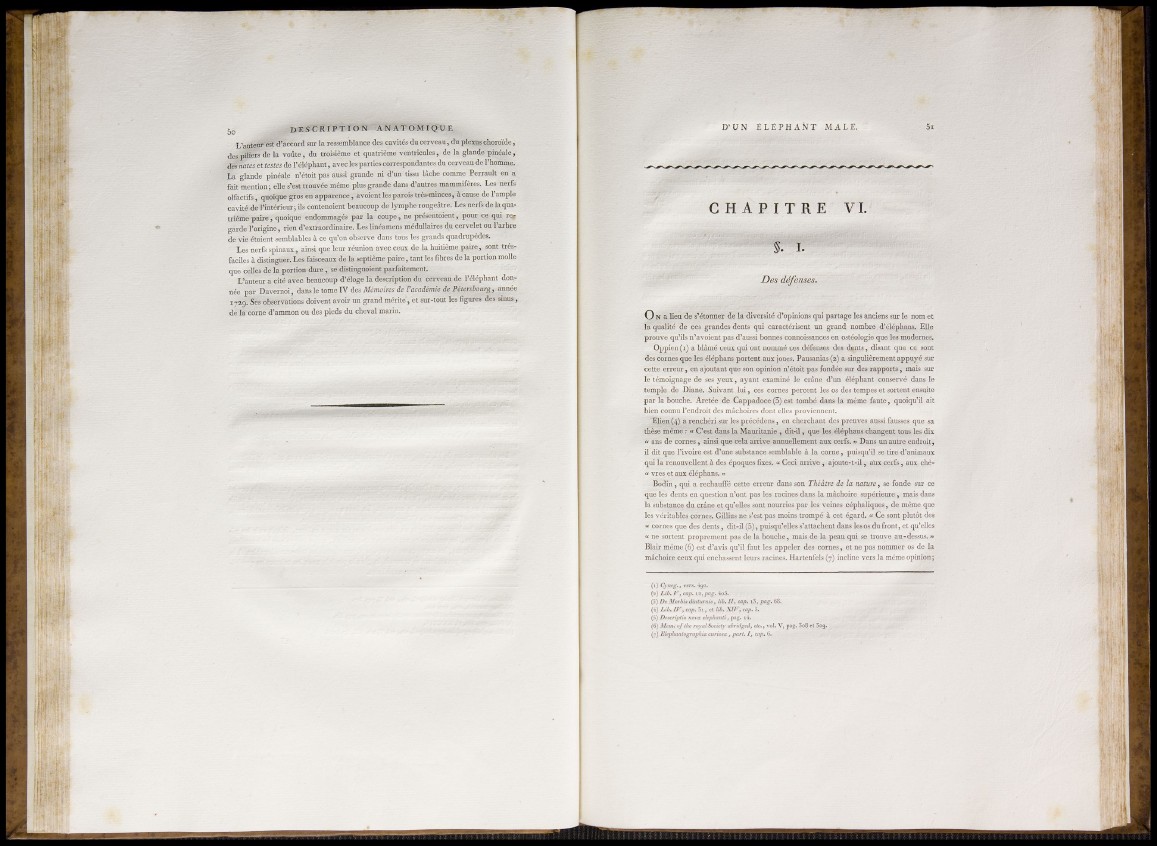
¡ • 4 ' •
;
H T
Î I I .
Î K F T
D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q UE
L'atrteur est d'accord sur la ressemblance des cavités du cerveau, du plexus choroïde,
des piliers de la voûte, du troisième et quatrième ventricules, de la glande pineale,
des nates et testes de l'éléphant, avec les parties correspondantes du cerveau de l'homme.
La glande pineale n'étoit pas aussi grande ni d'un tissu lâche comme Perrault en a
fait mention; elle s'est trouvée même plus grande dans d'autres mammifères. Les nerfs
olfactifs, quoique gros en apparence, avoient les parois très-minces, à cause de l'ample
cavité de l'intérieur; ils conlenoient beaucoup de lymphe rougeâtre. Les nerfs de la quatrième
paire, quoique endommagés par la coupe, ne présentoient, pom- ce qui r<v
garde l'origine, rien d'extraordinaire. Les linéamens médullaires du cervelet ou l'arbre
de vie étoient semblables à ce qu'on observe dans tous les grands quadrupèdes.
Les nerfs spinaux, ainsi que leur réunion avec ceux de la huitième paire, sont trèsfaciles
à distinguer. Les faisceaux de la septième paire, tant les fibres de la portion molle
que celles de la portion dure, se distinguoient parfaitement.
L'auteur a cité avec beaucoup d'éloge la description du cerveau de l'elcphant donnée
par Duvernoi, diinsle iome IV ¿es Mémoires de racadémie de Pétersbourg, année
1729. Ses observations doivent avoir un grand mérite, et sur-tout les figures des sinus,
de la corne d'ammon ou des pieds du cheval marin.
D ' U N É L É P H A N T M A L E.
C H A P I T R E V I.
§ . I.
Des défenses.
Î
O N a lieu de s'étonner de la diversité d'opinions qui partage les anciens sur le nom et
la qualité de ces grandes dents qui caractérisent un grand nombre d'éléphans. Elle
prouve qu'ils n'avoient pas d'aussi bonnes connoissances en ostéologie que les modernes.
Oppien (i) a blâmé ceux qui ont nommé ces défenses des dents, disant que ce sont
des cornes que les éléphans portent aux joues. Pausanias (2) a singulièrement appuyé sur
cette erreur, en ajoutant que son opinion n'étoit pas fondée sur des rapports, mais sur
le témoignage de ses yeux, ayant examiné le crâne d'un éléphant conservé dans le
temple de Diane. Suivant lui, ces cornes percent les os des tempes et sortent ensuite
par la bouche. Aretée de Cappadoce (3) est tombe dans la même faute, quoiqu'il ait
bien coimu l'endroit dos mâchoires dont elles proviennent.
Elien (4) a renchéri sur les précédons, en cherchant des preuves aussi fausses que sa
thèse même : « C'est dans la Mauritanie , dit-il, que les éléphans changent tous les dix
« ans de cornes, ainsi que cela arrive annuellement aux cerfs. » Dans un autre endroit,
il dit que l'ivoire est d'une substance semblable à la corne, puisqu'il se tire d'animaux
qui la renouvellent à des époques Fixes. " Ceci arrive , ajoute-t-il, aux cerfs, aux chè-
" vres et aux éléphans. »
Bodin, qui a réchauffé cette erreur dans son Théâtre de la nature, se fonde sur ce
que les dents en question n'ont pas les racines dans la mâchoire supérieure, mais dans
la substance du crâne et qu'elles sont nourries par les veines céphaliques, de même que
les véritables cornes. Gillius ne s'est pas moins trompé à cet égard. « Ce sont plutôt des
« cornes que des dents, dit-il (5), puisqu'elles s'attachent dans les os du front, et qu'elles
" ne sortent proprement pas de la bouche, mais de la peau qui se trouve au-dessus. »
Blair mémo(6) est d'avis qu'il faut les appeler des cornes, et ne pas nommer os de la
mâchoire ceux qui enchâssent leurs racines. Hartenfels (7) incline vers la même ojiinion;
(1) O'li-S--, viz-i. iyo.
{2) /.ib. y, eap. l'iijxig. ioS.
(5) J)e Morbis diuturnis, lib. II, cap. l i , pag. 68.
(•i) Ub. ly, cap. , et lib. \ir, mp. 5.
(5) DfscripHo not a ctephanti, pag. l i.
(6) Mnn. oj't'ie royalSociety abriilged, etc., \ ol. V, pag. 3o8 el Sog.
(;) Elfp/iaulogmphia curiosa , pari. [, cap. (j.
m