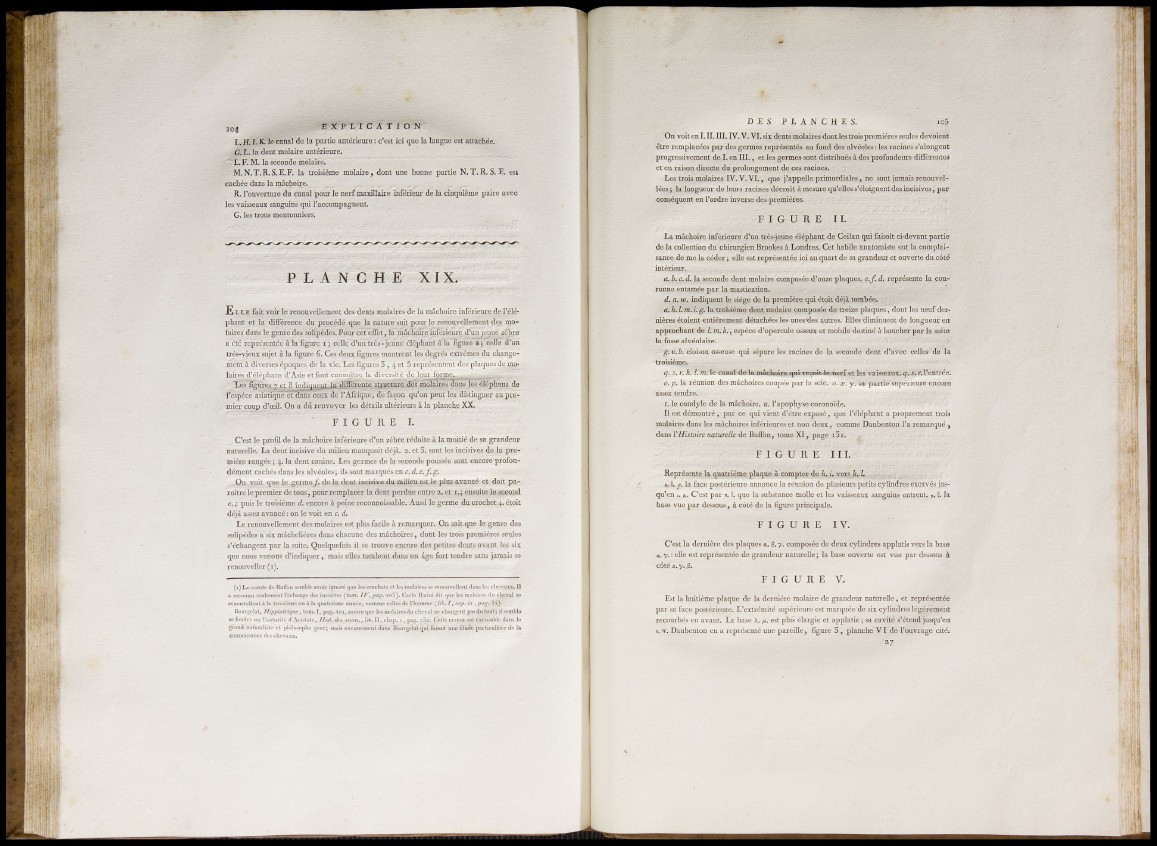
l'i' '
lO^ E X P L I C A T I ON
L. H. I . K. le canal de la p a r t i e antérieure : c'est ici que la langue est attachée.
G. L. la dent molaire antérieure.
L. F. M. l a seconde molaire.
M . N . T . R . S . E . F . la troisième m o l a i r e , dont une bonne p a r t i e N. T . R . S. E. est
cachée dans l a mâchoire.
R. l ' o u v e r t u r e du canal pour le nerf maxillaire inférieur de la cinquième p a i r e avec
les vaisseaux sanguins qui l'accompagnent.
G. les trous mentonniers.
P L A N C H E XIX.
E l l e fait voir le renouvellement des dents molaires de la mâchoire inférieure d e l'éléphant
et la différence du procédé que la nature suit pour le renouvellement des molaires
dans le genre des solipèdes. Pour cet e f f e t , la mâchoire inférieure d'un jeune zèbre
a été représentée à l a figure r ; celle d'un t r è s - j e u n e éléphant à i a figure i-, celle d'un
très-vieux sujet à la figure 6. Ces deux figures montrent les degrés extrêmes du changement
à diverses époques de la vie. Les figures 3 , 4 et 5 représentent des plaques de molaires
d'éléphans d'Asie et font connoîtvo l a diversité du lout loijue-
Les figures 7 et R inrligny^pt la différente stiucture des molaires dans les éléphans de
l'espèce asiatique et &ans ceux de l ' A f r i q u e ; d é façon qu'on peut les distinguer au p r e -
mier coup d'oeil. On a dû r e n v o y e r les détails ultérieurs à l a planche XX.
F I G U R E I.
C'est le profil de la mâchoire inférieure d ' u n zèbre réduite à la moitié de sa grandeur
naturelle. La dent incisive du milieu manquoit déjà. 2. et 3. sont les incisives d e la première
rangée ; 4. la dent canine. Les germes de la seconde poussée sont encore profondément
cachés dans les alvéoles; ils sont marqués en c. d. c.f. p.
On voit que le g e r m e / de k dent incisive d u milieu est le plus avancé et doit par
o î t r e l e p r e m i e r de tous, pour remplacer l a dent perdue entres., et i . ; ensuite le second
e. ; puis le troisième d. encore à peine reconnoissable. Aussi le germe du crochet 4. étoit
déjà assez avancé : on le voit en c. d.
Le renouvellement des molaires est plus facUe à remarquer. On sait que le genre des
solipèdes a six mâchelières dans chacune des mâchoires, dont les trois premières seules
s'échangent p a r la suite. Quelquefois il se trouve encore des petites dents avant les six
que nous venons d ' i n d i q u e r , maïs elles tombent dans un âge fort t e n d r e sans jamais se
renouveller (r).
(1) Le comic dcBuiToii semble avoir ignoré <|ne leacrochcls ri le» molaires se rrmmvelicnt diuis Ic'. chevaux. U
a reconnu seulement loctiangc des incisives (iom. iy,pag. 2o3). Curio Ruini dil 4UC les molaires du eliuval su
l'Cnouvellent à la Iroisièiuo ou à la quatrième année, comme ceile.i de Vliomme (W. / , cap. ii jpag- îij-
IJourgelal, Ilippialrique , Igm. I, pag. 4oi, assure qne Icsmolairoadii clieval ne i h.iiigenl pasduloill; ihcmblo
scToiKUr surV.iulorilé d'AnMolc, Ilul.des anim., 1ÌT. II, cli.ip. 1, jiag. Celle crieuk'cal exevisal)le d«u» lo
gr.ind iiaUiralisle cl philosoplic grce; mai? aueuncmcnl dans Jioargclat (¡ui liiisoil uiic eludo parliouliùco do la
coimoÌ!»auce de. chevaux.
D E S P L A N C H E S. io5
On voit en L IL I I I . IV. V. VLsix dents molaires dont lestrois premières seules devoient
ê t r e remplacées p a r des germes représentés au fond des alvéoles: les racines s'aloiigent
progressivement de L en I IL , et les germes sont distribués à des profondeurs difiéreiites
et en raison directe du prolongement de ces racines.
Les trois molaires IV. V. V L , que j'appelle p r i m o r d i a l e s , ne sont jamais renouvellées
; la longueur de leurs racines décroît à mesure qu'elles s'éloignent des incisives, p ar
conséquent en l ' o r d r e inverse des premières.
F I G U R E II.
La mâchoire inférieure d'un très-jeune éléphant de Ceilan qui faisoit ci-devant p a r t ie
de la collection d u chirurgien Brookes à Londres. Cet habile anatomist© eut la complaisance
de me l a céder ; elle est r e p r é s e n t é e ici a u quart de sa grandeur et ouverte du côté
a. h. c. d. la seconde dent molaire composée d'onze plaques, e.f. d. représente la couronne
entamée p a r la mastication.
d. n. w. indiquent le siège de la première qui étoit d é j à tombée.
a. h. L m. i. g. la troisième dent molaire composée de treize p l a q u e s , dont les neuf dernières
étoient entièrement détachées les unes'des autres. Elles diminuent de longueur en
approchant de L m. k., espèce d'opercule osseux et mobile destiné à boucher par la suite
la fosse alvéolaire.
g. V. b. cloison osseuse qui sépare les racines de la seconde dent d ' a v e c celles de la
troisième.
q. s. r. h. l. m. le canal de l a m â c h o i r e i q a ^ e a o i t . l e nerf et les vaisseaux, q. s. r. l ' e n t r é e .
0. p. la réunion des mâchoires coupée p a r la scie. 0. a:, y. sa p a r t i e supérieure encore
assez tendre.
t. le condyle de la mâchoire, u. l'apophyse coronoïde.
Il est d é m o n t r é , par ce qui vient d ' ê t r e exposé, que l'éléphant a proprement trois
molaires dans les mâchoires inférieures et non d e u x , comme Daubenton l ' a r e m a r q u é ,
dans Vlfiscoire naturelle de Buffon, tome X I , page i 3 i.
F I G U R E I I I.
Représente l a quatrième plaque à compter de h. i. vers k. L
a. S. f . la face postérieure annonce la réunion de plusieurs petits cylindres excavés jusq
u ' e n 1. C'est par ». 9. que la substance molle et les vaisseaux sanguins entrent. ». 9. la
base vue p a r dessous, à coté de la figure principale.
F I G U R E IV.
C'est la dernière des plaques «. S, y. composée de deux cylindres
a. y. : elle est représentée de grandeur naturelle ; la base ouverte «
F I G U R E V.
applatis vers la base
t vue par dessous à
Est la huitième plaque de la dernière molaire de grandeur n a t u r e l l e , et représentée
p a r sa face postérieure. L'extrémité supérieure est marquée de six cylindres Icgérèment:
recourbés en avant. La base A. /x. est plus élargie et a p p l a t i e ; sa cavité s'étend jusqu'en
0. V. Daubenton en a représenté une p a r e i l l e , figure 0 , planche V I de l ' o u v r a g e cité.
T
il