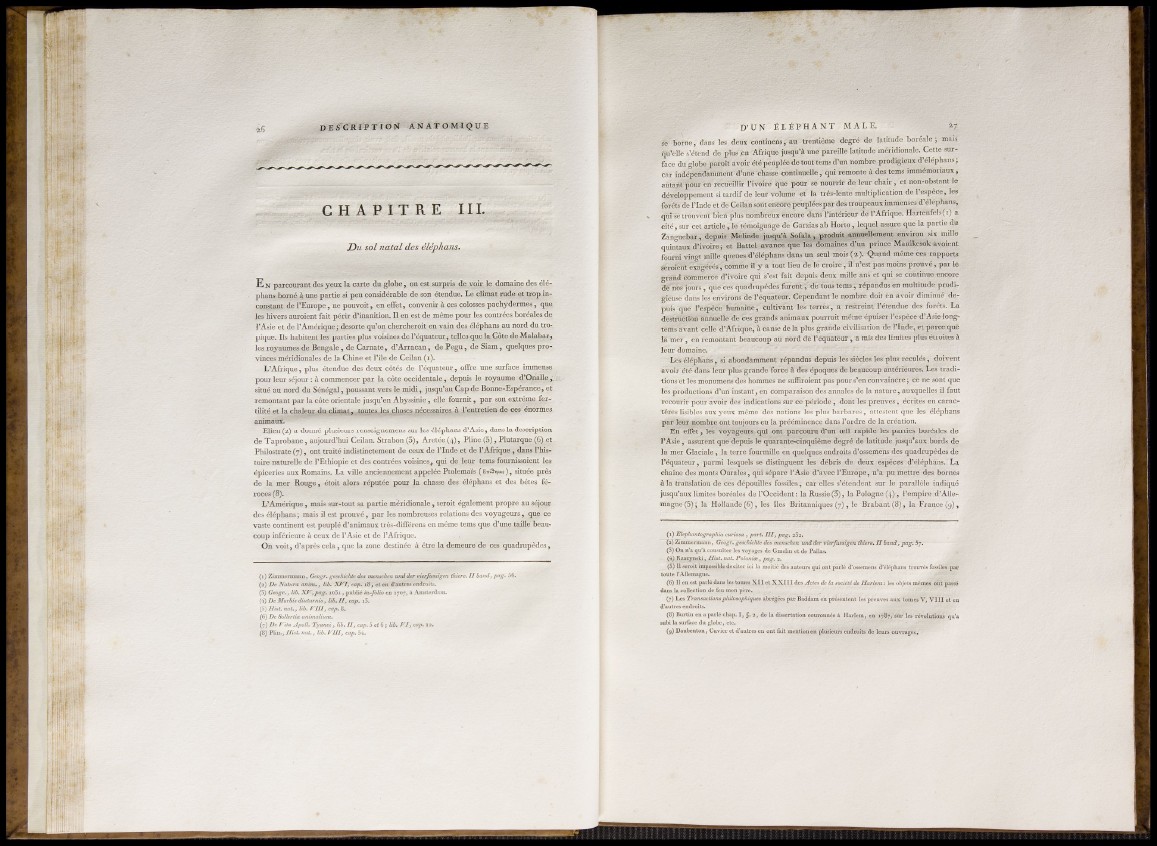
-rn
f
D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q UE
C H A P I T R E III.
Z)ii sol natal des éléphans.
E N parcourant des yeux la carte du globe, on est surpris de voir le domaine des éléplians
borné à une partie si peu considérable de son étendue. Le climat rude et trop inconstant
de TEurope, ne pouvoit, en effet, convenir à ces colosses pachydermes, que
les hivers auroient fait périr d'inanition. Il en est de même pour les contrées boréales de
l'Asie et de l'Amérique; desorte qu'on chercheroit en vain des éléphans au nord du tropique.
Ils habitent les parties plus voisines de Téquateur, telles que la Còte de Malabar,
les royaumes de Bengale, de Carnate, d'Arracan, de Pegu, de Siam, quelques provinces
méridionales de la Chine et l'île de Ceilan (i).
L'Afrique, plus étendue des deux côtés de l'équateur, oilVc une surface immense
pour leur séjour : à commencer par la côte occidentale, depuis le royaume d'OnalIe ,
situé au nord du Sénégal, poussant vers le midi, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, et
remontant par la côte orientale jusqu'en Abyssinie, elle fournit, par son extrême fertilité
et la chaleur du climat, toutes les choses nécessaires à l'entretien de ces énormes
animaux.
Elien (a) a donné plii--icurs rcniei^'nemens sur les éléphans d'Asie, dans la description
de Taprobane, aujourd'hui Ceilan. Strabon (5), Aretée (4), Pline ( 5 ) , Plutarque (6) et
Philostrate ( 7 ) , ont traité indistinctement de ceux de l'Inde et de l'Afrique, dans l'histoire
naturelle de l'Ethiopie et des contrées voisines, qui de leur tems fournissoient les
épiceries aux Romains. La ville anciennement appelée Ptolemaïs (E»anpaç), située près
de la mer Rouge, étoit alors réputée pour la chasse des éléphans et des bêtes féroces(
8).
L'Amérique, mais sur-tout sa partie méridionale, seroit également propre au séjour
des éléphans; mais il est prouvé, par les nombreuses relations des voyageurs, que ce
vaste continent est peuplé d'animaux très-différens en même tems que d'une taille beaucoup
inférieure à ceux de l'Asie et de rAfriijuc.
On voit, d'après cela, que la zone destinée à être la demeure de ces quadrupèdes,
(1) Zimracrmami, (Jeogr. gesuliklite (Us meruehtn urulder vUrfuaùgm thiere- II band, ¡¡ag. 06.
(2) DeKalura anim., lib. Xl^I, cap. 18, et en d'autres endroits.
(5) Geogr., lib. Xf^,paff. loôi, publié in-fulio en «707, à Amslertlatn.
{i)DeMvrbUdiuturnu, lib.II, cap. i5.
(.-)) iiut. mil., lib. rni, cap. a.
(6) De SolUrtia ¡mimalium.
(7) i)r / lia ApM. Tyaiui, lib. II, cap. Sel 6; lib. VI, cap. la.
(8) V\M.,llisl.'icit., lib.rai, wp.'oi.
D ' U N É L É P H A N T M A L E . 27
se borne, dans les deux continens, au trenliènie degré de latiwdc boréale; mais
qu'elle s'étend de plus .en Afrique jusqu'à une pareille latitude méridionale. Cette surface
du globe paroît avoir été peuplée de tout tems d'un nombre prodigieux d'éléphans ;
car indépendamment d'une chasse continuelle, qiù remonte à des tems immémoriaux,
autant pour en recueillir l'ivoire que pour se nourrir do leur chair, et non-obstant le
développement si tardif de leur volume et la très-lente multiplication de l'espèce, les
forêts de l'Inde et de Ceilan sont encore peupléespar des troupeaux immenses d'éléphans,
qui se trouvent bien plus nombreux encore dans l'inlérieur de l'Afrique. Hartenfels(i) a
cité, sur cel article, le témoignage de Garzias ab Horto, lequel assure que la partie du
Zangnebar, depuis Melinda jusqu'à Sofala, produit annucllemeiu environ .six mille
quimaux d'ivoire; et Battel avance que les domaines d'un prince Manikesok avoient
fourni vingt mille queues d'éléphans dans un seul mois ( 2 ) . Quand même ces rapports
seroient exagérés, comme il y a tout lieu de le croire, il n'est pas moins prouvé, par le
grand commerce d'ivoire qui s'est fait depuis deux mille ans et qui se continue encore
de nos jours, que ces quadrupèdes furent, de tous tems, répandas en multitude prodigieuse
dans les environs de l'équateur. Cependant le nombre doit en avoir diminué depuis
que l'espèce humaine, cultivant les terres, a restreint l'étendue des forêts. La
destruction annuelle de ces grands animaux pourroit même épuiser l'espèce d'Asie longtems
avant celle d'Afrique, à cause de la plus grande civilisation de l'Inde, et parce que
la mer, en remontant beaucoup au nord de l'équateur, a mis des limites plus étroites à
leur domaine.
Les éléphans, si abondamment répandus depuis les siècles les plus reculés, doivent
avoir été dans leur plus grande force à des époques de beaucoup antérieures. Les traditions
et les monumens des hommes ne suffiroient pas pour s'en convaincre ; ce ne sont que
les productions d'un instant, en comparaison des annales de la nature, auxquelles il faut
recourir pour avoir des indications sur ce période, dont les preuves, écrites en caractères
lisibles aux yeux mémo des nations les phis barbares, attestent que les éléphans
par leur nombre ont toujours eu la prééminence dans l'ordre de la création.
En effet, les voyageurs qui ont parcouru d'un oeil rapide les parties boréales de
l'Asie, assurent que depuis le quarante-cinquième degré de latitude jusqu'aux bords de
la mer Glaciale, la terre fourmille en quelques endroits d'ossemens des quadrupèdes de
l'équateur, parmi lesquels se distinguent les débris de deux espèces d'éléphans. La
chaîne des monts Ourales, qui sépare l'Asie d'avec l'Europe, n'a pu meure des bornes
à la translation de ces dépouilles fo-wiles, car elles s'étendent sur le parallèle indiqué
jusqu'aux limites boréales de l'Occident: la Russie(5), la Pologne ().), l'empire d'Allemagne
(5), la Hollande ( 6 ) , les îles Britanniques ( 7 ) , le Brabant ( 8 ) , la France ( 9 ),
(1) ElephantograpMa curiosa , part. ¡11, pag. sSs.
(s) Zimmei-iiiaiiu, Geogr. gesc/iic/tle des nifnsctien und der vierfussigm thiei-e. Il band, pag. 5;.
(5) Ou n'a qu'à coii»uller les voyagos de Gmelin et de Pallas.
(4) IlMzyuski, //¿¿.«ai. PoUmoe, pag.
(5) Il seroit impossible deciler ici ia uioilic des auteurs qui ont parié d'ossomens d'éléphans trouvé» fossiles par
toule l'Allemsgne.
(6) 11 en est parlé dans les Wmes XI1 et XXHI des .Âciss <& la soc.M de Harlem : les uUjels mêmes ont passé
dans lu colleclion de fou inun pòro.
(7) Los Traiisaciionsphilosophiques aljrégèe» par Baddain eu prcseulent les preuves aux tomes V, VIII et en
d'autres endroits.
(8) Burliu en u parlé thap. 1, 2 , de la diasertalion couronnée à Harlem, en 1787, sor les réTolutions qu'a
subi la aurCico du globo, etc.
(9) Daubenteu, Cuvicr ut d'autres eu ont fait menlioiien plusieurs endroits do leurs ouvrages.