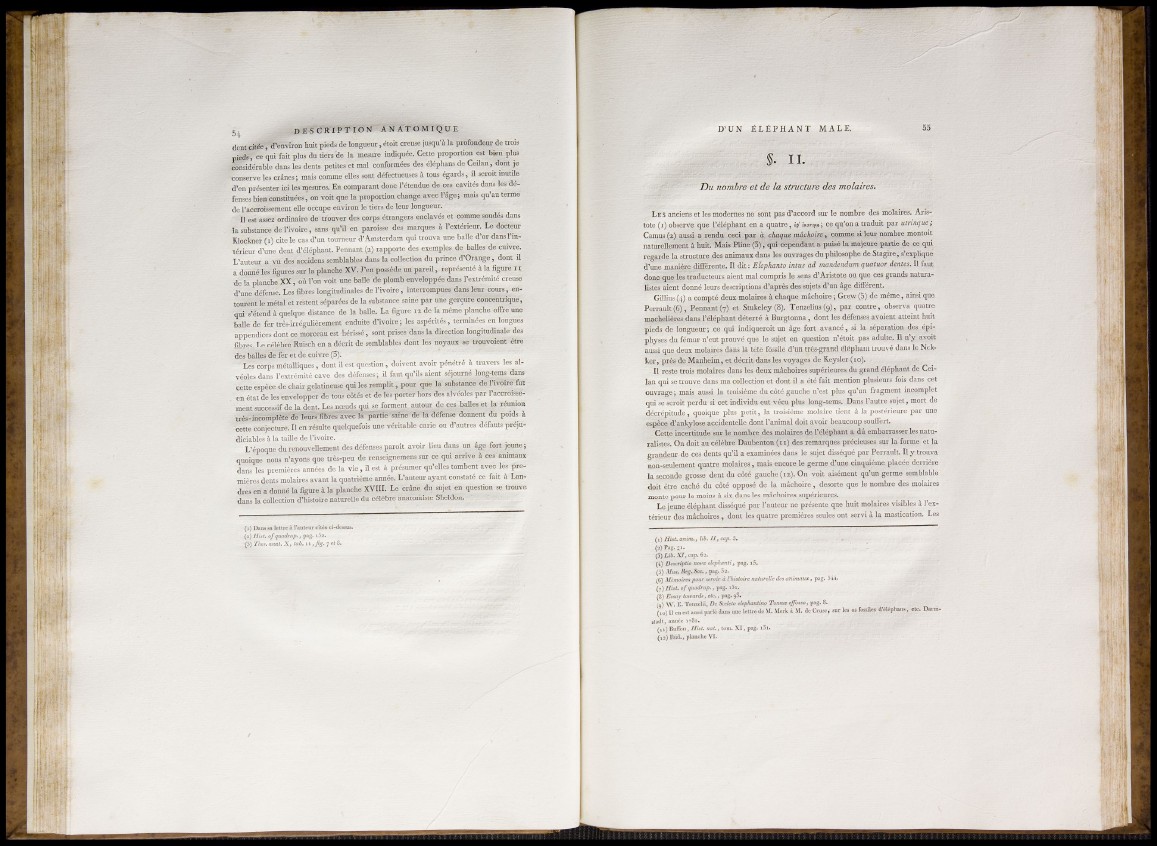
S.f- ii
t-t:-
l y - ? ' ;
i ' " , ;
|l
•fiijf i:
„ ' I k ' i I
s i í j a
Hfy
5-t
d e í c r i p t i o n a n a t o m i q u e
dent c i l í e , d'environ huit p i e d , de l o n g u e u r , étoit creuse jusqu'à lo profondeur de Bois
p i e d s , ee qui f a i t pins du d e r s de la mesure indiquée. Cette proportion est bien plus
considérable dans l e s dents petites et mal conformées des éléphans de C e i l a n , dont je
conser^-e les Crânes; mais comme elles sont défectueuses k tons é g a r d s , il seroit inutile
d ' e n présenter ici les mesnres. En comparant donc l'étendue de ces cavités dans les défenses
b i en constituées ; on voit que l a proportion c l i a n g e a v e c l ' â g e ; mais q u ' a u terme
de l'accroissement elle occupe environ l e t i e r s de l e u r longueur.
Il est assez ordinaire de trouver des corps é t r a n g e r s enclavés et comme soudés dans
l a substance de l ' i v o i i e , sans qu'il en paroisse des marques à l ' e n é r i e n r . Le docteur
KIockner ( t ) cite l e cas d ' u n tourneur d'Amsterdam qui trouva une b a l l e d'or d a n s l ' m -
t é r i e u t d'une dent d'élépbant. Pennant W rapporte des exemples de balles de cuivre.
L ' a u t e u r a vu des acoidens semblables dans l a collection du prince d ' O r a n g e , dont il
a donné les figures sut l a planche XV. J ' e n possède un p a r e i l , représenté à l a i g u r e 11
de l a planche X X , où l ' on voit une b a l l e de plomb enveloppée dans l ' e ï t r é m i t é ctouse
d'une défense. Les fibres longitudinales d e l ' i v o i r e , interrompues dans l e u r cours, entourent
l e métal et restent séparées d e l a substance saine p a r une g e r ç u r e concentrique,
qui s'étend à quelque distance de l a b a l l e . La figure t a de l a même planche o f i l e une
b a l l e de fer très-irrégulièrement enduite d ' i v o i r e ; les a s p é r i t é s , terminées en longues
appendices dont ce morceau est h é r i s s é , sont prises dans l a direction longitudinale des
fibres. Le célèbre Ruiscb eu a décrit de semblables dont les n o y a u i se trouvoient être
des b a l l e s de fer et de c u i v r e (5).
Les corps métallique s , dont il est question , doivent avoir p é n é t r é à t r a v e r s les a l -
véoles dans l ' e x t r é m i t é c a v e des défenses; U tant q u ' i l s aient séjourné long-tems dans
cette espèce d e chair gelatineuse qui l e s r e m p h t , pour que l a substance de l ' i v o i r e fut
e n état de les envelopper de tous côtés et de les p o n e r hors des a l v é o l e s p a r l'accroissement
successif d e l a dent. Les noeinis qui se forment autour de ces balles et l a réunion
t r è s - i n c o m p l è t e de l e i r i fibrei I v e o l a p i r t i e saine de l a défense donnent du poid.s à
cette conjecture. Il en résulte quelquefois une v é r i t a b l e c a r i e ou d'autres défauts p r é j u -
d i c i a b l e s à l a t a i l l e de l ' i v o i r e.
L'époque du renouvellement des défenses p a r o l t avoir lien dans un âge fort jeune ;
quoique nous n'ayons que t r è s - p e u de renseignemens sur ce qui a r r i v e à ces animaux
dans les p r e m i è r e s année, do l a v i e , il est à présumer q u ' e l l e s tombent a v e c les p r e -
mières dents molaires avant l a quatrième année. L ' a u t e u r a y a n t constaté ce f a i t à Londres
en a donné l a figure à l a planche XVIII. Le crâne du sujet en question se trouve
dans l a collection d'histoire n a t u r e l l e du c é l è b r e anatomiste Sheldon.
(1) Dans sa leUre à Tauteur citée ci-dcsaus.
( ï ) iliil. paß. l5a.
r/,«. «/wi. ÍOÉ. ii^yig. 7 8.
D ' U N É L É P H A N T M A L E . 55
§. IL
Du nombre et de la structure des molaires.
Le s anciens et les modernes ne sont pas d'accor<l sur l e nombre des molaires. Ansióte
( i ) observe que l'éléphant en a q u a t r e , ce qu'on a traduit p a r utrinque;
Camus ( a ) aussi a renda ceci p a r à chaque mâchoire, comme si l e u r nombre montoit
naturellement à huit. Mais Pline ( 3 ) , qui cependant a puisé l a majeure p a r t i e de ce qui
r e g a r d e l a structure des a n i m a u x dans les ouvrages du philosophe de S t a g i r e , s'explique
d'une manière dilTérente. Il dit : Elcphanto incus ad mandendum quatuor dentes. Il faut
donc que les t r a d u c t e u r s aient mal compris l e sens d ' A r i s t o t e ou que ces g r a n d s naturalistes
aient donné leurs descriptions d ' a p r è s des sujets d'un â g e diiTérent.
Gillius (4) a compté deux molaires à chaque mâchoire ; G r ew (5) de m ê m e , ainsi que
P e r r a u l t ( 6 ) , P e n n a n t ( 7 ) et S t u k e l e y ( 8 ) . T e n z e l i u s ( 9 ) , par contre, observa quatre
machelières dans l ' é l é p h a n t d é t e r r é à B u r g t o n n a , dont les défenses avoient atteint huit
pieds de longueur ; ce qui indiqueroit un âge fort a v a n c é , si l a séparaiion des epiphyses
du fémur n'eut prouvé que le sujet en question n'étoit pas adulte. Il n ' y avoit
aussi que deux molaii'es dans l a t ê t e fossile d'un très-grand éléphant trouvé dans l e Nekk
e r , p r è s d e M a n h e i m , et décrit dans les v o y a g e s de K e y s l e r ( r o ).
Il reste trois molaires dans l e s deux mâchoires supérieures du g r a n d éléphant de Ceil
a n qui se trouve dans ma collection et dont il a é l é fait mention plusieurs fois dans cet
o u v r a g e mais aussi la troisième du côté g a u c h e n'est plus qu'un fragment incomplet
qui se seroit p e r d u si cet i n d i v i d u eut v é c u plus long-tems. Dans l ' a u t r e s u j e t , mort de
d é c r é p i t u d e , quoique plus p e t i t , la troisième molaire tient à l a postérieure p a r une
espèce d ' a n k y l o s e a c c i d e n t e l l e dont l ' a n i m a l doit avoir beaucoup souHèrt.
Cette incertitude sur l e nombre des m o l a i r e s de l ' é l é p h a n t a dû embarrasser l e s naturalistes.
On doit a u c é l è b r e Daubenton ( i i ) des remarques précieuses sur l a forme et la
grandeur de ces dents q u ' i l a examinées dans le sujet disséqué p a r Perj auU. Il y trouva
non-seulement quatre m o l a i r e s , m a i s encore l e germe d'une cinquième p l a c é e derrière
l a seconde grosse dent du côté gauche ( l a ) . On voit aisément qu'un germe semblable
doit être caché du côté opposé de l a m â c h o i r e , desorte que le nombre des molaires
monte pour l e moins à six dans les mâchoires supérieures.
Le jeune éléphant disséqué p a r l ' a u t e u r ne présente que huit molaires visibles à l ' e x -
térieur des m â c h o i r e s , dont les q u a t r e premières seules ont vi à la masticatio Les
(,) Ilist. anim., lib. II, cap. S.
(ä)l>ag.
(3) Lib. Xf, c<ip. 62
(Í) Viscript pag. i5.
(5) -l/w. Reg.Soc., p.i«. 5
(6) Mcmuii'es pow lervir à l'histoire naturelle Jfs a
ofqiujilrup., yug. i5i.
(8) físiay towards, île., vag- g^*
(g) i;. Teiizolii, De Si-elfto eUpiumlino Tonnai effosso, pag.
(xo) 11 eu est «u»,i parló daiis uuc lelttedo -M. -Mei'k à M. de Ci-a
»„«U, anm'c ^-S-i.
( , i ) BulTt.ii, nat., lom. XI, pag. i3j.
(ia)Il)"l., plancho Vi.
jr Us os fossiles d'cléphans, «
H i