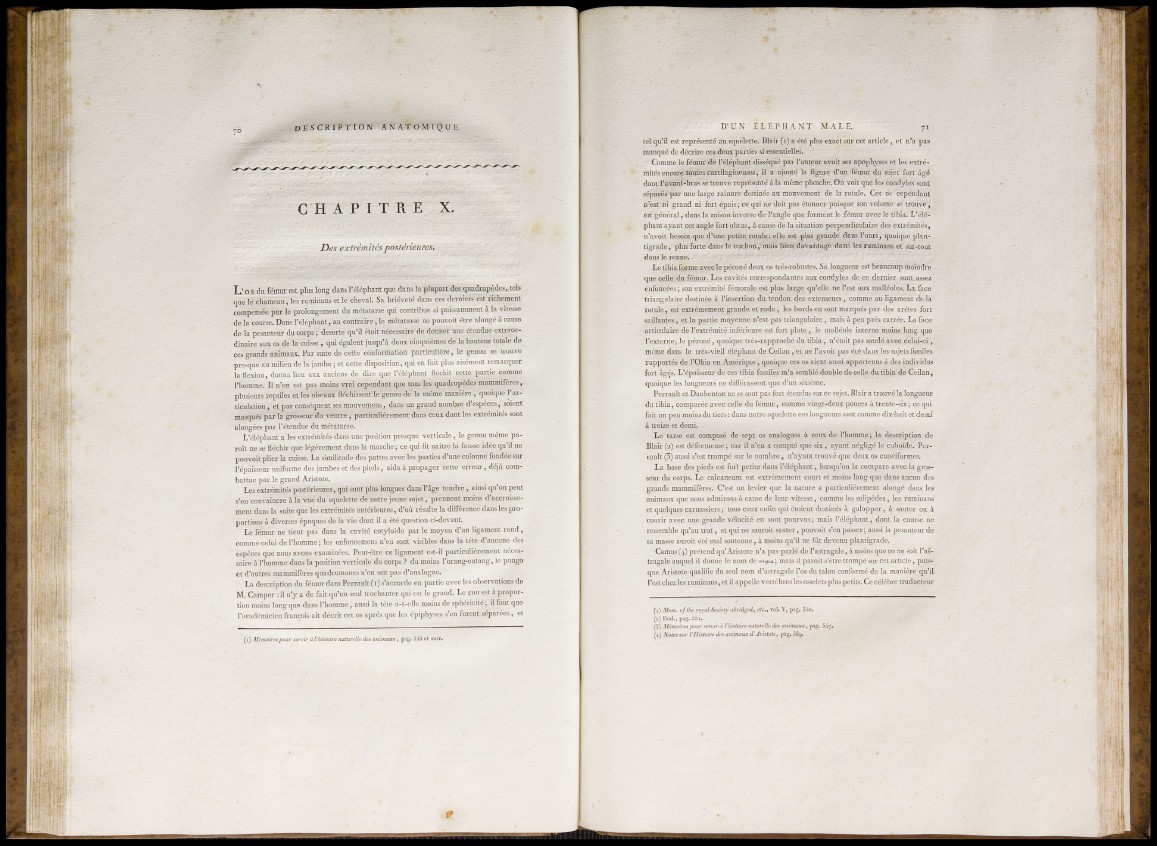
••ri '
niu'
D E S C R I P T I O N A N A T O M i g uE
C H A P I T R E X.
Des extrémités postérieures.
L ' o s du fémur est plus long dans l'éîéphant que dans la plupart des quadrupèdes, tels
que le chameau, les ruminans et le cheval. Sa brièveté dans ces derniers est richement
compensée par le prolongement du métatarse qui contribue ii puis.-^amment à la vitesse
de la course. Dans l'éléphant, au contraire, le métatarse ne pouvoit être alongé ù cause
de la pesanteur du corps ; desorte qu'il étoit nécessaire de donner une étendue extraordinaire
aux os de la cuisse, qui égalent jusqu'à deux cinquièmes de la hauteur totale de
ces grands animaux. Par suite de cette conformation particulière, le genou se trouve
presque au milieu de la jambe ; et cette disposition, qui en fait plus aisément remarquer
la flexion, donna lieu aux anciens de diie que l'éléphant fiéchit cette partie comme
l'homme. Il n'en est pas moins vrai cependant que tous les quadnipèdes mammifères,
plusi<mrs reptiles et les oiseaux fléchissent le genou de la même manière , quoique Varticulation,
et p a r conséquent ses mouvemens, dans un grand nombre d'espèces, soient
masqués par la grosseur du ventre, particolièrement dans ceux dont les extrémités sont
alongées par l'étendue du métatarse.
L'éléphant a les extrémités dans une position presque verticale, le genou même paxoît
ne se fiéchir que légèrement dans la marche ; ce qui lit naître la fausse idée qu'il ne
pouvoit plier la cuisse. La similitude des pattes avec les parties d'une colonne fondée sur
l'épaisseur uniforme des jambes et des pieds, aida à propager cette erreur, déjà combattue
par le grand Aristote.
Les extrémités postérieures, qui sont plus longues dans l'âge tendre, ainsi qu'on peut
s'en convaincre à la vue du squelette de notre jeune sujet, prennent moins d'accroissement
dans la suite que les extrémités antérieures, d'où résulte la diiFérence dans les proportions
à diverses époques de la vie dont il a été question ci-devant.
Le fémur ne tient pas dans la cavité cotyloïde par le moyen d'un ligament rond,
comme celui de l'homme ; les enfoncemens n'en sont visibles dans la téte d'aucune des
espèces que nous avons examinées. Peut-être ce ligament est-il particulièrement nécessaire
à l'homme dans la position verticale du corps ? du moins l'orang-outang, le pongo
et d'autres mammifères quadrumanes n'en ont pas d'analogue.
La description du fémur dans Perrault ( i ) s'accorde en partie avec les observations de
M. Camper :il n'y a de fait qu'un seul trochanter qui est le grand. Le pou est à proportion
moins long que dans l'homme, aussi la tête a-t-elie moins de sphéricité ; il faut que
l'GCadémicien françois ait décrit cet os après que les epiphyses s'en fuient séparée.s, et
(i) Mémoiret jwu à Vhistoire naturelle iki , pûg. 546 et »1
D ' U N É L É P H A N T MALE.
tel qu'il est représenté au squelette. Blair ( i) a été plus exact sur cet article, et n'a pas
manqué de décrire ces deux parties si essentielles.
Comme le fémur de l'éléphant disséqué par l'auteur avoit ses apophyses et les extrémités
encore toutes cartilagineuses, il a ajouté la figure d'un fémur du sujet fort âgé
dont l'avant-bras se trouve représenté à la même planche. On voit que les condyles .«ont
séparés par une large rainure destinée au mouvement de la rotule. Cet os cependant
n'est ni grand ni fort épais ; ce qui ne doit pas étonner puisque son volume se trouve,
en général, dans la raison inverse de l'angle que forment le fémur avec le tibia. L'éléphant
ayant cet angle fort obtus, à cause de la situation perpendiculaire des extrémités,
n'avoit besoin que d'une petite rotule: elle est plus grande dans l'ours, quoique plantigrade,
plus forte dans le cochon, mais bien davantage dans les ruminans et sur-tout
dans le l enne.
Le tibia forme avec le péroné deux os très-robustes. Sa longueur est beaucoup moindre
que celle du fémur. Les cavités correspondantes aux condyles de ce dernier sont assez
enfoncées ; son extrémité fémorale est plus large qu'elle ne l'est aux malléoles. La face
triangulaire destinée à l'insertion du tendon des extenseurs, comme au ligament de la
rotule, est extrêmement grande et rude, les bords en sont marqués par des arêtes fort
saillantes, et la partie moyenne n'est pas triangulaire, mais à peu près ca
articulaire de l'extrémité inférieure est fort plate, le malléole interne m<
l'externe; le péroné, quoique très-rapproché du tibia, n'étoit pas soudé a
même dans le très-vieil éléphant de Ceilan, et ne l'avoit pas été dans les sujets fossiles
rapportés de l'Ohio en Amérique, quoique ces os aient aussi appartenus à des individus
fort âgés. L'épaisseur de ces tibia fossiles m'a semblé double de celle du tibia de Ceilan,
quoique les longueurs ne différassent que d'un sixième.
Perrault et Daubenton ne se sont pas fort étendus sur ce sujet. Blair a trouvé la longueur
du tibia, comparée avec celle du fémur, comme vingt-deux pouces à trente-six ; ce qui
fait un peu moins du tiers : dans notre squelette ces longueurs sont comme dix-huit et demi
à treize et demi.
ie. La face
s long que
c celui-ci,
Le tarse est composé de sept os analogues à ceux de l'homme ; la description de
Blair (2) est défectueuse ; car il n'en a compté que six, ayant négligé le ciiboîde. Perrault
(3) aussi s'est trompé sur le nombre, n'ayant trouvé que deux os cunéiformes.
La base des pieds est foit petite dans l'éléphant, lorsqu'on la compare avec la grosseur
du corps. Le calcaneum est extrêmement court et moins long que dans aucun des
grands mammifères. C'est un levier que la nature a particulièrement alongé dans les
animaux que nous admirons à cause de leur- vitesse, comme les solipèdes, les ruminans
et quelques carnassiers; tous ceux enfin qui étoient destinés à galopper, à sauter ou à
courir avec une grande vélocité en sont pourvus ; mais l'éléphant, dont la course ne
ressemble qu'au trot, et qui ne sauroit sauter, pouvoit s'en passer ; aussi la pesanteur de
sa masse auroit été mal soutenue, à moins qu'il ne fût devenu plantigrade.
Camus ( j) prétend qu'Aristote n'a pas parlé de l'astragale, à moins que ce ne soit l'astragale
auquel il donne le nom de ttij.»; mais il paroit s'être trompé sur cet article, puisque
Aristote qualifie du seul nom d'astragale l'os du talon conformé de la manière qu'il
l'est chez les ruminans, et il appelle vertèbres les osselets plus petits. Ce célèbre traducteur
- ' I l
Il
Ì
vol. pag. 300.
{.J) ll.ul., p,ig. 55i.
(ô) Mémoins pour servir ri l'hialoire iialiireile des
(•») A'otei eur l'JIistoiiv lier iiiiinuiiir d'.ir is tote, pug.
.pfg. 5Ì7.