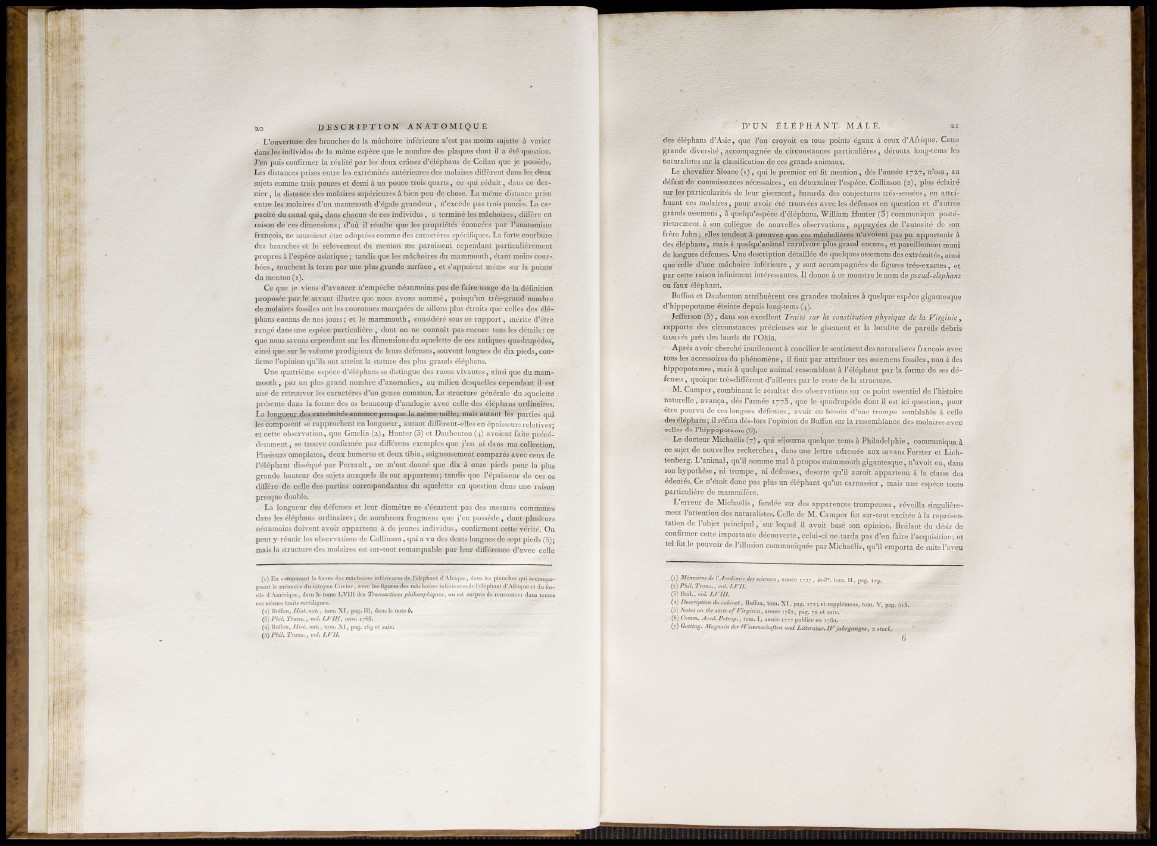
ao D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q UE
L'ouverture des branches de la mâchoire inférieure n'est pas moins sujette à varier
clans les individus de la même espèce que le nombre des plaques dont il a été question.
J'en puis coniirmer la réalité par les deux crânes d'élcphans de Ceilan que je possède.
Les distances prises entre les extrémités antérieures des molaires diUërent dans les deux
sujets comme trois pouces et demi à un pouce trois quarts, ce qui réduit, dans ce dernier
, la distance des molaires supérieures à bien peu de chose. La même distance prise
entre les molaires d'un mammouth d'égaje grandeur, n'excède pas trois pouces. La capacité
du canal qui, dans chacun de ces individus, a terminé les mâchoires, dilFère en
raison de ces dimensions ; d'où il résulte que les propriétés énoncées par l'anatomiste
françois, ne sauroient être adoptées comme des caractères spéciiiques. La forte courbure
des branches et le relèvement du menton me paroissent cependant particulièrement
propres à l'espèce asiatique ; tandis que les mâchoires du mammouth, étant moins courbées
, touchent la terre par une plus grande surface, et s'appuient même sur la pointe .
du menton ( i ).
Ce que je viens d'avancer n'empêche néanmoins pas de faire usage de la déilnition
proposée par le savant illustre que nous avons nommé, puisqu'un très-grand nombre
de molaires fossiles ont les couronnes marquées de sillons plus étroits que celles des éléphans
connus de nos jours ; et le mammouth, considéré sous ce rapport, mérite d'être
rangé dans une espèce particulière , dont on ne connoit pas encore tous les détails : ce
que nous savons cependant sur les dimensions du squelette de ces antiques quadrupèdes,
ainsi que sur le volume prodigieux de leurs défenses, souvent longues de dix pieds, confirme
l'opinion qu'ils ont atteint la stature des plus grands éléphans.
Une quatrième espèce d'éléphans se distingue des races vivantes, ainsi que du mammouth
, par un plus grand nombre d'anomalies, au milieu desquelles cependant il est
aisé de retrouver les caractères d'un genre commun. La structure générale du squelette
présente dans la forme des os beaucoup d'analogie avec celle des éléphans ordinaires.
La lr.n^if})ir f?PAeitrémitésimaitmecTpr<w|HPi la mwtTwtaille: mais autant les parties qui
les composent se rapprochent en longueur, autant dilTèrent-elIes en épaisseurs relatives;
et cette observation, que Gmelin (2), Hunter (3) et Daubenton (4) avoient faite précédemment
, se trouve confirmée par diftcrens exemples que j'en ai dans ma collection.
Plusieurs omoplates, deux humerus et deux tibia, soigneusement comparés avec ceux de
l'éléphant disséqué par Perrault, ne m'ont donné que dix à onze pieds pour la plus
grande hauteur des sujets auxquels ils ont appartenu; tandis que l'épaisseur de ces os
dinëre de celle des parties correspondantes du squelette en question dans une raison
presque double.
La longueur des défenses et leur diamètre ne s'écartent pas des mesures communes
dans les éléphans ordinaires; de nombreux fragmens que j'en possède, dont plusieurs
néanmoins doivent avoir appartenu à de jeunes individus, confirment cette vérité. On
peut y réunir les observations de Collinson, qui a vu des dents longues do sept pieds (5);
mais la structure des molaires est sur-tout remarquable par leur diflërence d'avec colle
(1) I''ii lompai'ant la rormc dcs màclioirc» inf<-riciircs de J'vli'phant (VAfi iciuc, ilaiia Ics pianeIk-s qui aoconipngncnl
le iiu-moire dii ciloyeii Ciivier, nvcc les figure» des maclioiici iurOiiciiirixIr IVlóplioul d'Afriyuecl du l'ossile
d'Ainéri<|iic, dans le tome J^VilI dea TianaiKlMin jì/iilosophiqiiN, ou esl surpris do leucuulier daua loulM
CCS mC-mM trails reclilignes.
(s) Buffon, 7/iii. «ai.. Ioni. XI, pag. 88, dans la nule 6.
(5) l'hil. Tran»., voi. Ll'lll, ann. 1768.
(i) UdHon, IIU. nal., toni. XI, pag. iGy el auiv.
(S) l'hil. Tram., vul.Lril.
D ' U N É L É P H A N T M A L E . ai
des éléphans d'Asie, que l'on croyoit en tous points égaux à ceux d'Afrique. Cette
grande diversité, accompagnée de circonstances particulières, dérouta long-tems les
naturalistes sur la classification de ces grands animaux.
Le chevalier S l o a n e ( i ) , qui le premier en fit mention, dès l'année 1727, n'osa, au
défaut de connoissances nécessaires, en déterminer l'espèce. Collinson (2), plus éclairé
sur les particularités de leur gisement, hasarda des conjectures très-sensées, en attribuant
ces molaires, pour avoir été trouvées avec les défenses en question et d'autres
grands ossemens, à quelqu'espèce d'éléphans. William Hunter ( 3 ) communiqua postérieurement
à son collègue de nouvelles observations, appuyées de l'autorité de son
frère John ; elles tendent à prouver que ces mâchclièi-es n'avoient pas pu appartenir à
des éléphans, mais à quelqu'animal carnivore plus grand encore, et pareillement muni
de longues défenses. Une description détaillée de quelques ossemens des extrémités, ainsi
que celle d'une mâchoire inférieure, y sont accompagnées de iigures très-exactes, et
par cette raison infiniment intéressantes. Il donne à ce monstre le nom de pseud-dephant
ou faux éléphant.
Buffon et Daubenton attribuèrent ces grandes molaires à quelque espèce gigantesque
d'hippopotame éteinte depuis long-tems (4).
Jeflerson ( 5 ) , dans son excellent Traité sur la constitution physique de la Virginie,
rapporte des circonstances précieuses sur le gisement et la localité de pareils débris
trouvés près des bords de l'Ohio.
Après avoir cherché inutilement à concilier le sentiment des naturalistes françois avec
tous les accessoires du phénomène, il finit par attribuer ces ossemens fossiles, non à des
hippopotames, mais à quelque animal ressemblant à l'éléphant par la forme de ses défenses
, quoique très-diflorent d'ailleurs par le reste de la structure.
M. Camper, combinant le résultat des observations sur ce point essentiel de l'histoire
naturelle, avança, dès l'année 1 7 7 5 , que le quadrupède dont il est ici question, pour
être pourvu de ces longues défenses, avoit eu besoin d'une trompe semblable à celle
des éléphans; il réfuta dès-lors l'opinion de BulFon sur la ressemblance.des molaires avec
celles de l'hippopotame (6).
Le docteur Michaëlis ( 7 ) , qui séjourna quelque tems à PhDadelphie, communiqua à
ce sujet de nouvelles recherches, dans une lettre adressée aux savans Forster et Lichtenberg.
L'animal, qu'il nomme mal à propos mdmmouth gigantesque, n'avoit eu, dans
son hypothèse, ni trompe, ni défenses, desorte qu'il auroit appartenu à la classe des
édentés. Ce n'étoit donc pas plus un éléphant qu'un carnassier, mais une espèce touts
particulière de mammifère.
L'erreur de Michaëlis, fondée sur des apparences trompeuses , réveilla singulièrement
l'attention des naturalistes. Celle de M. Camper fut sur-tout excitée à la représentation
de l'objet principal, sur lequel il avoit basé son opinion. Brûlant du désir de
confirmer cette importante découverte, celui-ci ne tarda pas d'en faire l'acquisition; eC
tel fut le pouvoir de l'illusion communiquée par Michaëlis, qu'il emporta de suite l'aveu
(1) Mémoires d«f.icadém!edgssciences, annio 1-37, in-8'. loin. Il, img. i-q.
(2) Phil. Tmns., vol. Lril.
(5) Ibid., .-oi./,/•///.
(i) Description dit cabinet, BufTon, torn. XI, pag. 172 ;el siipplémcns, torn, V, pag.
(b)Xoteson the itate of Virginia, ¡mnéi.'. 1782, pag. et suiv.
(6) Comm. Ac«<i. Petrop., torn. I, auiico 1777 publiée en 1780.
(7) Gotting. Magazin der ¡-Vissenschaften und Litteratur. IVjcJxrganges, 2 atuci.