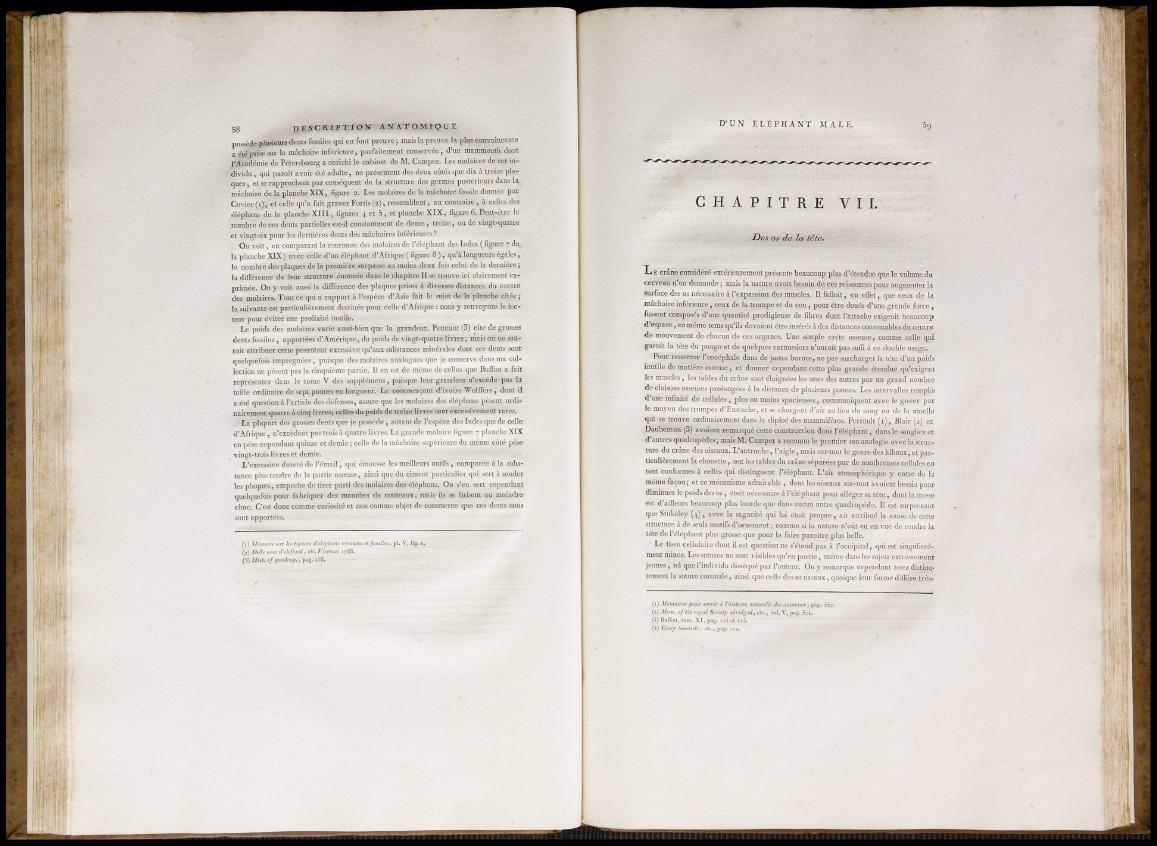
i
mil'
I I -
58 D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q UE
possède plusieurs deiUs fossiles qui en font preuve ; mais la preuve la plus convaincante
a été prise sur la mâchoire inférieure, parfaitement conservée, d'un mammouth dont
l'Académie de Pétersbourg a enrichi le cabinet de M. Camper. Les molaires de cet individu
, qui pareil avoir été adulte, ne présentent des deux côtés que d i s à treize plaques
, et se rapprochent par conséquent de la structure des germes postérieurs dans la
mâchoire de la planche X I X , figure a. Les molaires de la mâchoire fossile donnée par
C i i v i e r ( i ) , et celle qu'a fait graver F o r t i s ( a ) , ressemblent, au contraire, à celles des
éléphans de la planche X I I I , figures 4 et 5 , et planche X I X , figure 6. Peut-être le
nombre de ces dents partielles est-il constamment de douze, treize, ou de vingt-quatre
•et vingt-six pour les dernières dents des mâchoires inférieures?
On v o i t , en comparant la couronne des molaires de l'éléphant des Indes ( figure 7 de
la planche X I X ) avec celle d'un éléphant d'Afrique ( figure 8 ) , qu'à longueurs égales,
le nombre des plaques de la première surpasse au moins deux fois celui de la dernière ;
la différence de leur structure énoncée dans le chapitre II se trouve ici clairement exprimée.
On y voit aussi la différence des plaques prises à diverses distances du centre
des molaires. Tout ce qui a rapport à l'espèce d'Asie fait le sujet de la planche citée ;
]a suivante est particulièrement destinée pour celle d'Afrique : nous y renvoyons le lecteur
pour éviter une prolixité inutUe.
Le poids des molaires varie aussi-bien que la grandeur. Pennant (3) cite de grosses
dents fossiles, apportées d'Amérique, du poids de vingt-quatre livres ; mais on ne sauroit
attribuer cette pesanteur excessive qu'aux substances minérales dont ces dents sont
quelquefois impregnées, puisque des molaires analogues que je conserve dans ma collection
ne pèsent pas la cinquième partie. Il en est de même de celles que Builbn a fais
représenter dans le tome V des supplémens, puisque leur grandeur n'excède pas la
taille ordinaire de sept pouces en longueur. Le commerçant d'ivoire Wolffers, dont il
a été question à l'article des défenses, assure que les molaires des éléphans pèsent ordinairement
quatre à cinq livres; celles du poids de treize livres sont excessivement rares.
La plupart des grosses dents que je possède , autant de l'espèce des Indes que de celle
d'Afrique , n'excèdent pas trois à quatre livres, La grande molaire figure 7 planciie XIX
en pèse cependant quinze et demie i celle de la mâchoire supérieure du même côté pèse
vingt-trois livres et demie.
L'excessive dureté de l ' é m a i l , qui émoiisse les meilleurs outils, comparée à la substance
plus tendre de la partie osseuse, ainsi que du ciment particulier qui sert à souder
les plaques, empêche de tirer parti des molaires des éléphans. On s'en sert cependant
quelquefois pour fabriquer des manches de couteaux ; mais ils se brisent au moindre
choc. C'est donc comme curiosité et non comme objet de commerce que ces dents nous
sont apportées.
(2) JMIe 0, ,,M/<inU, el
«fi/oMiVfi.pl. V, fig. i.
(3) //¡'si. ofquadrnp., pag. i58.
D ' U N É L É P H A N T M A L É.
C H A P I T R E V IL
Des os de la t
L E crâne considéré extérieurement présente beaucoup plus d'étendue que le volume du
cerveau n'en demande j mais la nature avoit besoin de ces ressources pour augmenter la
surface des os nécessaire à l'expansion des muscles. II f a l l o i t , en eilet, que ceux de la
mâchoire inférieure, ceux de la trompe et du cou, pour être doués d'une grande f o r c e,
fussent composés d'une quantité prodigieuse de fibres dont l'attache exigeoit beaucoup
d'espace, en même tems qu'ils devoient être insérés à des distances convenables du centre
de mouvement de chacun de ces organes. Une simple crête osseuse, comme celle qui
garnit la tête du pongo et de quelques carnassiers n'auroit pas suffi à ce double usage.
Pour resserrer l'encéphale dans de justes bornes, ne pas surcharger la tête d'un poid^
inutile de matière osseuse, et donner cependant cette plus grande étendue qu'exigent
les muscles, les tables du crâne sont éloignées les unes des autres par un grand nombre
de cloisons osseuses prolongées à la distance de plusieurs pouces. Les intervalles remplis
d'une infinité de cellules, plus ou moins spacieuses, communiquent avec le gosier par
le moyen des trompes d'Eustache, et se chargent d air au lieu du sang ou de k moéllo
qui se trouve ordinairement dans le diploé des mammifères. Perrault ( i ) , Blair (2) et
Daubenton (5) avoient remarqué cette construction dans l'éléphant, dans le sanglier et
d'autres quadrupèdes; mais M. Camper a reconnu le premier son analogie avec la structure
du crâne des oiseaux. L'autruche, l'aigle, mais sur-tout le genre des hiboux, et particulièrement
la chouette, ont les tables du crâne séparées p a r de nombreuses cellules eu
tout conformes à celles qui distinguent l'éléphant. L'air atmosphérique y entre de la
même façon; et ce mécanisme admirable, dont les oiseaux sur-tout avoient besoin pour
diminuer le poids des o s , étoit nécessaire à l'éléphant pour alléger sa t ê t e , dont la masse
est d'ailleurs beaucoup plus lourde que dans aucun autre quadrupède. Il est surprenant
que Stukeley (4), avec la sagacité qui lui étoit propre, ait attribué la cause de celte
structure à de seuls motifs d'ornement ; comme si la nature n'eut eu en vue de icndre la
tête de l'éléphant plus grosse que pour la faire paroitre plus belle.
Le tisiu cellulaire dont il est question ne s'étend pas à l'occipital, qui est singulierèment
mince. Les sutures ne sont visibles qu'en partie, même dans les sujets extrememenc
jeunes, tel que l'individu disséqué par l'auteur. On y remarque cependant assez distinctement
la suture coronale, ainsi que celle des os nasaux, quoique leur forme dilFère très-
(1) ilèmairea pour leruir (i l'histoire naturelle des animaux, pag. St'j.
(a) Jlfcin. aj'tlif royal Avie/j- a/iriilgnlj etc., vol. p.ig. 321.
(3) Ii«iron,.om.XI,p.g. u i e t . i 5.