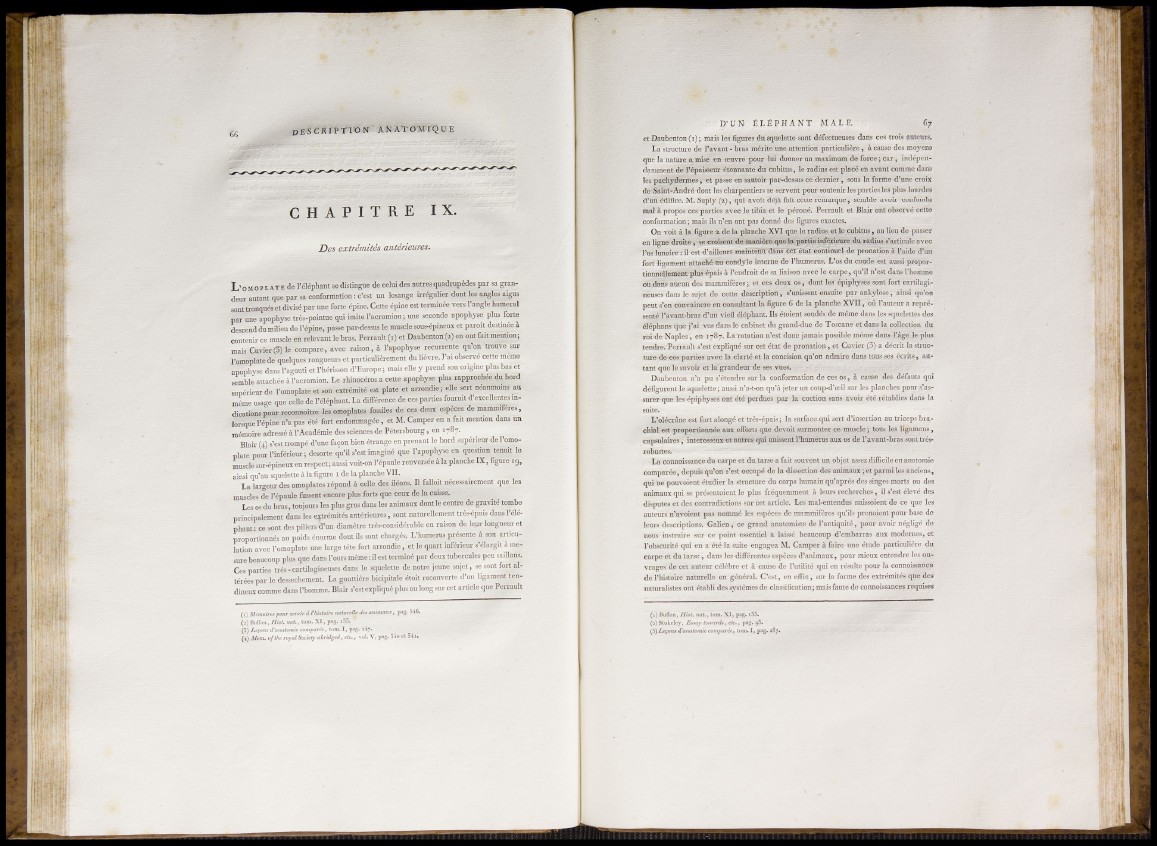
• .M • :
- i : ;.
mi-
« V ' 11
l i p i i
i
' ' l / i J
u
d e s c r i p t i o n a n a t o m i q u e
C H A P I T R E I X.
Des extrémités antérieures.
L - o M o p 1 AT I de réléphant se dijdngne de celui des autres quadrupèdes par sa grandeur
autant que par sa conformation : c'est un losange irrégulier dont les angles aigu,
sont tronqué, et divisé par une forte épine. Cette épine est terminée vers l'angle humerai
par une apophyse trè.-pointue qui imite l'actomion ; une .econde apophyse plus forte
descend du milieu de l'épine, passe pat-dessus le muscle sous-épincus et patoît destmée à
contenir ce muscle en relevant le bras. Perrault ( i ) et Daubcnton (a) en ont fait mention ;
mais Cuvier(3) le compare, avec raison, à l'apophyse récurrente qu'on trouve sur
l'omoplate de quelques rongueurs et particulièrement du lièvre. J ' a i observé cette même
apophyse dans l'agouti et l'hérisson d'Europe ; mais elle y prend son origmo plus bas et
semble attachée àl'acromion. Le rhinocéros a cette apophyse plus rapprochée du bord
supérieur de l'omoplate et son extrémité est plate et arrondie; elle sert neanmoms au
m L e usage que celle de l'éléphant. La différence de ces parties fournit d'eicellentes mdications
pour reconnoitre les omoplates fossile, de ces deuï espèces de mammifère.,
lorsque l'épine n'a pas été fort endommagée, et M. Camper en a fait mention dans un
mémoire adressé à l'Académie des sciences de Pétersbourg, en r 787.
Blait (4) . ' e . l trompé d'une façon bien étrange en prenant le bord .supérieur de l'omoplate
pour l'inférieur ; desorte qu'il .'est imaginé que l'apopliyse en question tenoit le
L s c l e sur-épineux en respect ; aussi voit-on l'épaule renversée à la planche I X , ligure t g,
ainsi qu'au squelette à la figure i de la planche V I I.
La largeur des omoplates répond à celle de. iléons. Il fallolt nécessairement que les
muscle, de l'épaule fusent encore plus forts que ceux de la onis.e.
Les os du bras, toujours les plus gros dons l e . animaux dont le centre de gravité tombe
principalement dan. les extrémités antérieures, .ont natittellement très-épais dans l'élcpham
; c e sont des piliers d'un diamètre très-considérable en raison de leur longueur et
proportionnés an poids énorme dont ils sont chargés. L'humenis présente à son articulation
avec l'omoplate une large tête fort arrondie, et le quart inférieur s'élargit fi mesure
beaucoup plus que dans l'ours même : il est terminé par deux tubercules peu saillans.
Ces parties très - cartilagineuses dans le squelette de nette jeune sujet, se sont fort altérées
pat le dessechement. La gouttière bicipitalo étoit rocoiivcrte d'un ligament tendineux
comme dans Fhomme. Blair s'est expliqué plus au long sur cet article que Perrault
, pag. 5iS.
(0 Mi-moires pour servir à l'hiatoire naturelle liea
(2)liiirroii,y/«/. nae., tum. X I , pag.
(5) I^çona U'anatomie comparée, lotn. I , pap.
(-i) ßlem. of the royalSwUly ahridged, etc., vol. V, paß. 3
D ' U N É L É P H A N T M A L E. G7
et Daubcnton ( i ) ; mais les figures du squelette sont défectueuses dans ces trois auteurs.
La structure de l'avant - bras mérite une attention particulière, à cause des moyens
que la nature a mise en oeuvre jjour lui donner un maximum do force ; c a r , indépendamment
de l'épaisseur étonnante du cubitus, le radius est placé en avant comme dans
les pachydermes, et passe en sautoir par-dessus ce dernier, sous la forme d'une croix
de Saint-André dont les charpentier.-; se servent pour soutenir les parties les plus lourdes
d'un édiiice. M. Suply ( 2 ) , qui avoit déjà fait cette remarque, semble avoir confondu
mal à propos ces parties avec le tibia et le pérono. Perrault et Blair ont observé cette
conformation; mais ils n'en ont pas donné des figures exactes.
On voit à la figure 2. de la planche XVI que le radius et le cubitus, au lieu de passer
en ligne droite, se croisent de manière que l a partie inférieure du radius s'articule avec
]'os lunaire : il est d'ailleurs maintêmî dans cet état continuel de pronation à l'aide d'un
fort ligament attaché au condyle interne de l'humerns. L'os du coude est aussi proportionnellement
plus épais à l'endroit de sa liaison avec le carpe, qu'il n'est dans l'homme
ou dans aucun des mammifères ; et ces deux os, dont les epiphyses sont fort cartilagineuses
dans le sujet de cette description, s'unissent ensuite par ankylose, ainsi qu'on
peut s'en convaincre en consultant la figure 6 do la planche X V I I , où l'auteur a représenté
l'avant-bras d'un vieil éléphant. Ils étoient soudés de même dans les squelettes des
éléphans que j'ai vus dans le cabinet du grand-duc de Toscane et dans la collcction du
roi de Naples, en 1787. La rotation n'est donc jamais possible même dans l'âge !e plus
tendre. Perrault s'est expliqué sui- cet état de pronation, et Cuvier (5) a décrit la structure
de ces parties avec la clarté et la concision qu'on admire dans tous ses écrits, autant
que le savoir et la grandeur de ses vues.
Daubenton n'a pu s'étendre sur l a conformation de ces o s , à cause des défauts qai
défigurent le squelette ; aussi n'a-t-on qu'à jeter un coup-d'oeil sur les planches pour s'assurer
que les épiphyses ont été perdues par la coction sans avoir été rétablies dans la
suite.
L'olécrâne est fort alongé et très-épais ; la surface qui sert d'insertion au triceps brachial
est proportionnée aux efforts que devoit surmonter ce muscle -, tous les ligamens,
capsulaires, interosseus et autres qui unissent l'humérus aux os de l'avant-bras sont trèsrobustes.
La connoissance du carpe et du tarse a fait souvent un objet assez difficile en anatomie
comparée, depuis qu'on s'est occupé de la dissection des animaux ; et parmi les anciens,
qui ne pouvoient étudier la structure du corps Iiumain qu'après des singes morts ou des
animaux qui se présentoient le plus fréquemment à leurs recherches, il s'est élevé des
disputes et des contradictions sur cet article. Les mal-entendus naissoient de ce que les
auteurs n'avoient pas nommé les espèces de mammifères qu'ils prenoient pour base do
leurs descriptions. Galien, ce grand anatomiste de l'antiquité, pour avoir négligé de
nous instruire sur ce point essentiel a laissé beaucoup d'embarras aux modernes, et
l'obscurité qui en a été la suite engagea M. Camper à faire une étude particulière du
carpe et du tarse, dans les difTérentes espèces d'animaux, pour mieux entendre les ouvrages
de cet auteur célèbre et à cause de l'utilité qui en résulte pour la connoissance
de l'histoire naturelle en général. C'est, en eflet, sur la forme des extrémités que des
naturalistes ont établi des systèmes de classification j mais faute de connoissances requises
(Oliunoii, nisl. «<ii., torn. X I , pas. i33.
(2) Stiikflry, Essnv luirar<U, etc., psg. gS.
[SyLeçoiiid'analu/iiie comparée, toiii. 1, pag. 287.