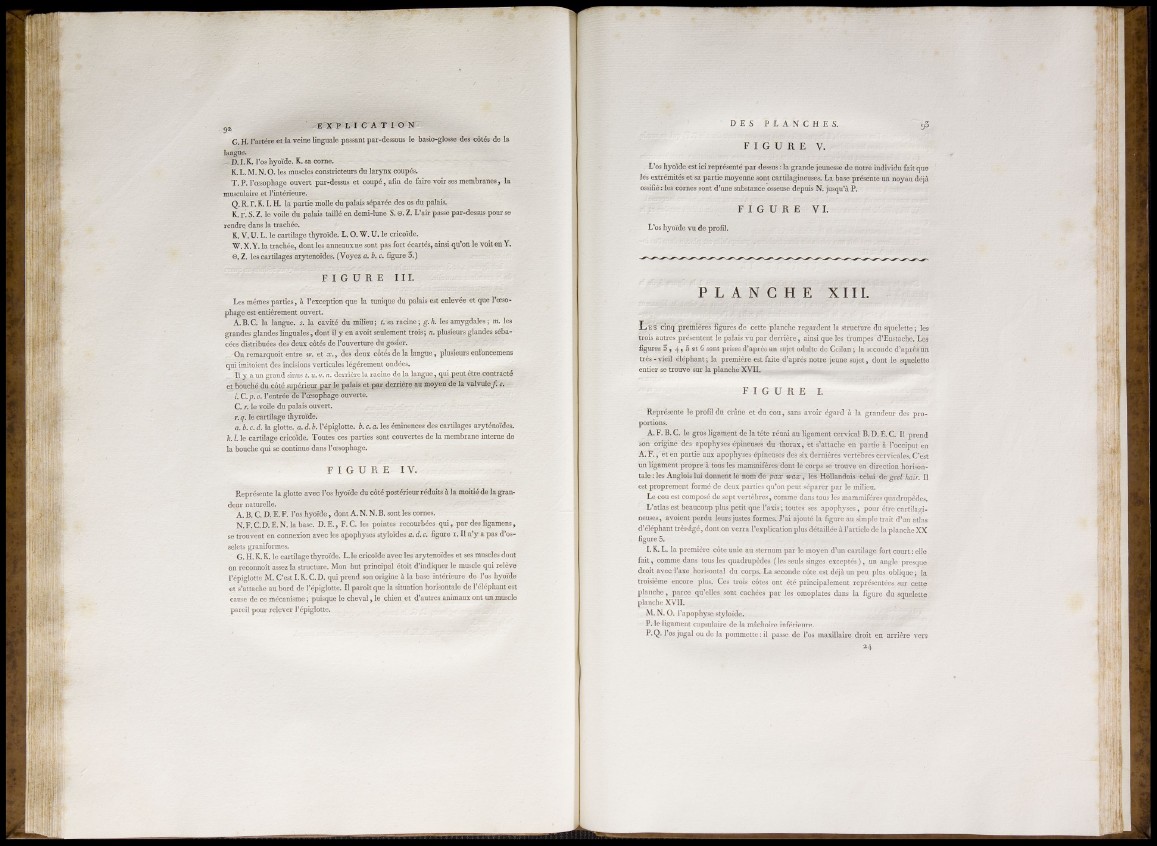
•I ,
il I ! 1
ìm^'
E X P L I C A T I O N
linguale passant pat-dessous le basio-glosse des côlcs de la
;smembranes, la
G. H. l'artère et la
langue.
J). I. K. l'os hyoïde. K. sa corne.
K. L. M. N. O. les muscles constricteurs du larynx coupés.
T . P . l'oesophage ouvert par-dessus et coupé, afin de faire voi
musculaire et l'intérieure.
Q. R. r . K, I. H. la partie molle du palais séparée des os du palai
K. T. S. Z. le voile du palais taillé en demi-lune S. 0. Z. L'
rendra dans la trachée.
K. V. U. L. le cartilage thyroïde. L. O. W. U. le cricoïdc.
W. X. Y. la trachée, dont les anneaux ne sont pas fort écartés, ainsi qu'on le voit en Y.
0. Z. les cartilages ar3rtenoïdes. (Voyez a. h. c. ligure 3.)
F I G U R E I I I.
Les mêmes parties, à l'exception que la tunique du palais est enlevée et que l'oesophage
est entièrement ouvert.
A. B. C. la langue, s. la cavité du milieu ; t. sa racine ; g. h. les amygdales ; m. les
grandes glandes linguales, dont il y en avoit seulement trois ; n. plusieurs glandes sébacées
distribuées des deux côtés de l'ouverture du gosier.
On remarquoit entre u>. et a:., des deux côtés de la langue, plusieurs enfoncemens
qui imitoient des incisions verticales légèrement ondées.
Il y a un grand sinus t. u. v. n. dciricrela racine de la langue, qui peut être contracté
et bouché du côté supérieur par le palais et par derrière au moyen de la valvule/, e.
1. C.p.o. l'entrée de l'oesophage ouverte.
C. r. le voile du palais ouvert.
r.q. le cartilage thyroïde.
a. b. c. d. la glotte, a. à. b. l'épiglotte. b. c. a. les eminences des cartilages aryténoïdes.
k. î. le cartilage cricoïde. Toutes ces parties sont couvertes de la membrane interne de
la bouche qui se continue dans l'oesophage.
F I G U R E IV.
Représente la glotte avec l'os liyoïde du côté postérieur réduits à la moitié de la grandeur
naturelle.
A. B, C. D. E. F. l'os hyoïde, dont A. N. N. B. sont les cornes.
N. F. C. D. E. N. la base. D. E . , F. C. les pointes recourbées qui, par des ligamens,
se trouvent en connexion avec les apophyses styloïdes a. d. c. figure i. Il n'y a pas d'osselets
graniformes.
G. H. K. K. le cartilage thyroïde. L.le cricoïdc avec les arytenoïdes et ses muscles dont
on reconnoît assez la structure. Mon but principal étoit d'indiquer le muscle qui relève
l'épiglotte M. C'est I.K.C.D. qui prend son origine à la base intérieure de l'os hyoïde
et s'attache au bord de l'épiglotte. Il paroît que la situation horisontale de l'éléphant est
cause de ce mécanisme ; puisque lu cheval, le chien et d'autres animaux ont un muscle
pareil pour relever l'épiglotte.
D E S P L A N C H E S . <p
F I G U R E V.
L'os hyoïde est ici représenté par dessus ,• la grande jeunesse de notre individu fait que
les extrémités et sa partie moyenne sont cartilagineuses. La base présente un noyau déjà
ossilié : les cornes sont d'une substance osseuse depuis N. jusqu'à P.
F I G U R E VI.
L'os hyoïde vu de profil.
P L A N C H E XIIL
L e s cinq premières figures de cette planche regardent la structure du squelette ; les
trois autres présentent le palais vu par derrière, ainsi que les trompes d'Eustache. Les
figures 3 , 4 , 5 et 6 sont prises d'après un sujet adulte de Ceilan ; la seconde d'après un
très - vieil éléphant ; la première est faite d'après notre jeune sujet, dont le squelette
entier se trouve sur la planche XVII.
F I G U R E I.
Représente le profil du crâne et du cou, s:
r égard à la grandeur des pro-
portions.
A. F. B. C. le gros ligament de la tête réuni au ligament cervical B. D. E, C. Il prend
son origine des apophyses épineuses du thorax, et s'attache en partie à l'occiput en
A. F . , et en partie aux apophyses épineuses des six dernières vertèbres cervicales. C'est
un ligament propre à tous les mammifères dont le corps se trouve en direction hori-iontale
: les Anglois lui donnent le nom de pax wax, les Hollandois celiù de gcei hair. II
est proprement formé de deux parties qu'on peut séparer par le milieu.
Le cou est composé de sept vertèbres, comme dans tous les mammifères quadrupèdes.
L'atlas est beaucoup plus petit que l'axis ; tontes ses apophj-ses, pour être cartilagineuses,
avoient perda leurs justes formes. J'ai ajouté la figure au simple trait d'un atJns
d'éléphant très-âgé, dont on verra l'explication plus détaillée à rarticle de la pianelle XX
figure 5.
I. K. L. la première côte unie au sternum par le moyen d'un cartilage fort court ; elle
fait, comme dans tous les quadrupèdes (les seuls singes exceptés), un angle presque
droit avec l'axe hori.sontal du corps. La seconde còte est déjà un peu plus oblique; la
troisième encore plus. Ces trois côtes ont été principalement représentées sur cette
planche, parce qu'elles sont cachées par les omoplates dans la figure du squelette
planche XVII.
M. N. O. Fupopliyse styloide.
P, le ligameiu rapsulaire de la mâchoire inférieure.
P.Q. l'osjugal ou do la pommette: il passe de l'os maxillaire droit en arrière vers
14