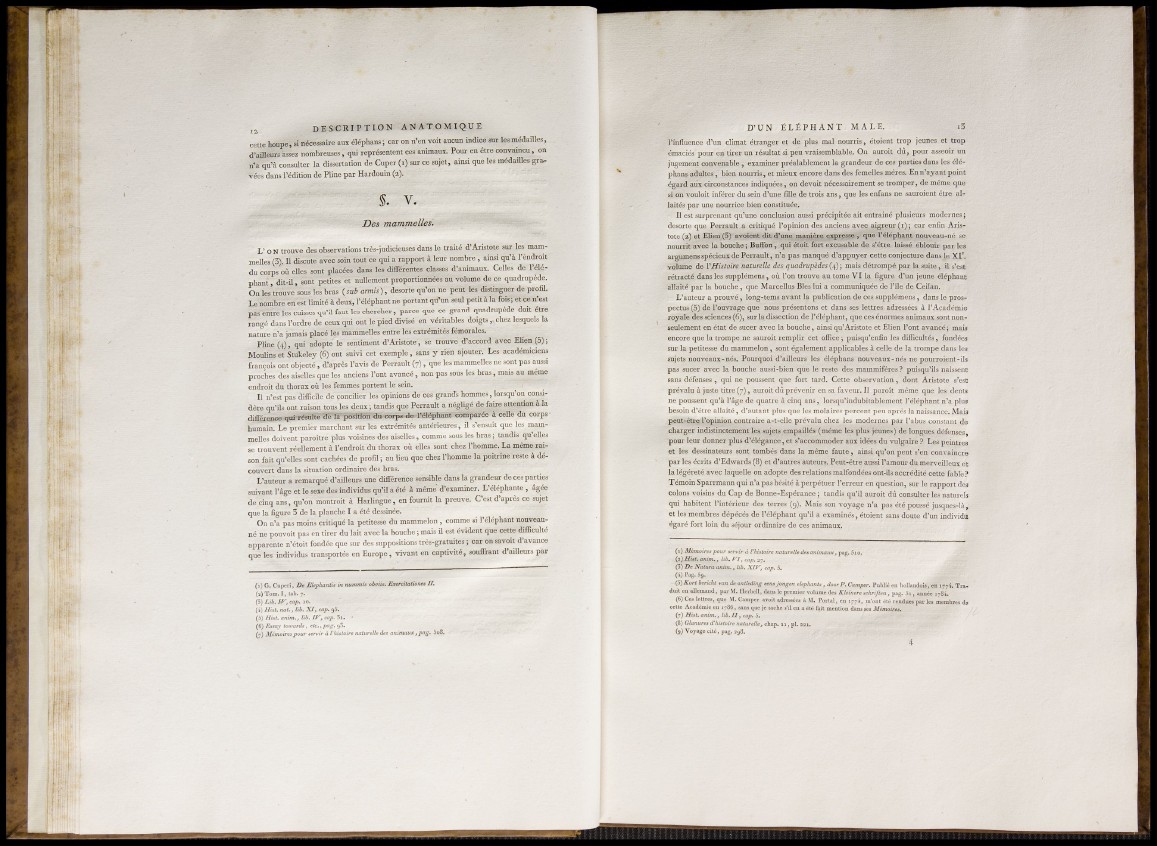
D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q UE
cette honpe, si nécessaire aux é l é p h am ; c a t on n ' e n voit aucun indice sur les médailles,
d'ailleurs assez nombreuses, qui représentent ces a n i m a u l . Pour en être c o n v a i n c u , on
n ' a q u ' à consulter la dissertation do Cuper ( i ) snr ce s u j e t , ainsi que les médailles g t a,
vées dans l ' é d i t i on de P l i n e p a r Hardouin (a>
§. V.
Des mammelles.
L' ON t r o u v e des observations très-iiidicieuses dans le t r a i t é d'Aristote sur les mammelles
(3). Il discute avec soin tout ce qui a r a p p o r t à leur nombre , ainsi q u ' à l'endroit
du corps où elles sont placées dans les diflerentes classes d'animaux. Celles de l ' é l é -
p l i a i u , d i t - n , sont petites et nullement proportionnées au volume de ce quadrupède.
On les trouve sous les b r a s ( sub amis ) , desorte q u ' o n ne peut les distinguer de profU.
Le nombre en est limité à deux, l'éléphant ne p o r t a n t q u ' u n seul p e t i t à la fois ; e t ce n'est
p a s entre les cuisses qu'il f a u t les c h e r c h e r , p a r c e que ce g r a n d quadrupède doit être
r a n g é dans Tordre de ceux qui ont le p i e d divisé en véritables doigts,, chez lesquels la
n a t u r e n ' a jamais p l a c é les mammelles entre les extrémités fémorales.
Pline ( 4 ) , qui adopte le sentiment d ' A r i s t o t e , se t r o u v e d ' a c c o r d avec Elien (5) ;
MouUns et Stuîceley (6) ont suivi cet exemple . sans y rien ajouter. Les académiciens
françois ont o b j e c t é , d ' a p r è s l ' a v i s de P e r r a u l t ( 7 ) , que les mammelles ne sont pas aussi
proches des aiselles que les anciens l ' om a v a n c é , non p a s sous les b r a s , mais au même
endroit du thorax où les femmes p o r t e n t le sein.
Il n'est pas difficile d e concilier les opinions d e ces grands hommes, lorsqu'on consid
è r e qu'ils ont raison tous les deux i tandis que P e r r a u l t a négligé de f a i r e attention à la
différence qui résulte de l a position du corps de l ' é l é p h a n t comparée à celle d u corpshumain.
Le premier m a r c h a n t sur les extrémités a n t é r i e u r e s , il s'ensuit que les mammelles
doivent p a r o î t r e plus voisines des aiselles, comme sous les bras ; tandis qu'elles
se t r o u v e n t réellement à l ' e n d r o i t d u t h o r a x où elles sont chez l'homme. La même r a i -
son fait qu'elles sont cachées d e p r o f d ; au lieu que chez l'homme la p o i t r i n e reste à découvert
dans la situation o r d i n a i r e des bras.
L'auteur a r e m a r q u é d'ailleurs une différence sensible dans l a g r a n d e u r de ces parties
suivant l ' â g e et le sexe des individus qu'il a é t é à même d'examiner. L'éléphante , âgée
de cinq a n s , q u ' o n montroit à H a r l i n g u e , en fournit l a preuve. C'est d ' a p r è s ce sujet
que la figure 3 de la planche I a é t é dessinée.
On n ' a pas moins c r i t i q u é l a petitesse du mammelon , comme si l'éléphant nouveauné
ne pouvoit pas en t i r e r du lait a v e c l a bouche ; mais il est évident que celte difficulté
a p p a r e n t e n'étoit fondée que sur des suppositions t r è s - g r a t u i t e s ; c a r on savoit d ' a v a n ce
que les individus transportés en E u r o p e , vivant en c a p t i v i t é , souffrant d'ailleurs par
(i) G. Cuperi, De EUphanlii in
(а)Toin. Í, lab. 7.
(5) Lib. IV, cap, 10.
(i) IlUi. nat., lib. XI, cap. gS.
(5) //¿>i. anim-, lib. IV, cap. Si,
(б) T.s»ay lowardt, flc.,pag.
(7) Mémoireupour
mis obviii. Exercilationes II.
l'histoire naturelle dea
D ' U N É L É P H A N T M A L E . i3
l'influence d'un climat étranger et de plus mal n o u r r i s , étoient t r o p jeunes et t r op
émaciés pour en t i r e r un résultat si peu vraisemblable. On auroit d û , pour asseoir un
jugement convenable , examiner préalablement la grandeur de ces p a r t i e s dans les éléphans
a d u l t e s , bien nourris, et mieux encore dans des femelles mères. E n n ' a y a n t point
é g a r d aux circonstances indiquées, on devoit nécessairement se t r o m p e r , de même que
si on vouloit inférer du sein d ' u n e fille de trois a n s , que les enfans n e sauroient ê t r e allaités
p a r une nourrice bien constituée.
Il est surprenant qu'une conclusion aussi p r é c i p i t é e ait entraîné plusieurs modernes;
desorte que Perrault a critiqué l'opinion des anciens avec a i g r e u r ( i ) ; car enfin Aristote
(z) et EJien (3) avolent dit d ' u n e manière expresse , que l ' é l é p h a n t nouveau-no se
nourrit avec la bouche ; BuiTon, qui étoit fort excusable de s'être laissé éblouir p a r les
argumensspécieux de P e r r a u l t , n ' a pas manqué d ' a p p u y e r cette conjecture dans le X I ',
volume de VHistoire naturelle des quadrupèdes mais détrompé p a r la s u i t e , il a'est
r é t r a c t é dans les supplémens, où l'on trouve au tome V I la figure d'un jeune éléphant;
allaité p a r l a b o u c h e , que Marcellus Bles lui a communiquée de l'île d e Ceilan.
L'auteur a p r o u v é , long-tems avant la publication de ces s u p p l é m e n s , dans le prospectus
(5) de l'ouvrage que nous présentons et dans ses lettres adressées à l'Académie
r o y a l e des sciences (6), sur la dissection de l ' é l é p h a n t , que ces énormes animaux sont nonseulement
en état de sucer avec la b o u c h e , ainsi qu'Aristote et Elien l'ont a v a n c é ; mais
encore que la trompe ne sauroit remplir cet office ; puisqu'enfin les difficultés, fondées
sur la petitesse du mammelon, sont également applicables à celle d e la trompe dans les
sujets nouveaux-nés. Pourquoi d'ailleurs les éléphans nouveaux-nés ne p o u r r o i e n t - i ls
p a s sucer avec la bouche aussi-bien que le reste des mammifères? puisqu'ils naissent
sans d é f e n s e s , qui ne poussent que fort tard. Cette o b s e r v a t i o n , dont Aristote s'est
p r é v a l u à juste titre ( 7 ) , auroit dû p r é v e n i r en sa faveur. Il paroit même que les dents
ne poussent qu'à l'âge de q u a t r e à cinq a n s , lorsqu'indubitablement l'éléphant n'a plus
besoin d ' ê t r e a l l a i t é , d'autant plus que les molaires pprccnt peu après la naissance. Mais
p e u t - ê t r e l'opinion contraire a - t - e l l e p r é v a l u chez les modernes p a r l'abus constant de
charger indistinctement les sujets empaillés (même les plus jeunes) de longues défenses
pour leur donner plus d ' é l é g a n c e , et s'accommoder aux idées du vulgaire ? Les peintres
et les dessinateurs sont tombés dans la même f a u t e , ainsi q u ' o n peut s'en convaincre
p a r les écrits d ' E d w a r d s (8) et d ' a u t r e s auteurs. P e u t - ê t r e aussi l'amour du merveilleux ec
la l é g è r e t é avec laquelle on adopte des relations malfondées ont-ils a c c r é d i t é cette f a b l e?
Témoin S p a r r m a n n qui n ' a p a s hésité à p e r p é t u e r l ' e r r e u r en question, sur le r a p p o r t des
colons voisins du C a p de Bonne-Espérance ; tandis qu'il auroit du consulter les naturels
qui habitent l'intérieur des terres (9). Mais son v o y a g e n ' a pas été poussé jusques-là,
et les membres dépécés de l ' é l é p h a n t qu'il a examinés, étoient sans doute d'un individu
égaré fort loin du séjour ordinaire de ces animaux.
(1) Mémoires pour »fMr à Vhittoire naturelle dei animauj;, pag. 5io.
(2)Hiel. anim., Ub. Vl. cap. 37.
(3) De aninx., Ub. Xir, cap. 5.
(i) Pag. 59.
(S)Kori bericht van de onlleding —0 eens jongen eUplianls,, "doorP.VW ± . Camper.K^uatpm. Publié l uuiie en en liollaudoia,.nona
duit
alleiuand, pai'M. Hci-bell, daiis ¡e premier volume des Kleinere ichrißen , pag. 5i, «me
(6) Cea Ifllres, que Vt. Camper avoìt adre»sécs à M. Porla), en 177-*, m'out étc renduea por li
elle Academic en 1786, sana que je Sache Vii en a étù feit mention dans ses Mémoires.
(7) MUt. anim., lib. I I , cap. 5.
(8) Olanuree d'hisloire natwelle, cliap. 11, pi. 231.
(9) Voyage cite, pag. 298.
4
1784.
> membres de
m