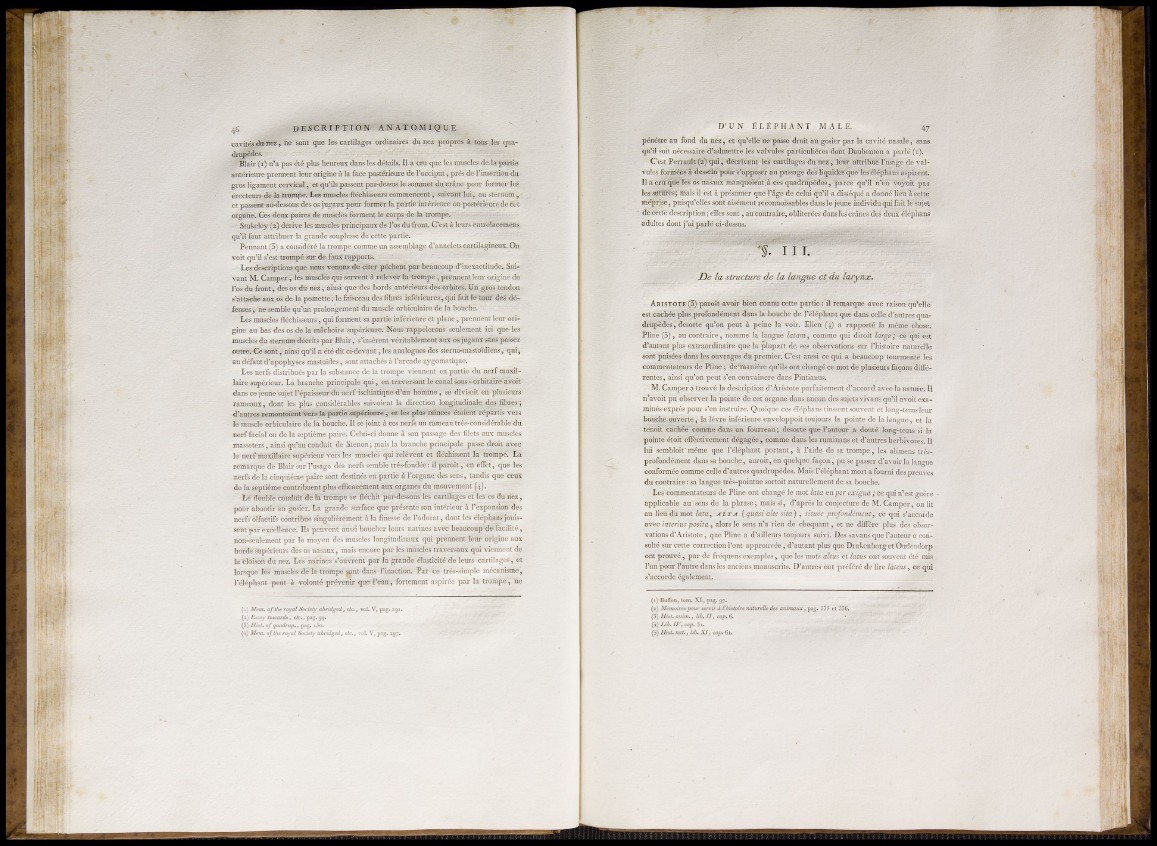
w
D E S C R I P T I O N A N A T O M I Q U E
cavités du nez, ne sont que les cartilages ordinaires du nez propres à tous les quadiupèdes.
Blair ( i ) n'a pas été plus heureux dans les détails. Il a cru que les muscles de.Ia partie
antérieure prennent leur origine à la face postérieure de l'occipui, pròs de l'insertion du
gros ligament cervical, et qu'ils passent par-dessus le sommet du crâne pour former les
érecteurs de la trompe. Les muscles fléchisseurs commencent, suivant lui, au sternum,
et passent au-dessous des os j u g a u i pour former la partie intérieure on postérieure de ci. L
organe. Ces deux paires de muscles forment le corps de la trompe.
Stukeley (2) dérive les muscles principaux de l'os du front. C'est à leurs entrelacemens
qu'il faut attribuer la grande souplesse de cette partie.
Pennant (3) a considéré la trompe comme un assemblage d'annelets cartilagineux. On
voit qu'il s'est trompé sor de faux rapports.
Les descriptions que nous venons de citer pochent par beaucoup d'inexactitude. Suivant
M. Camper, les muscles qui serrent h relev-er la trompe, prennent leur origine de
l'os du front, des os du nez, ainsi que des bords antérieurs des orbites, UJI gros tendon
s'attache aux os de la pomette ; le faisceau des fibres inférieures, qui fait le tour des défenses,
ne semble qu'un prolongement du muscle orbiculaire de la bouche.
Les muscles fléchisseurs, qui forment sa partie inférieure et p l a n e , prennent leur origine
au bas des os de la mâchoire supérieure. Nous rappelerons seulement ici que les
muscles du sternum décrits par Blair, s'insèrent véritablement aux os jugaux sans passer
outre. Ce sont, ainsi qu'il a été dit ci-dcvant, les analogues des sterno-mastoïdiens, qui,
au défaut d'apophyses mastoïdes, sont attachés à l'arcade zygomatique.
Les nerfs distribués p a r la substance de la trompe viennent en partie du nerf maxillaire
supérieur. L a branche principale qui, en traversant le canal sous - orbitaire avoit
dans ce jeune sujet l'épaisseur du nerf ischiatique d'un homme, se divisoit en plusieurs
rameaux, dont les plus ponsidérables suivoient la direction longitudinale des fibres ;
d'autres remontoient vers la partie supérieure, et les plus minces étoient répartis vers
le muscle orbiculaire de la bouche. Il se joint à ces nerfs un rameau très-considérable du
nerf facial ou de la septième paire. Celui-ci donne à son passage des filets aux muscles
masseters, ainsi qu'au conduit de Stenon; mais la branche principale passe droit avec
le nerf maxQlaire supérieur vers les muscle.- qui relèvent et fléchissent la trompe. La
remarque de Blair sur l'usage des nerfs semble très-fondée : il p a r o î t , en effet, que les
nerfs de la cinquième paire sont destinés en partie à l'organe des sens, tandis que ceux
de la septième contribuent plus efficacement aux organes du mouvement (4).
Le double conduit de la trompe se fléchit par-dessous les cartilages et les os du nez,
pour aboutir au gosier. L a grande surface que présente son intérieur à l'expansion des
nerf< olfactifs contribue singulièrement à la finesse de l'odorat, dont les éléphans jouissent
par excellence. Ils peuvent aussi boucher leurs narines avec beaucoup de facilité,
non-seulement par le moyen des muscles longitudinaux qui prennent leur origine aux
bords supérieurs des os nasaux, mais encore p a r les muscles traversaux qui viennent de
la cloison du nez. Les narines s'ouvrent par la grande élasticité de leurs cartilages, et
lorsque les muscles de la trompe » n t dans l'inaction. Par ce très-.siniple jnécanisme,
l'éléphant peut à volonté prévenir que l ' e a u , fortement aspirée par la trompe, no
(1) .l/em. of lite royal Society abridged, ele., vol. V, pjg. agi.
(a) Kaay towards, etc., piig. 99.
(5) Ili,l. of<¡,uidrup., pig. I.-.O.
(í) Mem. oflìie royal Society abridged, etc., \ ul. pag. 397.
D ' U N É L É P H A N T M A L E. 47
pénètre au fond du nez, et qu'elle ne passe droit au gosier par la cavité nasale, sans
qu'il soit nécessaire d'admettre les valvules particulières dont Daubcnion a parlé ( i ).
C'est Perrault (2) q u i , décrivant les cartilages du nez, leur attribua l'usage de valvules
formées à dessein pour s'opposer au passage des liquides que les éléphans aspirent.
Il a cru que les os nasaux manquoient à ces quadrupèdes, parce qu'il n'en voyoit pas
les sutures; mais il est à présumer que l'âge de celui qu'il a disséqué a donné lieu à cette
méprisé, pui.squ'elles sont aisément reconnoissables dans le jeune individu qui fait le sujet
de cette description ; elles sont, au contraire, oblitérées dans les crânes des deux éléphans
adultes dont j'ai parlé ci-dessus.
' § . 1 1 1 .
De la structure de la langue cl du larynx.
ARISTOTE (3) paroît avoir bien connu cette partie : il remarque avec raison qu'elle
est cachée plus profondément dans la bouche de l'éléphant que dans celle d'autres quadrupèdes,
desorte qu'on peut à peine la voir. Elien (}.) a rapporté la même chose.
Pline ( 5 ) , au contraire, nomme la langue latam, comme qui diroit large ; ce qui est
d'autant plus extraordinaire que la plupart de ses observations sur l'histoire naturelle
sont puisées dans les ouvrages du premier. C'est aussi ce qui a beaucoup tourmenté les
commentateurs de Pline ; de-manière qu'ils ont changé ce mot. de plusieurs façons différentes,
ainsi qu'on peut s'en convaincre dans Pintianus.
M.Camper a trouvé ladesciiption d'Aristote parfaitement d'accord avec la nature. Il
n'avoit pu observer la pointe de cet organe dans aucun des sujets vivans qu'il avoit examinés
exprès pour s'en instruire. Quoique ces éléphans tinssent souvent c£ loiiç-tems leur
bouche ouverte, la lé\Te inférieure enveloppoit toujours la pointe de la langue, et ia
tenoit cachée comme dans un fourreau; desorte que l'auteur a douté long-tems si la
pointe étoit effectivement dégagée, comme dans les ruminans et d'autres herbivores. Il
lui semble it ' même que l'éléphant portant, à l'aide de sa trompe, les alimens trèsprofondément
dans sa bouche, auroit,en quelque façon, pu se passer d'avoii-la langue
conformée comme celle d'autres quadrupèdes. Mais l'éléphant mort a fourni des preuves
du contraire : sa langue très-pointue sortoit naturellement de sa bouche.
Les commentateurs de Pline ont changé le mot lata en per exigua; ce qui n'est guère -
applicable au sens de la phrase; mais s i , d'après la conjecture de M. Camper, on lit
au lieu du mot lata, ALT A {quasi alte sita) , située profondément, ce qui s'accorde
avec interiiis posita, alors le sens n'a rien de choquant, et ne diffère plus des observations
d'Aristote, que Pline a d'ailleurs toujours suivi. Des savans que l'auteur a consulté
sur cette correction l'ont approuvée, d'autant plus que Drakenborg et Oudcndorp
ont prouvé, par de frtkiuens exemples, que les mots nltus et laius ont souvent été mis
l'un pour l'autre dans les anciens manuscrits. D'autres ont préféré de lire lalens, ce qui
s'accorde également.
<.)Iλtlon,ton.. Xt.iKig.
(a) Mcinuii-es pour servir à l'hiétoire natureUe des
(3) Iliit. anim., lib. I l , cap. 6.
(.,) Lib. j r . cap. 5 K
{5)Jiiit. mit., lib. XI, c<i/>. 6i.