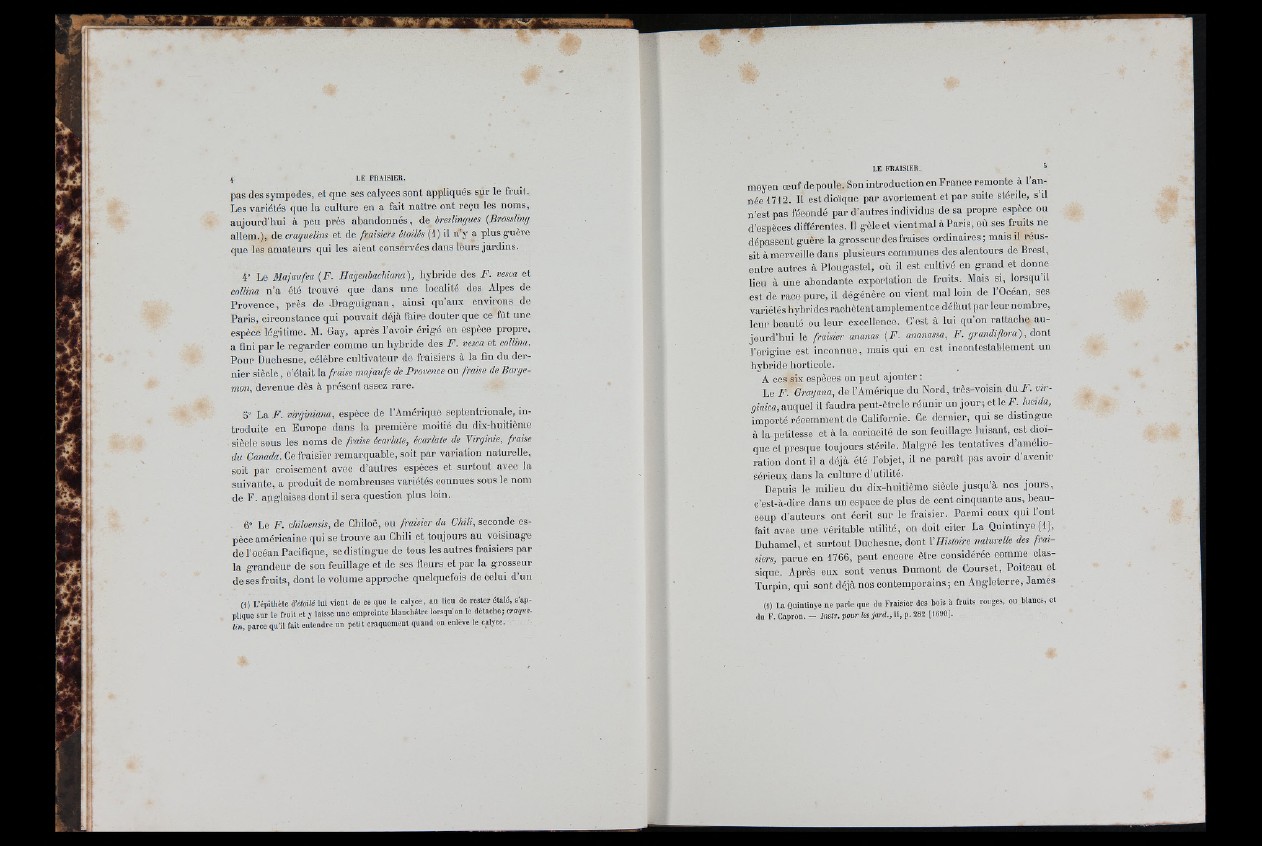
4 LE FRAISIER.
pas dessympodes, et que ses oalyces sont appliqués sur le fruil.
Les variétés que la culture en a fait na ître ont reçu les noms,
aujourd'hui à peu près abandonnés, de bresUngues {Brôssling
allem.), de craquelins et de fraisiers étoilés (1) il n ’y a plus guère
que les amateurs qui les aient conservées dans leurs ja rdins.
4° Le Majaufea {F. Hagenbachiana), hybride des F. vesca et
collina n ’a été trouvé que dans une localité des Alpes de
Provence, près de .D rag u ig n an , ainsi q u ’au.x environs de
Paris, circonstance qui pouvait déjà faire douter que ce fût une
espèce légitime. M. Gay, après l’avoir érig é en espèce propre,
a fini par le re g a rd e r comme un hybride des F . vesca et collina.
P our Duohesne, célèbre cultivateur de fraisiers à la fin du dern
ie r siècle, c’était la fraise tnxijaufe de Provence ou fraise de Barge-
mon, devenue dès à présent assez rare.
5“ La F. virginiana, espèce de l ’Amérique septentrionale, introduite
en Europe dans la première moitié du dix-huitième
siècle sous les noms de fraise écarlate, écarlate de Virginie, fraise
du Canada. Ce fraisier remarquable, soit par variation naturelle,
soit p a r croisement avec d ’autres espèces et surtout avec la
suivante, a produit de nombreuses variétés connues sous le nom
de F. anglaises dont il sera question plus loin.
e- Le F. chiloensis, de Chiloë, ou fraisier du Chili, seconde espèce
américaine qui se trouve au Chili et toujours au voisinage
de l’océan Pacifique, se d istingue de tous les autres fraisiers par
la g ran d e u r de son feuillage et de ses fleurs et p a r la grosseur
de ses fruits, dont le volume approche quelquefois de celui d ’un
(1) L’ép ith è le i'a o ilé lui vient de ce que le c a lj c e , au lieu de rester étalé, s'applique
sur le fruit et y laisse une empreinte blanchâtre lorsqu'on le détache; craquelin
, parce qu’il fait eiilendro un petit craquement quand on enlève le calyce.
LE FRAISIER. ^
moyen oe u f d e p o u l e . Son introduction en France remonte à l’a n née
1712. Il est dio’ique p a r avortement et p a r suite stérile, s il
n ’est pas fécondé p a r d’autres individus de sa propre espèce ou
d ’espèces différentes. Il gèle et vien tra a l àP a ris , où ses fruits ne
dépassent guère la grosseur des fraises ordinaires; mais il réu s sit
à merveille dans plusieurs communes des alentours de Brest,
entre autres à Plougastel, où il est cultivé en g ran d et donne
lieu à une aliondante exportation de fruits. Mais si, lorsqu il
est de race pure, il dégénère ou vient mal loin de 1 Océan, ses
variétés hybrides rachètent amplement ce défaut par leur nombre,
leu r beauté ou leur excellence. C’est à lui qu ’on rattache aujo
u rd ’hui le fraisier ananas [F. ananassa, F. grandiflora), iovii
l’origine est inconnue, mais qui en est incontestablement un
hybride horticole.
A ces six espèces on peut ajouter :
Le F. Grayana, de l’Amérique du Nord, très-voisin du F. vir-
ÿtntc«, auquel il faudra peut-être le ré u n ir un jo u r; e lle F. lucida,
importé récemment de Californie. Ce dernier, qui se distingue
à la petitesse et à la coriaoité de son feuillage luisant, est dioi-
que et p resque toujours stérile. Malgré les tentatives d ’amélioration
dont il a déjà été l’objet, il ne p a ra ît pas avoir d ’avenir
sérieux dans la culture d’utilité.
Depuis le milieu du dix-huitième siècle ju sq u ’à nos jo u rs ,
c’est-à-dire dans un espace de plus de cent cinquante ans, beaucoup
d ’auteurs ont écrit su r le fraisier. Parmi ceux qui l’ont
fait avec une véritable utilité, on doit citer La Quintmye (1),
Duhamel, et surtout Duchesne, dont VHistoire naturelle des fraisiers,
parue en 1766, peut encore être considérée comme classique.
Après eux sont venus Dumont de Courset, Poiteau et
Turpin, qui sont déjà nos contemporains; en Angleterre, James
(1) La Quinlinye n e parle que du Fraisier des bois à fruits rouges, ou blancs, et
du F. CaproD.— i/isir . powr/es ja r d ., 1!, p. 282 [1690].