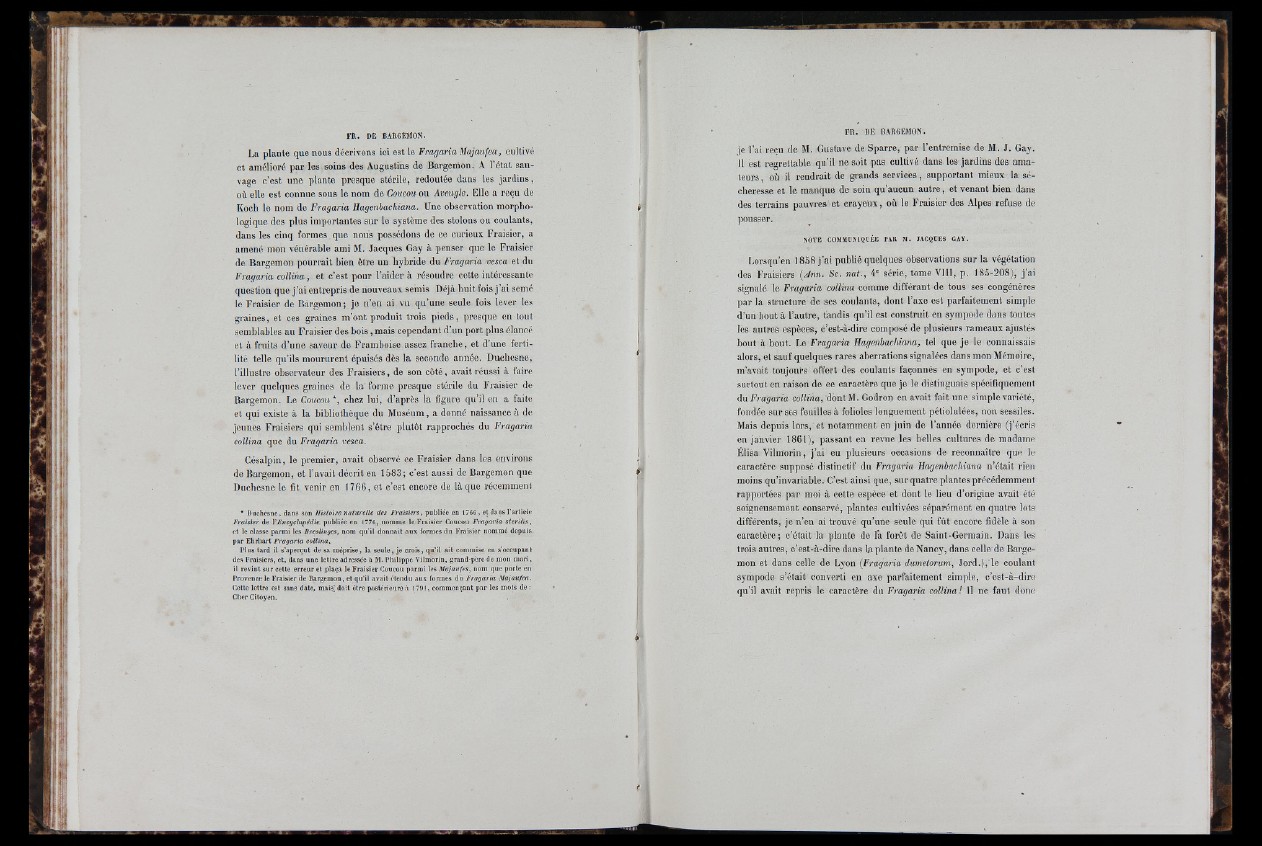
F i l . DE BAnOEMOtl.
La plante que nous décrivons ici est le Fragaria Majaufea, cultivé
et amélioré par les soins des Augustins de Bargemon. A l’état sauvage
c’est une plante presque stérile, redoutée dans les jardins,
où elle est connue sous le nom de Coucou ou Aveugle. Elle a reçu de
Koch le nom de Fragaria Hagenbachiana. Une observation morphologique
des plus importantes sur le système des stolons ou coulants,
dans les cinq formes que nous possédons de ce curieux Fraisier, a
amené mon vénérable ami M. Jacques Gay à penser que le Fraisier
de Bargemon pourrait bien être un hybride du Fragaria vesca et du
Fragaria collina, et c’est pour l’aider à résoudre cette intéressante
question que j ’ai entrepris de nouveaux semis Déjà liuit fois j ’ai semé
le Fraisier de Bargemon; je n ’en ai vu qu’une seule fois lever les
graines, et ces graines m’ont produit trois pieds, presque en tout
semblables au Fraisier des bois, mais cependant d’un port plus élancé
et à fruits d’une saveur de Framboise assez franche, et d’une fertilité
telle qu’ils moururent épuisés dès la seconde année. Duchesne,
l’illustre observateur des Fraisiers, de son côté, avait réussi à faire
lever quelques graines de la forme presque stérile du Iiraisier de
Bargemon. Le Coucou*, chez lui, d’après la figure qu’il en a faite
et qui existe à la bibliothèque du Muséum, a donné naissance à de
jeunes Fraisiers qui semblent s’être plutôt rapprochés du Fragaria
collina que du Fragaria vesca.
Césalpin, le premier, avait observé ce Fraisier dans les environs
de Bargemon, et l’avait décrit en 1583; c’est aussi de Bargemon que
Duchesne le fit venir en 1766, el c’est encore de là que récemment
* D u c h e sn e , d a n s so n H is to ir e n a tu r e lle d e s F r a is i e r s , p u b lié e en 17C0, e t d a n s r a r l ic le
F r a is ie r d e Y E n c y e la p é d ie p u b lié e e n 1770, n om m e le F r a is ie r C o u c o u F r a g a r ia s t e r i l i s ,
e t le c la s s e p a rm i le s S r e s ü n g e s , n om q u 'i l d o n n a it a u x fo rm e s d u F r a is ie r n om m é d e p u is
p a r E h r h a r t F r a g a r ia c o llin a .
P lu s t a r d il s ’a p e r ç u t d e s a m é p r i s e , la s e u le , J e c ro i s , q u ’il a i t c om m is e e n s’o c c u p a n t
d e s F r a is ie rs , e t , d a n s u n e le tt r e a d re s s é e à M. P h ilip p e V ilm o r in , g r a n d -p è r e d e m o n m a r i ,
il r e v in t s u r c e tte e r r e u r e l p la ç a le F r a i s ie r C o u c o u p a rm i le s M a ja u fe s , n om q u e p o r te en
P ro v e n c e le F r a is ie r d e B a rg em o n , e l q u ’il a v a it é te n d u a u x fo rm e s d u F r a g a r ia M a ja u fe a .
C e lte le ttr e e s t s a n s d a te , ma is] d o it ê tre p o s té r ie ii ro â 1791, c om m e n ç a n t p a r le s m o ts d e ;
C h e r C ito y e n .
?
F R . DE BzVRGEMON.
je l’ai reçu de M. Gustave de Sparre, par l’enlremise de M. J. Gay.
Il est regrellable qu’il ne soit pas cultivé dans les jardins des amateurs,
où il rendrait de grands services, supportant mieux la sécheresse
et le manque de soin qu’aucun autre, et venant bien dans
des terrains pauvres et crayeux, où le Fraisier des Alpes refuse de
pousser.
NOTE COMMUNIQUÉE PAR M. JACQUES GAY.
borsqu’en 1858 j ’ai publié quelques observations sur la végétation
des Fraisiers {Hnn. Sc. nat., 4® série, tome VllI, p. 185-208), j ’ai
signalé le Fragaria collina comme différant de tous ses congénères
par la structure de ses coulants, dont l’axe est parfaitement simple
d’un bout à l’autre, tandis qu’il est construit en sympode dans toutes
les autres espèces, c’est-à-dire composé de plusieurs rameaux ajustés
bout à bout. Le Fragaria Hagenbachiana, tel que je le connaissais
alors, et sauf quelques rares aberrations signalées dans mon Mémoire,
m’avait toujours offert des coulants façonnés en sympode, et c’est
surtout en raison de ce caractère que je le distinguais spécifiquement
du Fragaria collina, dont M. Godron en avait fait une simple variété,
fondée sur ses feuilles à folioles longuement pétiolulées, non sessiles.
Mais depuis lors, et notamment en juin de l’année dernière (j’écris
en janvier 1861), passant ea revue les belles cultures de madame
Élisa Vilmorin, j ’ai eu plusieurs occasions de reconnaître que le
caractère supposé distinctif du Fragaria Hagenbachiana n’était rien
moins qu’invariable. C’est ainsi que, sur quatre plantes précédemment
rapportées par moi à cette espèce et dont le lieu d’origine avait été
soigneusement conservé, plantes cultivées séparément en quatre lots
différents, je n’en ai trouvé qu’une seule qui fût encore fidèle à son
caractère; c’était la plante de la forêt de Saint-Germain. Dans les
trois autres, c’est-à-dire dans la plante de Nancy, dans celle de Bargemon
et dans celle de Lyon (Fragaria dumetorum, Jord.), le coulant
sympode s’était converti en axe parfaitement simple, c’est-à-dire
qu’il avait repris le caractère du Fragaria collina! Il ne faut donc