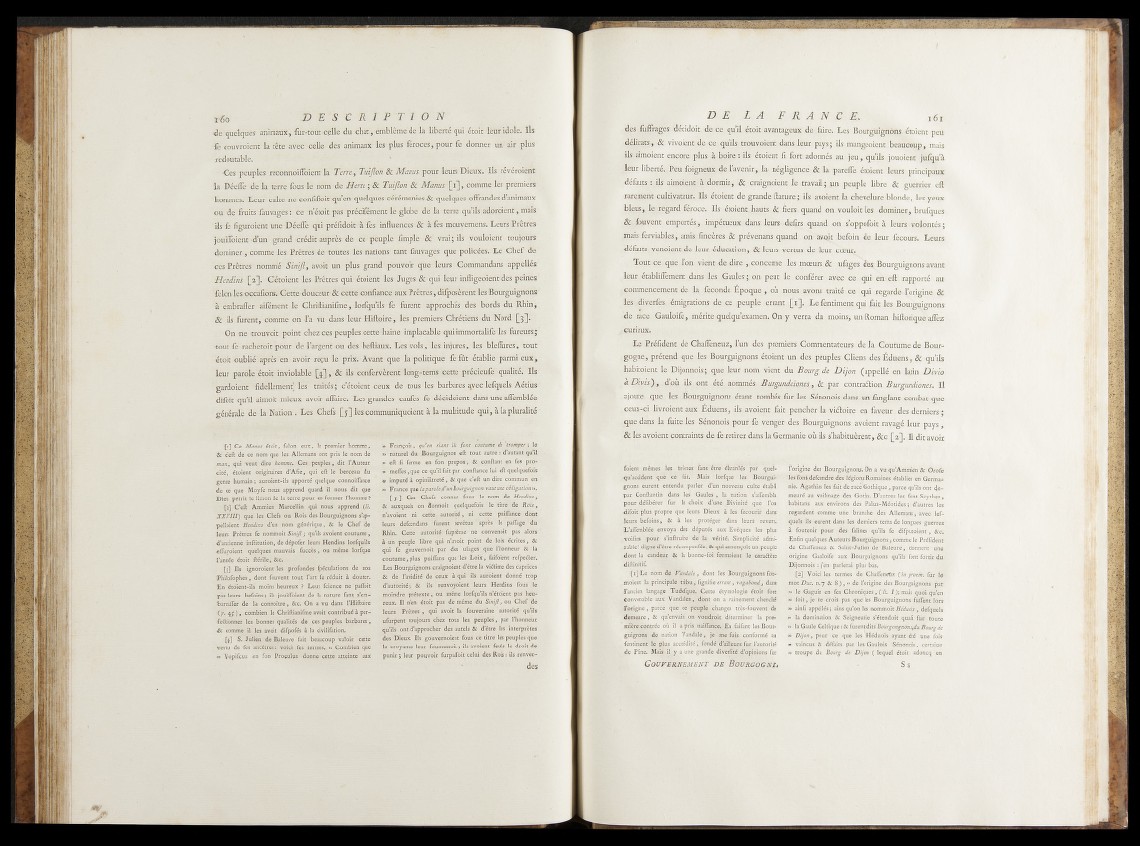
rSo D E S C R I P 'T Ipr-.N-'
■ de quelques animaux, fur-tout celle du chat , emblème de la liberté qui .était leur idole. Ils
:fc coiiv-roient la celle dés animaux- les p k s féroces, poiif fè donner dis' air' plus
Véçor.taiiHe,
■ Ces peu} les .reeôriraoMFoient la Terre, Fidji on & Manvs pour leurs Dieux. Us; reveroieiit
la Déeflê' de la terre Tous lé n o k de Stem ; & ■ & Manus: [ i ] , comme lés premiers'
hommes: J eur culte riëiâffièâôr&f® ®»' quelques cérémonies & quelques offrandes d’animaux
<3iï.":de' foies 1 mvâgés : ce n étoit pas précifément le globe de la terre'q i ils:âdor6iént, mais1
ils fe figu'roient.iiiie Déclic qui préfidok- à fes influences & 1,® ^ o^ '^ e q s i^ L e “ -Prêtres
nd rrodi? icpiils dé^cejpfTi'ple fimple* &^rvTai ; ils ^ouloiieric , toujoufï
domineri^of^oe les Erêéres de^toufesrles''dations tant- faîSfàges qu’e poliçées.'Le'" (Shef de’
'ces Prùros' nojrrfcs Sï/&/ , i.drtlun p b gnn’d^po’ufoir que fleurs »GSïrfn onclans upp elles’
Hendins [2] C ’étoient les Prêtres qui-étoient les Juges &-:qni leur inJhgeojentldts-jûn’es '
SU ô n L sq c ca® ï^ < ir?^ 0 ()UC^3r*& c-iH&bhiiuiçe aüx'T’m iv.s,dilj?rs(AJit l‘^'BSuigüi^îônif!
a embralïer- ailemenc le- CKriftiàiiime, lorsqu’ils le furent approchés- des bords du jRhin ,
& ils lurent} cotnme on la vu dans leur Hiftoire, les premiers Chrétiens du Nord [3 ].
On -rie. t-ri uyôit point chez 1 1 me implacable qui immortable les fureurs';
■ tout fe-rachetoit pour de largent ou des‘b'éiliaux. 1 les vo ls , les injures,. les 'blcffiirbs, ’tout
ïét&it ^ u b^ u jpw ^ fifa îm jr reçu -le prix. At ant'^e^laj^û lqû e* . fo'fùteé mblie parmi eu x,
leu r -p a rw e^ é toit^m vio la b le tl^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lfe^ ^ e^ p^ ^ ^ # ^ ^ ^ « . ràjSÿ.ufë’ -qûaht'éi Ils
diliut qu’il iiftîoit mieux noir’ ifïurc. 1 l grindc ~c^l^f lh^ e c ilË ^ iO d^^iinaal^fflPlëS
’à 'ila 'l^ lt i^ & '^ f fià jla ^p'iufahté '
;[i] Gë Manus étoit, félon eux., le premier homme,!
& c eft de .Ge;h|êpfp!e les Allemâns* '©rit pris le nom de
man, qui 'veut dire homme. Ces peuples , dit l’Auteur
cité, étoient- originaires: ;d’A fîe,.qüi eft le bëreeâui- du
"genre- ||m|^i|ÿ®Qiénl#lS ■ apporté
de ce que Moyfe nous-^apprend duand^feMus>,tdit 'qu'c
Dieu pétrit le limon de la terre pour èn'former l’homme ?
if 2] C ’eft Ammien Marcellin qùi nous apprend ( U.
XXVIII) que les Chefs ou Rois des Bourguignons sap-
jpèlibient ‘Hendins’ d5u i^ ^m | |g | f| |^ i;3 & le Chef dé
vîèürs Prêtres fe .nommoitSinijI; ^^IStævStoS^rautuîr®*^
: d’ancienne ^{titiitt^.,-de d t^^^lèur^Hendins' lonqu’jls
-elïuyoient quelques mauvais fuccès, ou finêine.- lorfque ’
l ’anibéè étôit ftérile, ’&ç.’’' ' •,
, mg Ils ignoroient l’es profondes' fpéculations de nos
Philofophes ,,‘ doht, f o i^ ^ ^ ^ ^ p ’art fe rédluit à douter.
Eq^fôîeht^il? ‘moins'bburéiüT? Leur fcience ne paffoït
pas leurs ’ befoins ; ifs jbuilToient de l^ nature fans^ëm»;
'-bârra3Ter de la connoître, &e.r’Ôn-a vu dans l’Hlftofré
•</. «jy )', combien, le Chriftîanifine a!\(ôi£uép^trit?ué à per-'
feftionner les-»bonnes qualités de, ces peuples barbares',
£ç comme il les avoit : ^ïplpfe^^>;la%- civilifationl1 ;• ■....
ij^jr]- S. Julien de Baleufe fait beaucoup valoir,. cette
vertu dé -fes ancêtres’: vpicL.fes termes,, « Combien que
■ m Yôpifcus M fon*’proçùlùs • donne*‘ cette atteinte aux
» François, quen riakt ils font -qôÈtumc de [tromper ; le
natùÉe'r-du- xB’^urgmgnpnmeft^ tp u t,autre :: d-àutànt^^Uî
5» eft fi ferme en fon propos, &, gonflant en fes pi’ô*
» 'melTesl,ique ce qjiïlfait py/côi^^^ '^pat'quelquefois
impute à opiniâtieté. & que c’elt un dire fiomniun *én
33 "France que lapamïe/’unBoutguignon vaut une y
:[ ] Ces Chefe connus fous le nom de ,
& auxquels bh â'o'nnoit quelquefois le titré^.Me 'Hoir,
navoiènt ni cette.-.aut'qjiité, ni cette 'puilTaflce'^â'^ht
leurs ^dfÉëiïi^ris durent revêtus ' après ’ le^pâlTage s du
Rhin. Cette autbï-ifé,v .fuprême n i convenoit pas alors
à un peuple libre qui n avoit point de loix écrites, &s
qui fe gouvernoit par '*des ufages .que Hionnèuri & la.
coutume j plus puiffans que'les L o ix , * faifoient rèfpeétér.
Les Bourguignpns^craigrioiénrd’êtté la viâime des caprices
’de* ^ei^;-â}^[iu'''il$'. auroient donné trop
d’autorité ;'|^;5flils • renvoyoient leurs Hendins fous l e .
.■iùpindiré;- prétexté y 'ou', même, lorfqû’ils n?étoiënt pas hëü-
'reux. É n’en étoit pas de même du Sm/?, ou''Chef ‘âe
leurs Prêtres , qui Woït la foûveraine ‘autorité’' qu’ils
Lümkpént^t^ot^bHeg' tous- les^ peuples, pàr /l;nônnêUr
autels & d’être les ^.înïerpre fes’
déW’Hiéux. Us gouyernoient fous <ce'ti^^^
la' ’croyance leur foumettoit ; ils avoleiff1 lèu'ls Te droit de
piimr • leur pouvoir furpalToit celui des Rois : ils 'Ténvér-i
. .â ësr
D E : L A F R A : N .Ç & w É I r 6 r
j^f§'raSes th:ciiJ6it..4^-.^qu.ll‘^ o £ ( ayantageux .dc.iSure. Les Boufgüîgnôtw ^toient peü
d^lieà® j & vivoient de oe qu’ils trouvoient dans leur pays; ils mangeoient .beaucoup, mÿs
Hp p p s ien c ei^^arpliisj^t^n.ice1':«1 a jdomij^jîi^m■ ƒ,tqil’d: jo u o ^ ^ ^ f e i l ’à
| p r hbeMé.: iP^m.&igneux de l’avenir,, la- négligence & la pareffe étoient leurs principaux
défauts : ils aimoient à dormk, & çraignoient le travail; un peuple libre & guerrier eft
rarement cultivateur Hs,.étoient de grande ftature; Ms avoient la chevelure blonde, les y eu ï
rt^ ®£UI ^ ctoiciwlj{UJ.Of)èa^er^'quâh,tflJon.^oûlo.t l f ■.‘domtiiy . brufque3,
. « v e n t eimpj^ïés^, uqp|lcuêgitÿ^^leurs-S(lg^g. quand on^ogpofoit. à tlfe^ s&l'ontés ;
^ p ^ e r a^ & ^ &m r g gG g^ p s aA ^ A ^Æ iM a ÿ d ^ p iÿ fà^ a it fe .le u r .fecourst Leurs
^défauts^nbimiclJdq'jlcLi r ,éducation})^®leùrs vertus de(*leut ccêar.
. ’BU wfu .q tu A i d » “ f jp a o tts ,* m « l â ^ K | S | i | | t a p e
..lfu t^® liM ^ n t ildaqs^k‘' Jjii luki ^ ^ m ^ ^ i^ i ' i f e r e i . aybb’me'Vqùit àïMii®gportéi(au
d>^y^g.ondi.{j£Æ au^Aoujhqfcnisaa^ ons t ra ité^ ’ ’ qui jr^gardbÆjrigin« &
les diverfes émigrations de ce peuple errant [ 1 ]. Le fentiment qui fait les Bourguignons
.Jde-- n u .
curieux. ^
Le Préfidene. de Chaffeneuz, l’un des prèmiets Commentateurs de fe Counune de-Bour-"
gôgnq, prétend» 4ttet%^6grgjugn<^sl élote^ti.'^1;^ ^ | ü p l e ^ | j^ « d e s Édnçns, & qu’ils
j^bicoiyiL. le^Diioiinoi : .que. hjjJffiMjh,ÿ'ii.ni dm,{}oàg/,l Dijon (^npcUei^ifedmiBîi&i
raéligtiJ& ^ j 7-!?» 8 9 II
?a] ffiôürgRtg'Ions étitnt tombés,fur^p|^ngn6is|danM^ili^l|nt.&àlBh^qp!
[ccux^k S ivro iim tîsù x lH R is , tds}>\oieht 1 9 p.éur^êi hi^tlâoVci-enK^eLiiVdbs:derniers'}
que dans la lùite le , Sénonoi : pour fe venger des Biîurguignons ivoient ravagé, leur pays
'Sc J e sh v^ ^ ^ ^ ti^m ^ ^Æ Æ e tie r d#Lfj4 ^erittams ^yÆ^abéHiètent
foient mêmes ies trônes fans être ébranlés par quel-
> Mais lôiâfqüe les Bourgui-1
gdons': eurent ; entendu ^paflef vr d’un' nouveau culte établi
par Conftantin dans les . Gaules , la nation, s’aflembl'a
pour délibérer fur lé choix-^ime‘ ^©iyinitp' qjie l’on
difoit plus propie'jque leurs Dieux a les fec'ourir dans
■ leurs befôins., &: à les protéger dans leurs' revers.
F:âfÉïeinbl^Oenypya -des députés âux-' Evêques^ lés ,vplus
„voiGns -■ po.uÊ' s>inftruite’;^dé91^ ^ r i t é i -‘‘SinibliGitéi aHmî-
iable ! digne d’être récompenfée, & qui annonçoit un peuple
dont la cahàëur & la bon'né^^^ fqrmdiënt le ^radère
diftinftif.
Lé 'iÎ0&me;.’^ndf£r/e, âont: les
iùioient la principail'é *tn'ou‘,s£griifiê e^rn/zr, vagabond* dans
ffancien langage Tudefquè. Cette étymologie étoit foie
^p’nyenable^i^Vandcüéÿ,4^rit on a vainément^Glîëîi^lië;
l’pngine, paice que ce peuplé »changea tics-fouvent de
demeure, & quenvaiii on voudroi^ déterminer la prer-•
mièr.e,;c.én,trée où il à pris riamaoeKe&Eri,>faifant les Bourguignons
de nation Vandale, jé'me>£uis confoimé au 1
fentiment le plus accréait^ fondé d’aill.eurs
Me Pline. Mais il y a une'glande diverCté d’opinions fur
| G qüfemnëmextt DE SèéMM§rME»
l’bri|m'ê dès a ,vu qu’^inmién & "Ôrofe
!-'lèsïdnfedefcepdfé'd^le^bin^R6màinès’ «âbliês'-’èn Germai* '
nie: Agâthias les fait de race Gothique , parce qu’ils ont demeuré
au voifînage des G'oi^s.hD’autre^
vhabltà^uj'âti^^ des Palbs-Méotides.;?^
regardent comme une branche des Allemâns 3 4véd ief-
qüelsi'iUs'ieûreiit dans' les derniers tëihs de longues guerres
a foû^riiir^p^/i^e^aliriéS •.qiulls. fe- difputoferit, Stdè
Enfin quelques Auteurs Bourguignons $ comme-le Prefidënt
•dé GhafTeneuz & Samt-Juliéh, de Baleufe, ‘donnent une
^origine - Gaüloife a u £ g ^ ^ o ^ ^ p ’ilx'forit’fdttirÆwï
i©ijp,rlnois : j’eri parlétai ‘plus^bas.- 1
’ ' |I§] termes dé :'CHàfleiléQè (‘in proeM: ftir lé
mot Dac. n. 7 & 8 ) , « de l'qiigine des Bourguignons paf
a» lé Gagiiiri en ‘fes(- Chroniques, ( /i: J ); mais qü'^r -qu’en
qjié les Bpüîgüi^n'p’filj fdlféhKlo’fs
33 ainfî ap'p#féS ; ‘a'in#qu’on les nommoit Jïc^«o|î?;,%hïtulls
domination '& Seigneurie s’étendoit quafi foute
33 la Gaiile Celtique : & furent dits Bourgongnons,du Bourg de
» Dijon, pour ce que les Héduois ayant été une fois
»»■ •vaincus Sé défaits par lesMÎfauilbis./SénPnoxs,- certaine
» trd4pe\du' Edurg Difîn ( lequel éto'it' adon'cq en
v-" -IS«-.