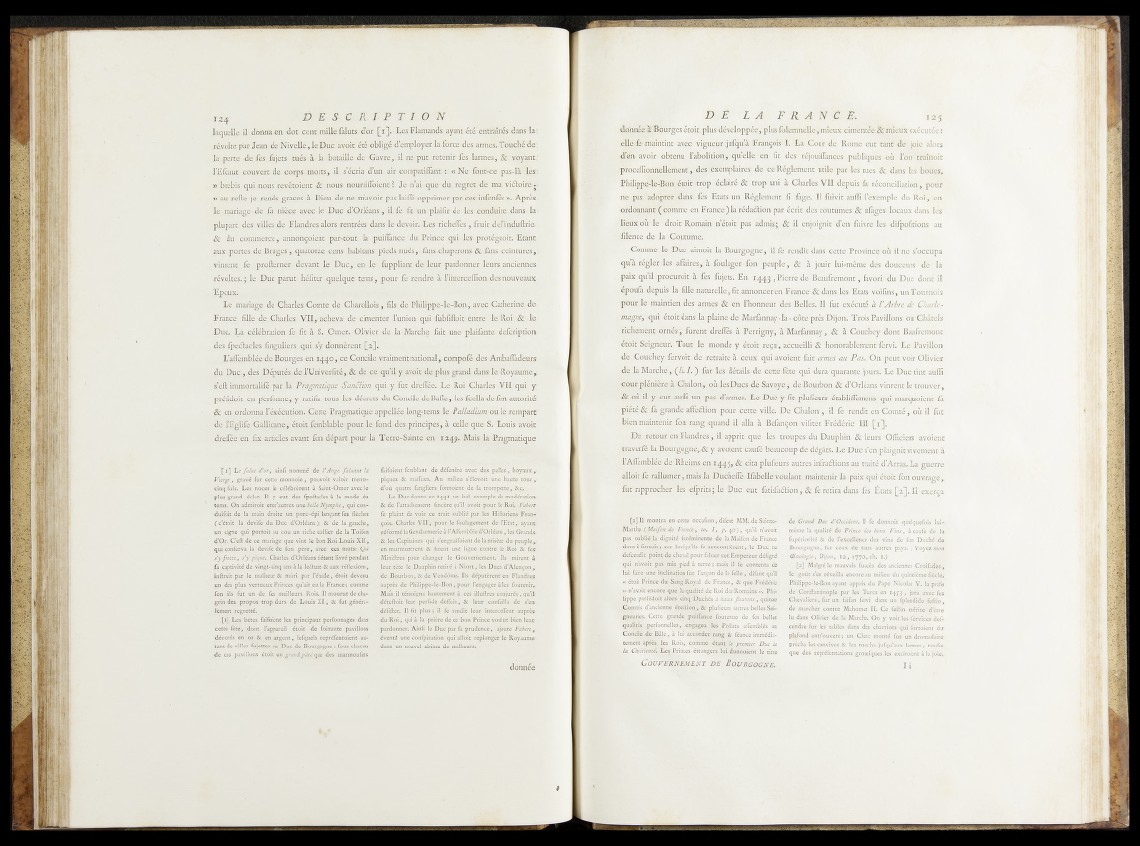
I 24 . . D Ê & C Æ I P T I O N
laquelle il donna i t t dot cent'mille faluts clWmJjw ent®nés>dansflaj
iévolte-.par Jean deNR elle, le D uc avok été-obligé d'employer la foreer d s , s.-T'ouehéid«
la)-,perce de fés 'jfujets taés- à-la- bataille de- G avre,.il ne-put retenir. lès larmes.,-& voyant-
l’Efcaut couvert de corps morte,;-il- s écria" d’un air compatiflànt- :: « Ne font-ce j is là les
»■ brebis qui nous' rèvêtoient .& nous- nourriilbient ? Je n’ai que du: regret de ma. viétoire
» au refile je rends; grâces à Dieu de ne m’avoir pas laifle opprimer par ces infenfés »..Aprèsi
-le mariage-.de là nièct vec li Duc d’Orléans , il fe fk-tui pl ifir d ■ les conduire dans. la.
plupart. des-villes de -Flandres alors rentrées dans-le dev )ir.-.Ees ricbefles ,.fruir deTinduflrrie
& du- commerce,- annonçoient- par-tout la1 pteTimc::. du Prince, qui les'.protégeait. Etant.
aux portes de Bruges, quatorze -cens b ib tans1 j eds nuds, 1 ms chaperons.8c ràns, ceintures.,,
vinrent lé prollerner devant lè D uc , en le fuppliant de leu-r pardonner, leurs, anciennes,
révoltes'. ; le Duc parut- héfiter quelque tems, pour lé rendre à l’intercelEon. des nouve ux
Epo.ux..,
L e mariagp de Charles Comte de Charoilois , fils de Philippe-de-Bon,, avec. Cadre rine de
France fille de Cbarl s * \ ai.1.! iim ; ..jà-J UT. tq^i'qialîlul c*jl pli
Duc t T à célébration fe lit à S. Omei Oiiyier.de 1 M cl e fa une pl dm : -defcrij tipâ-
des fpt étacles linguliers qui s’y donnèrent
L^iiiombléi^di Bonri-e.s t.n t/| it..icd|&Mm l t |iîr^m n'ri>t.|imâluri]h'ipb(tjd . s| A.i 1 .iFidjji s
du Dui..jdcsJ»)cpirc.sidc 1 fîird‘Æn«l. K d 'u i l'.j
s’eft immortalile par la Pragmatique San Hion qui y fut dreflc . Le Roi Charles VII qui y
préCdoit èn-ggrl dite, y tarif . tous 1 s décrets du ( ont île de!Bafle^ les fcc II i de i ' atorité
& en. ordonna l’exécution Cette Pragmatique appelléc-long-tc ns-1e R daim ou le i mpa-rc
de l’Eglife Gallicane.., étoit femblabk
Kucilcd ça lip a y^ lÿ s !d \^ n iiWdtp-'itpoSEl1**Tcrrc b Mji.M.tjriim'duj fume
r[ i j Le faliut d'or, ainfi nommé de VAnge faluànt l'tA
Vierge , gravé fur*.cette, monnoie ,• pouvoit valoir trente-
ffgglpfols. Les noces fe’.célébrèrent à Saint-Omer avec ie-
pîdsr grand éclat; I l y eut des fpedacles à la mode du
tems. On admiroit entr’autres une Belle Nymphe, qui con-
duifoit de la main droite un, porc-épi lançant fes flèches
( c’étoit la- d évi te du Duc d’Orléans); &^de la gauche ,
un cigne qui portoit au^toubui^riclie collier .de la T|©ïfbm
d’Or. C’eft de ce mariage que vint le bon,RoI Louis X I I ,
ipiiconferya la devife de1 fon .père, avec ces mots: Qui*
ày frotte, s y pique. Charles d’Orléans s'étant livré pendant
fa captivité dè vingt-cinq ans à la leâure &aux réflexions ,
înftruit par le malheur & mûri par l’étude, etoft devenu
un des plus vertueux Princes qu’ait eu la France; comme
fpn -fils fut un. de fes meilleurs Rois. Il mourût -de chagrin
des ,pro,pos trop durs de Louis X I , & fut généralement
regretté;. | ^
, [i] Les bêtes, fàifoient les principaux perfonnages dans
.‘cette fête, dont l’appareil étoir -de foixante pavillons
’décorés pr: &: teii/argenf, lefquels repréfentoient au-
xant -dé yHlès fiiiettes ; âu^Mufc de Bourgogne : fqu|-;<^aê"iïnv
4e ces. pavillons- étoit xm.granàpâcé que des marmoufets
^ibfëWTem^ des- pellei, - Kp jrau'x.’^
piques & -.mfflrés~î»Ai^mi;li^Ss^ l ^ jîMutife»haute.^^^^
d’où, quatre'• fan .. -i - ■
Le Bue M|>'nna en 1441 un-bel ^emp^'dej modération
&, de l’attachemëiit fincère-q^i^'avoit pour le Roi. Faberc
fe plaint de/ von: ce tiait oufelaé^pai les Hiftoiiens Fr an-#
goisV'iÉ^m^^M^poùt-fle'.ifo'ùla'gemeht- de l’Etat, -ayantl
îéfoimé laGcndaimeue à l’Affemblce d Orléans, les Gnâncis*1
& les; Capitaines' qui s’engrâiffoient de la misère du peuple'^
en mnrmuièrent & firent une ligue contt ê le. Roi & fes
Minmtes,ipbmt changer le ‘ Gouvernement.v Us ' mirent à'
Hetà^têfe leîBauphin retiré à Niort^les Bu||||d’Alençon»«
de Bou rbon, & de Vendom e.. Ilisî dénutèrenrfeùl Flàndrés'
auprès <lé PhiiUppé4l'éiBdm$ l’engage.r a . ïes foitehity
Mais il ïémoigna, hautement à ces ililuflres conju•rés, qu’ij.-
déteftoi bilflllf perfide^deifei in•, & leur ^^m®llæ •'dë'::^ënt
défifter. ©•■ fit plus ; il fe nendit leur inteirèëiieliirauPrè.s
du Roi, -la-.prière de'c:e bon Prince voulut Mcn^lfeuc'
pardonn1er. AiÛÆ le Bue par: fa. prudence,. ajoute; f ’gÿerréventl'
une, confpM^b^ÉStalloit replongez le Royaun^1
d-ans -un nouvel .abîme de anal'heut-s,-
'donnée
D Ë L A P R A N £ Ë. 1 2 5
4n ta& $ |B o iirg eh ^t^ ^ | y ^ s ^ . y i i% i v P J y f 0jpinnëllê&mienx-,cimWï#éiStodeux exéentié f
elle fe -maintint La Cour de Rome eut tant de joie alors
..ol'te'ttjél Î1 jiu ^ ^ t c é ^ o ilw i^ i loî^feidtloic
E o c e fTij^ s l^m &na l^^^^Mân e^da^^R'sgl'amisiit J-ÿale< |&jrlss»KtUi8s % ^ fflsM "b o d ç s .
l ’ i’il i ^ c V v r u .p M ^ 1 jL i \ H dej i s i t r », liauSfrjipt'r^
ne pi ^ idopter dans fes E ats un Réglen :nt fî fàt e. Il fui i
.i i|î ài.i^^tjftgSsflocayx daicS'lèâ
lieux o r tie droit Romain n étoit pas admis; & il enjoignit'1 d’en fuivre les difpo/itions to,-
filence de la Coutume.
Comme-le Duc 11moit la Bourgogne, 11 £é rendit dans Ce ttè Pi ovînee où il ne ^ojèttpà
1 ^ C cfe‘ là
‘ 1 ' ! $ ’; ( kU °U i j p . * n i , >4J Ji / I ( >î ^Æl d ' i¥mÏ
Jes Ies. lit - f t i WmÉpr
re, 'qui étoit dans 1n plaine de Ma:rfànnay -la - d'Géè-igfès Dijon. 1 rois Pavillons ou C hàtels
Bauffei^îtiK,
^wfmU|t i L e ‘ ',P d v î llo n
dé Coucltey fervo. y. de re trai i e à ceux qui avoient Élit arm’jr aa -Par. On peut voir Ob\ er
Duo ïtnt â®lfi
cour piénif te-à Ch :lon> oi i lf s Ducs de Sàvoye , de Bou: bon & d’Orléans V111 e> i
& où il y eut aulîi un pas d’armes. Le Duc y fit plufieurs établiflèmens qui marquoient fà
s fcu jnj.iiii^ rufak^gji
d 'i f ÿ -^iViibt+jÿÆSŸA' t-U'déiit
1’Aflêmblée de Rb-ei-tns en 14^ 5, & cita plufieurs au ares in&aétions au traité d’Arras. La ina®ye
alloit fe rallumer, mais la Düchellè Ifabeile voulant maintenir la paix qui étoit fon ouvrage,
fut rapprocher les efprits; le Duc' eut fatisfeéHon, & fe retira d ms fes États [n]. Il exerça
dirent MM. deîsamfl^
^‘M à r tok (
pas oublié la dignité faféfnihientecfde^laiMaifon de France
.dontilat^MÊi^ç^lQrfq^ds' fe rencontrèrent,4He iDu^n«
^ p |^ d I ^ ^ M l^.dKeval pour,Q^^^^Empe^tirJ(^ ^ ^ '
qui n’avoit pas mis pied à terre ; mais il fe contenta de
.ld^faire^une i^di^atioI|fîir, felle
S ç^o it 'Prince auvSan ^ Poval&.'de'r:Franee iki
Roi des Romains
îüppe-- p~èff0^ ^ or ^m a ^ n c h é s à hauts fieuro^^^ ^ m
^femtés d’ancienne'lérè^loj^^felu'geurs au^es b e l\e s ^ ^
i^W^Éés. Cette grandeCpuiflaace-^iitenue 'd e ,f ê^ B s^ S
’ q^ B i l p# ? pn^ ^ l engagea l^ fe r^ tat.c •
"^ féahrp:.î^#édig^
tement après les^Rois, comme .ctan't le premier Ëmkde
la C4réric/iV^Lw.>Princ,es etrari^^^^dqimpiént leititre
G o u v e r n em e n t d e B ou rg o gne.
Éb^fufiks^z. càùfd ’d ^ ï^
C,OEnologie ', 'i;ÿ j
[2] Malgré le mauvais fuccès des anciennes Croifadés *
duaquin^ën^fièclej’.
Philippe-Ie-Bon ayant appris du Pape Nicolas V. la prife
de Gonftantinople par les Turcs “en
fèrVi 'daps?Æiin Tpl^^^^Meftin ,
de marcher contre Mahomet II. Ce feftin mérite detre
lu dans Olivier de la Marche. On y voit les fervices def*
i d ii.
ifcIuèha^f^^tW
^^^des rëprefeh^Übns^grptefqu^ jW èxcitoient à la jôle*