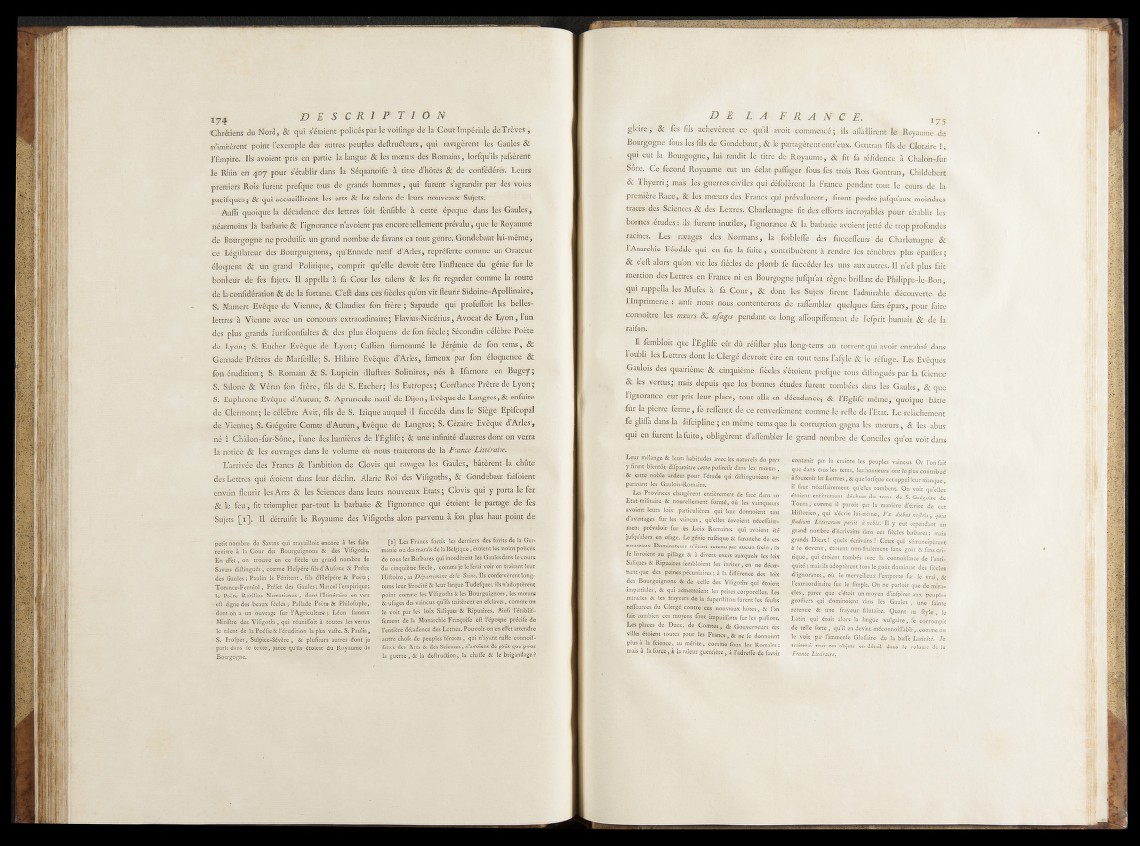
I 7 4 T) Ë 1 S C R I P T I O ;
«nkr&jfoiwi àtt N ord, St ’Gjwi s-étoien« policés ;pàrl!ê wbifi%e d'è' la Cour Impériale de Trêves ■ )
aMeèrêriï point Fêxemplë dès1 autres peuples: deliuaeUrsy.quh Gaules
1 Empire Ils àvoiënt pris efi'p'aif&ë: la langue & les'feOMBy4 ës'i,K0ffiafiS^i'Jb t^ ü ?ils pafierënt
Je- Rhin en' 407 pour' »établir dans la Séquàhoife1 à-titré d’Iiôtes & dé1 confédérés.' Leü» .'
£fg$igR K » - f u f g f f ip f t f f^ t^ ^ â è ïg r ^ < l 3cfflïrnes-, qui ferêrft VagàdaiF'par dësfvoiés'-
p-aËifilaës j & les talens dfedW&'îtfâiiyëa^OTjefe5
i -fevdéeadehGë-cfes & à t3r foit fenfible ¥ 1%di^ '|||^Ét^É É8i^IÈ«lfeàrJ
' îféattfso'iBS' ’là :Kgho-j^fcë 'tfa^îÉ te 'f^ertewÈtèUkiSle^fr^âttÿ^i»:te Reyaümé
fce ^!Ë^giflat'feüx■^,d'à, Bourguignons, “qü’EnftodÊ^hiRifi d’Arles jrrèjSrêfeAte eëmmé’ urt’OfttëUi
éfôqtfést" in- génie fur -le
bonheur de fes fejetsi II appelte àÊ -G o ü r 'lë s talens & ' lès fit regarder comme la'rbutè
^&la efertfidétstios & de'la fëti®ne.'©’A Ains tSs fièëks'qü’tMŸÎt jfleufnl Kâpiîte-’iS'pèlihMi'éi
Sïàïrttfflièït' Bvêqne de-Vienney & ’<3lsadien &m ftèref f-tSftpaudè ^l-'prbFêffiiîiifl|l belles1’
ietetesvà 'Yiennei^è©>mn: c0fl'ét)urS'- extmordinai^'pEla^irfeïNiE'étius ; ÿAvoeat dé Lyon ÿtfiâV
de plu grand Jurifeonfeltes & de plus éloquens de i f e 'fiècle; Sécondim célèbre'l’octe
de -Lyon5 -S- Eueher 'Evêque de ©yan';-'1 ©affîéà 'ffirnommé-.lë Jérémie- <fe>'3®n^{ëms-, &
C'ënfiadë' 'Pfêtî'eS de Mârfelllêp%î^Hilairg' ËvêcJSê ’di3Mès’, iÊMléü& par fdU''sèlb£jüeficé’ ‘&L
:fen érudition ; S. Romain &*¥®EqJ>fcinHiliufferAs41Solit-aiîe6’,^H'és 1 - BfarffefeTên 'Bugeÿ';
^ re; rîîl?ïîfë at>^m6hcrï1”I^'ît rinïPrLtre dS E^fflr;
S. Euphrone Evêque diAuturi; S-. Aprifilcrde' natif de Dijon, Evêqfede Làngres, •& epfiutè
de. MMfMone; 'lefÆiMébfe Avit^'fâs'ïàe S. fêique‘atfqué'lMd“^fuiS^Sà5^ 1iris lerSi'èÿë^BpifcopS
de Yienh&j^&afilégoile Comte’ d’Autün, Evêquejde Làngres; S. G£zaire|||||qfie d Arles?,
né -a'^^Ibm^^êçtaes!il'u£A^^^^^^ae^i^^lM^^^^m'ffMé^J}^è^d ont„Oiv Verra
la noti'eé & les Ouvrages dans le VSlüt&e 'ou nous traiterons de la France Litier,«ralimï
E’arrm;^ tics ’jîïaïSM ‘ Pambition de jC^qyjs » qui^ravaggfî^ps"^Hfles'mftèreïft-Ja chfite
des Lettres qui étbfent dans leur- déélin-. ' AÏaric Roi dès Yifîgothsj & Êoridebant laifoient
&..le feü; fit tostapber-par-t&ut 'lâbaibàrie & ttgnôfahçë -qui étaient le partage de fes
II dé@mût"mR^aume ïe s ^i%oàs^^rs_paryepuJ,a,fcq,p|us haut,pQiqt.de
petit ;n^:ml5ré fte* Savans qüi tr^allôït^en^^e 'â ’uss faire
*evmfevà la Cour des • Bourguignons & àes'VifîgotEs.
En êffét, on trouve ièÊxicej fî'éËfcPiin‘ grSnd nombre de
Savans^diftingues^ comme Hefpérejliïs ‘d’Mfdne' '& "Piréfet
l'des Gaules ; Paulin- ïe Penïtent, ïïls d’ïîefpére & Poëte j
T ’onance-Ferrê'ol, Préfet des ‘Gâufës; Marcel L’empirique';
le !Pdèt'e Rfftiiilis N^ , dont l’Itinéraire en vers
^ëft-’yâigrfe des 'b e a t à lS ^ i^ PaÛàHé Poëte & Phi'lôfôphe,,
dont^îi a un ouvrage ftir ÏÀgrifcultüre ; Léon fameux
Miniftre des Vifigoths, qui réunilToit à : toutes les vertus
'le' ’fel^^Syqa^oéfiè à 'l’éruditiori^la|p»lus<Yafte. S. Paulih ,
S. Prolpet ,;:oûî|iieeiSévère , & pluuëUri-autres dont je
- parle dans le textes pârcfe» quHls étoient du Koyaunfe de
•Bourgogne.
' [2]! Les Francs fortis lés â to e i's des "forêts de la G'ër-
manie 'ou dès marais de la’Belgique ,‘é'M^frtîes moins polit'és
3e tôu’sTles5’Barbares qui inofi'd'ereitf’ïè's "Gard'es dâUs'lefço’urà
f^ù cinquième 'fîècle, comme jte” l^fel ^ voir traitant Ifeur
Mftoire/au IPé^afre/nenf Ûçlà' üîirtciWtfottfé^èÿèlftjOTg-
;:tëms ïêür îêrociïè « l ê® ^ t î | ù è ^ oe f^ iÇ ^ ’â âo^èî^t
-point -comme ^'s Ëô'ùrg'ulgi'ïôfts, lés
&ufages des vaincus'^i’ifs tîaifèréfîf 'ëft'efdâvës ,'fcomMe.^i
’'le voit, par f e loix !Sâïï‘qu'es-& R-iptiàiies. ASrifi L’éïabli’f-
ïêment Moïlarouè Ê r^ ô îfë 'éfl; l’éjiô’quë iprêcife<,de
l’entière clécadènce d'éâ'ïj’éffrès.'P&û-rouïoh'en effet atfehdxe
'autre cliofe <fe peûplê^téfocës^-quL ffayaSt nûfté coMcm-
‘ïancë 'des Arts 8c 'â,ës;Sbiëncés, n’a^oxentmgPiïfâfté poiir
la guerre;; & la lde'ftruéfcion, la chafle & lé b'rigandage ?
D £ L A S ( R A N ' C Ë , ,
glfylM & Êls, uchf^îentvsce-, cpwl -avom.*- commé&cé ; ils aflâilhmp3%goyaume de
Bourgogne feus les. fife de Gond'ëbautô & le partagèrent entr eux.. .Gontran. fils de; @lpiaire I
qu* eut la B ^ q ^ j ^ i ^ r # d i # l i d t r e d e ^ ^ âume, &efit & réfideflee à C h 3 W ù r .
p ô n e . Ce fécond Royapnq-ieut un éclat pa iager fous -fes troE Rois Gontran, Childebert
^ ^ y , e ï n ; mj»§4esyguVrfi«!emdes_ quRdéfplêfent. k-jErûppeiEëndànt tout le .cours de la
F iî® p ïe Race^ifc les moeurs des^rancs^qliîi pfévalür.ent Jadîrent perdre jufquaux moindres
t’Wë5--!i^|iSeî?pce3-&1 des Lettres. Charlemagne fit des efforts-incroyables pour -rétablir, les
bodies 0tudês,:, ik ,.&retitqintitÿâs, -l’ignorance & la barbare avoiènt.jetté’de trop.-ptofendes
k , ^ | ^ T e t 4 4 '^ I ^ T e i a ï i s t s <fe C h r r l a m ^ h &
i’^oar^ue Eéodple qui eq ’iutfj(te,fuife ',ppohmbuèrent à rendre Ids ténèbrès plus épgdfes;
^ ^ e % ‘alpi?(Jq»gn^yij,iles!fièoles, deiplijml^jÇè ft.ccédej lagfaUs.raU^aiitrés. U'iÿeft plus-fait
Pl^qpqç <lesJtepré%sniEran£e^m»g^JuVgogri4V f q ^ 4 '^ ^ J i'fciHânt'dSÎ-Ëhîlippeyle-Bon,
^ .& à dont,,l^s.§k;efe ^frept- jiïqdùjàhieMççflm^réei dp
lïap r im e r ie g j^ if i .nous nous .contenterons ;de raffembler quelques faits,épars, pour fakê
^ ce«s^ i « f e 4 pe^aptrOQ4o n g ia % p p # j^ ^ h h m * )& de-la
•jaifon. .„-..j
•s 11 fembloit -^ue ^ S 1# §ùt dû réfiifter plus, long-tems aii terrenïqùl^vdit iôitfaîné .dans
1 oubli les Lettres dont leiClergé deyroît être en ïopt ^ B ï | ï u g e . ' Les Evêques
Gaulois des quatrième & çmqnièmé fièeles. s’étoierit prefqne toils,diffiingués par la féiefiÈé
^ ^ - # . e^J^WS),dgpmsilq»e les bonnes -étud.qs fureatÆdmbée.î feksid'fe
l’ignoranc^ eut phis iêuir place,, tout alla .en decadence, & l-Eglife lÆg'fJqnoiquÉwbtafe
^ r ^ a j^ g t r e i ^ ^ ^ i ^ f a i a t d® ëà|Ç}ptfeirilht c o r i J W ÿ '^ e f t é l e l^ ^ l^ ^ ^ S i é l i
,fe gliïffa dans la , difcipline.; en même terns qua là corruption gagna les moeurs, & ’lèsfabus
rqpij enifiqenvl,a-Imm,-isBligèrent faflhmblijr lë'g tih d qèmbrfe d^'gbdhpCqu.’i^à Wttlan s
Leur mélange & leurs babiaide s^v ec-lp^a terelt du pays
^ y f irm t 't ie n t ô h ^ les, moeurs,
& - ceue :noble. ardeue pour’ l’ctude .rjui diftiu^ôiênt^àu^
^Tji v’i Vt^lLS^Gali l \-Ku.V 1LH.J
liés Provinces cRàngèrçrit entièrement de fa;:!- .cm.s un
£tat: militaire & nouvellement, formé, S'il (le%V»ûtqëduis
a volent- leps, loix1, pârtiottliyeî IqSq^u): donnoient tant
d avantages - fur les vaincus, qu'elles Üevoient nécelfaire-
lient prévaloir fui lés Loix Romaines qui v irot-’P**
jufqu'alore en ufage. Le génie ruflique & farouche de ces
nouveaux .Bominateurs n'étant retenu par aucun frein, ils
i IÇ’.àp'Siènt1®-pillage & à divers excès auxquels les loix -
Saliques & Ripuaifes fembldient les. invirei-.y.'cn ne décer-
tiant que des peines .pécuniaires à la- différence dés loi.-è •
des Bourguignons •&:; de .celle des- Vifigoths-qm.cto.Knt-
^.VilP.’ift'RJrs- at.-qui admettoient les peines i:orpordlcs: Les
mirades & les frajrcursvde la fuperftition furent les feules
■ reflources du Clfergéncontre ces nouveaux hôtes, & l’on-
Xait; combien bes moyens (ont im.puiffants fur les paffiOns,'
Le Piaces. do B«“ , de Comtes,, de-.Gouverneurs des
villes étoiem toutes .pour les Francs, & ne fe doUno e^ï
^ p ld if^ ^ ^ e q ç e , au
‘ pais à la force, à la valeur guerrière, à-l'adrefl'e de favoir .
.contenir par la crainte, les -peuples' vaincus., .Or l'on fait ■
que dans tous les ‘terns, les honneurs ont le plus contribué
; à-loti tenir les Lettres, & qne'IqrfqUe'cétraji'piii leurmanque ,
■ il.&ut néccffairement quelles tombent. On voit quelles
étoient entièrement 'déchues du tems de & ëregoire de
Tours,'comme il -, paraît, par. la manière d’écrire de cet
. lliftorien,- qui s'écrie lui-même,’ Fie dielus nojlris, quia
jlu&him Llîr'eraruni ‘pêrlit ' a lïôlïïs. Il y eut cependant un '
grand nombre .dcciivàlns idans ces Cèdes barbai es : mais
grands Dieu^ffiTOSeciivàms ! ■: Ceux qui s’émancipèrent
à le devenir, étoient nôntfeuïément fans'goût Sc fans çri-
,fiq ■' etc av arm de I’anti^ .'
; .quite';, mais-ils adoptèrent fous le goût dominant des fièçiesi
- d'ignorance , où le merveilleux l’emporte fur le vrai 8c
; Icxtraordinaite ■ fur le lïmplc; On ne parloir eue de n-.ira-
'- iclcs^ parce que c’étoit un moyen d’infpirer aux peuples
: grofliers, qui domirioient dans les Gaules ,■■ une '• ’fàinte
retenue & une. . frayeur1 falutaire. Quant au- Ipy-le, le
Latin q“ dtçnt alors la langue vulgaire, fe cortompit
dê telle forte:,; qu'il en devint méconnoiffable, comme on
le voit par lrmmenfe Gl'oflàire de là baffe Latinité. Je
traiterai tons cK -robj;àï^ra détail dans" le volume de la '
France JLitcérairie* ' M,