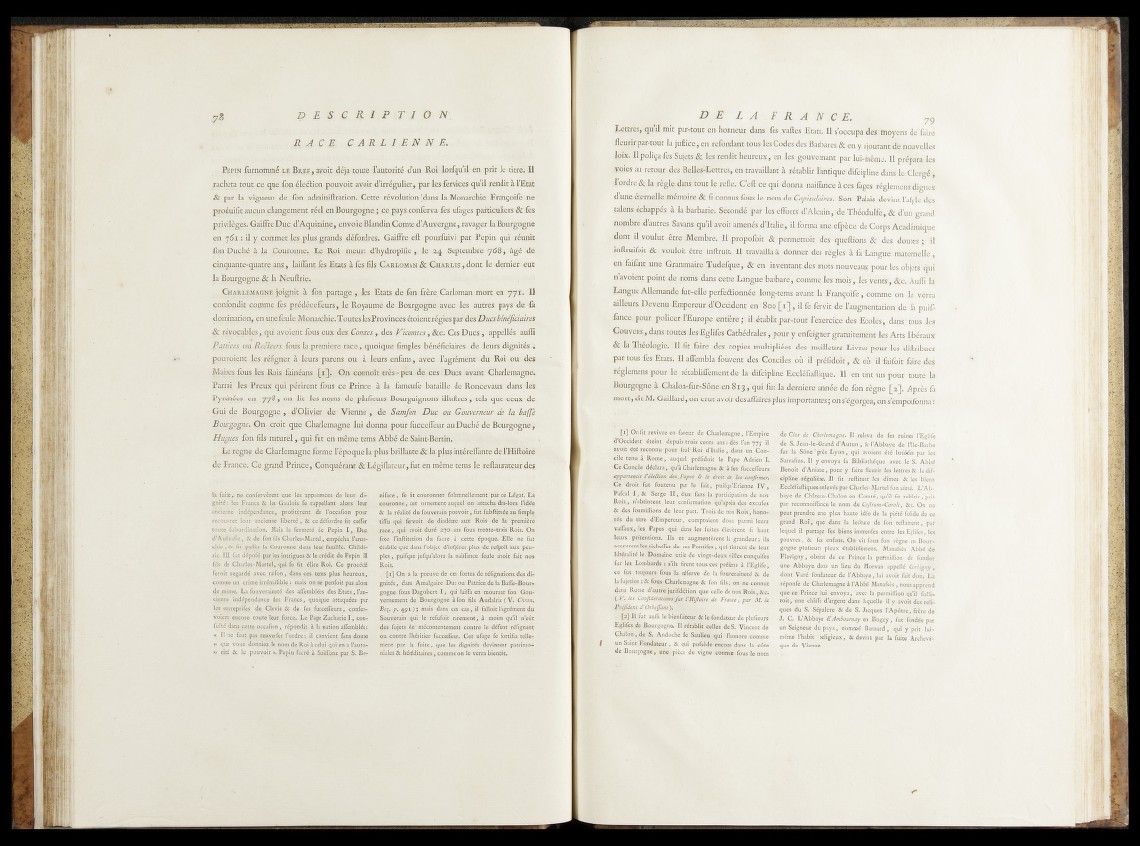
■7 s D E S C R I P > T J P NR
A Ç M.. Ç 4 R l ƒ - ,£ M W E . . :
.Pépin fomommé le Br..£f., aygk.ifeja. iCaute .i’ajÿ&tité $ua Rof tarifa il én prit {e titré.'Il
jjchejta .toutg^que .^a.Jigp^ââ^^ç.iCî^^îtrfàwégùUB^ par les fervices qu’il rendit à l’Etafc
& par la v{gûta, foi Ion, adipSaifiratiopi Cette lévolutijOn^dans ta.MonKÂej&É^Msïoé
prod^taup}uiiç%i^^®î.nt.r<58l^e.nBguj'g9gfie:; ,çe g9ys..confexva fes ufigesSRiîfeicaliers & fss
privilègejSvÇà^e'P^.d^qijijt^ej.enYoieBlandin.ÇQjB.tfcdiAuv.ergae,.ravager *la'Bburgogna
en 7.61.: il y çnJMet les plusi.jgrands défojdres. Qgjfte ,eft p.ourfoivi'.par Pépin qqï réunit
fon Duché à la Couronne. Le Roi meurt d’hydropifie , le 24 Septembre 7 6 8 , âgé de
à fes fils Carloman & Charles , dont le dernier eut
Jai^ ^ g g g g ,e^ ||: Npufojg,...
C| ^ j^ lkmagîje. joigût ;à fon sp%ïî?ge, les Etats de.fenfeèm-Carloman niait en -yyt. 11
confondit* çp^^.^çs^pjédgc^eiîeurj,4e Royaume de Boingogne-ayec les autres payS'sde fa
c(pJB}{Uj£ign? çn igjefeulg iyiona£cMe.T.onte$fesPro5rinces étoienrrégiespar des Bues bénéficiaires
g régpcabfes ,.qqi %vgi<îpt,làus.,ei^ 4§S fi0/Sfw, des Vicomtes, &ei Ces Buc$,. appellés auflî
Patrices ou Reç^eurs, fous là première raee«, quoique fîtnples bénéficiaires de leurs dignités ,
gquyoient JgSii^ßgner à leurs p^rçns. qu, à leurs enfans, avecj l’agrémtent du RoiSfeusdes
Maires fous les Rois fainéans [V]. On connoît très - peu de ces Ducs
Parmi les-Preux qui périrent j§3us'jce3Pxince à-la fameufe bjfeiRef’de. Ronèèvàux'.sdânS les
Pyrénées en 7 7 8 , on,Pt les noms degpjijfiêu^s^Bourguignons illufires, tels que deux!de
pu i dg Bourgogne, j^Æpijÿipr de Vienne , dh» Santfon Elue ou Gbwpnmun^de la bajji
RpWsëSëVéi ÔPaçfifPÎf- que fîbaflejnagne lui dunna poiy^lucccllcur au Duch. de Bourgogne,
“Htigutt fon fils napurel, qjji fut en même tems Abbé de SainoBertin.
^çggng, jde ^arlemagne forme ïépnque la phatbäUUdae |& latplu$! mtérëifëntb deTHîftoirè
de France. Ce grand Prince, Cdhquéranr& Sfiégifiateur., fût en même temS.le refiauratgur dej
k-^uite^ çe eonférvèr-ent que* 1&£ apparences. de leur. ,;dî>
gnité.riq^Frariçs & les paulois,le rappellànt alors leur
ancienne indépendance, profitèrent de l’occafion pour
recouvrer leur ancienne liberté , -& ce ^éfordre' fit cefler
toute fubordination-. Mais la fermeté , de .Pepin I , <v D pç :
dsAuftrafie, & de fon fils Gharles-tMartel,. empêcha l’anar-
c^ie , & fit pafTer k Couronne dans leur famille. Childé-
ric IH fut dépqfé par l’es intrigues & le crédit de P,epin H
§ k - de Charles-Mar te l, qui fe • fit élire Roi. ©e ;;pïç(cédë,'
ferpit regardé avec raifon, dans ces tems plus heureux,
,erime1®rgm^||è:::; mais: pn ng penfoi^t p^jalors.
de .même. La fouveraineté des âffemblé.es des Etats , l’ancienne
indép.endanc.e- des Francs, quoique. gtt&qu^çS' p.at
les entreprifes 4eC fpy £ v& de fes fuçceÏÏqurs,, cpnferr-
voient..eç.çorp: toute leur force.. Le Eape Z^chariel.., cojfe
m danftcçette occafion , répondit ià;îi; aatipn/alprQlÿlépi:
*. -® ne . frut'pas renveifer l’mârjgl; il cqn^ent fans doute
» que vous donniez,le nQm de Roi à celui qui en l’auto-
le pouvoir ».Hççin.façré. à,S.qiifçu§, par.S. Bor
niface1, fe fit couronner fôlemnellém'ent‘'pàt çè Légat. Eâ
couronne ÿ cet ornement auquqli pfl^tt^
& la réalité du£oûverMiivpbi^^^^u^ub'ft^ée au. fimple
tîffîi^qjui ;fèrvdi't: dé^dfad'ênï&vaitg’' Rois" dé là 'première
.race;, ..quû avoit duré- 270-ans fous trente-trois Rois.-, ;On
fixe l’infiitution du facre à cette époque. Elle ' ne fut
établie que dans l’objet d^nfpirer plus de refpeét aux peuples
j puifque jufqu’alors la naiiïance feule a voit fait nos-
^ois. ...
cesîfortes de‘réfignations des dignités,
dans Amalgaire Duc ou Patrice de la Baffe-Bour«
gogue.-fo^i§ Dagobert I , qui„IaiflTa en mourant fon Gou*
Yeruement, dq, Bourgogne- à fou Èls Audalric (!:¥. Chràra
Bc%. p h ^ i . y , mais dans çes-cks, il fàlloit fàgrément'diï
SoUYqraiA .*.^utwl^k||ifoit rarement, à moins qu’il' U’çût
^des<. fuj,ets de mécontentement contre le défunt réfignant
ou,(Contre -l’héritier fucceffeur. Gct ufage fe fortifia tellement
par la fuite, que les dignités devinrent patrimoniales
Sç héréditaires, comme on le verra bientÔt. ^ ' ' ; '
P £ L A F R A N C E . K
£f3tfres,'qil’il fuît par-tqjji fen honneur dans fes yaftes Etats. Il soccufà deî-1noyens da &iri
f l ^ o u t la luflléLlen refon9aM^tOT% M ) .o f#d es -BafoarKs & ®j y a]oütan6"de nouvelles
loix. I l poliça fes Sujets :& les rendit heureux, en les. gouvernant par lui-même. Il prépara les
fK°lesl au retour des BellesrEettres, en tr-avàilkit à rétablir l’antique difeipline dans le Clergér>
forére & fe ..règle dWis. tout le refte. C’efb ee qui donna, naiffance à ces fages réglemens % n e l
dimAjâgrnellsrffiémoite &.f( cqtmu^G^ 1er Mevmfïafylede*
talens échappés à fe barbarie. Secondé par les efforts d’Alcuin, de Théodulfe, & d’un gfafuT
.n^bte^aurrss,Sava|^^gi|ilfe^®fe)arBgn|^à|r^è^f^|^^i|taij^ef'^^fog. 'd^Cbï^iCëaW^iiquô
Jenf U,vo»%!, ât^JJIéabre, |l ^ ^ ^ « l^ s e ® n ë t t a i t de?'’fc|ûe^ipç%"&: des doutés'; il
Itrfowfofe h&js|fâlQai être ^ sH lg ié iw& Ltoéü'ê\ma£ei!tielle,
8ft.feiSws.iung GfàmmakoÆEù'dtfque,. & en mot^û^értJsçéuï'lW^'^fejjiî'
^Votent point demoifis dans oette-Langue barbate,■'-éplffie|t£‘'fflôislès vents, % .‘Au® f f
feàçgue Allemande fofrelle perfoétionnéajdon^tMns itent la Frafiioife^ fortune 'db .fié' Vêrra
silfeiurs. Devepu Emperem^dl'Qëpidéiic'.en'i^èâ'll^^iJ.ifesfsfVit'defi’aiigm'enteiùon de ïaéptiîfi
feacèupnûitfpolîcsi liEurope5pmbre;r41^taMi£-.pa^4eut l|xercioa'|ÿfE'èolës, dàtfe'lW le»
Couvens, dans tantes {es EglifesrCfediédraldS ^lûï^é^eilrfejÿ^latîïitèMnt-des-Ats libéàtÉ
& fe Théologie. U'îfit'faife depfoptes,mi}lïipljé|$%es kteinçûr^E)^fo^pffrlels idffirib'ïieï
'Pàtioust'fe&i^çafs'S -Uj-afiemblaif^tvenfi dcS GomilS-oii^l p'ÈÊÊloÈ^Si 'si'^ilSfeifoit’feffe deS
^^^lensipdunsl^tt^îèMêment’d â i l k ^ ^ p S ^ l& i^ ^ ^ ÿ l . ' t l l l^ ^ ^ b jd i ÿ e u i ^Ô%té fe
'■^ürgogne.à.sÇhalbnÿfoit.Sâile pft}8 J3, quù-fe^feid^niero annéede fon^ègne falv^Aprês fe
W ° # 3 l w t ^ | l a ^ :HSHtfavoirri&afiâSppiïs®^bMhiâVohs%'c)£fêï|i®V@Apoiforipa'(
revivl’e en faveur de Charlemagne, l’Empire
d’Occident éteint, depuis trois- cents ans : ' dès fan
« 1 été reçpnnù'pour feul Roi d’Italie , dans un ?p||M
e% tenu à R o p e ,,. a u p e f pritdoiit le Pape 4Adrien L
• , \#é'C:onéfe; dé-elàra, quà' Charlemagne & à fesMoeèffêUiss
appartenait l’élection desJPapes & le iroit de les confirmer»
V> ,Ce ( droit ‘fut foutenu par le fait, puifqù’Etienne IV 3
.. ^Pafcal I • ’ & $er-gè lÈ , nos
R o is, nobtinrent leur confirmation■ quaprès des, exeufes
§ç de sm ^fffip^:>4 e 'tlèpr.parti'rfcrois de nos Rois, hono-
| ié s dons, f leürâ1.
yaffauix,. les, .Papes qui dans les fuites - élevèrent fi haut
. ■ . 'fefe'ES: prétentions. Ils. en- augmentèrent la- graiadèûr;^ils
accrurent les richelTes de ces P o n tife sq u i tinrent,de leur
ÇM*- libéralité le .©.omaine utile de 'vingtTdeuxc.villes'eonquifes
' . fur les Lombards : s’ils firent tous ces préfens à'^Eglife,
Çe fu£ tQ^j^ÿrsj;ff)uÿ lafréferve de -la ^J^Ji^Pinété &, dd
., i l fujetionj<&^p|;s Charlemagne & ifom lÉ ^ rp fe f. eofeniiit.
4 àns d’aut-Ée jXrifdiétion que'celle de'nos Rois, &d
{V . les Confidératlo/istifur l’Hifloire de France ipiaâ'M. te;
J?léfident d’OrbeJfant).
■ w II fut auflî le bienfaiteur & le fondateur de plufîeurs
Eglifes-.de Bourgogne. Il.rétabfit celles de 5. Vincent de*
,• Çhalon, de '& Andoche de Saulieu qui 1?honore cômme
f ^Qnd^eur, &jqui ' pofsède encore dans la-côté
' . 4e Bourgogne.,} une pièce de vigne -■coniÉi-fous léinbm
. 4 ? Ç?P/> ’■dçJ. Qàartetf{àgriè. ■ II '„retèy^ de fes ruines; lsBglifg
fdél .S p ^^ e|C ranM d ?Autun, & lfAbbaye de> l’Ile-Barbe
-fuEsl^Sônè ^ brûlées pair fes
Sarrafins» Ih y rtàivpyav fa Bibliothèque avec Je S. Abbé
Benoît''d’Aniànéi pour y faire Beurif l^ letcrés* & jadi(C\
:^pline. Régulière. Il fit rèûitüer>des 'dîmes & ïes ’ bien«
Eçcléfîaftiques enlevés ^ar C^àri^-Martel fon aïeul. L’Xb^
baye^^,Ch'àte^©Kalbn èn; Gomtés qu’il fit rebâtir j pm
[phr. réçquuôilfapçe l e ' n O n n?
peut prendre sune, plus haute idée .de la piété dÔîide de cék
grand •Rot*-- 'què4, dans';,la leéfùre ' de" fo'rf teftataèrit, paf
lequel il. partage ^qç^^^s^inmenfes çiitre lesEglifes, lés
i pauvres, & Tes5 enfkn^.^H'Vit fous^fon'règne en BouW
gogûëVplüfléük pileux ' ^ ^ ^ m è ’ns.' ^ï^nafsès A bb é ’S I
F la v ig iiy o b ^ ip d ë de f o n ® -
üne Abbaye dans uù-lieu dtL- Mbrvqn7 àppellév*CôrAignpi^ -
' ‘db/lt' ‘"Wre tfondateûi dé liAbb'ayef01ui'Svoit feif don» Ea
iéponfe de Charletaqgne 'à l’Abbé Manafsès, nous apprend
qûe ce? PM-nie; fèi‘'' envoya, avec lâ permifÈop'qùif^ilii.
toit,- une châffe d’argent dans laquelle i f y- avoit des réli-
qüès )dh S^5èj)ulcï‘e s8 î dè $. Jacques l’Apôtre,- frère de:
E'Abbaye d'Ambourndy én Biigeÿ, fut^yfondée par
un Seigneur,dû pays, nommé Barnard ,^ ù î|^ n lr lu j[-’
même lMbit1'; religieux', & d evint par la fuite Archevè-
^Ue de Yieiine.