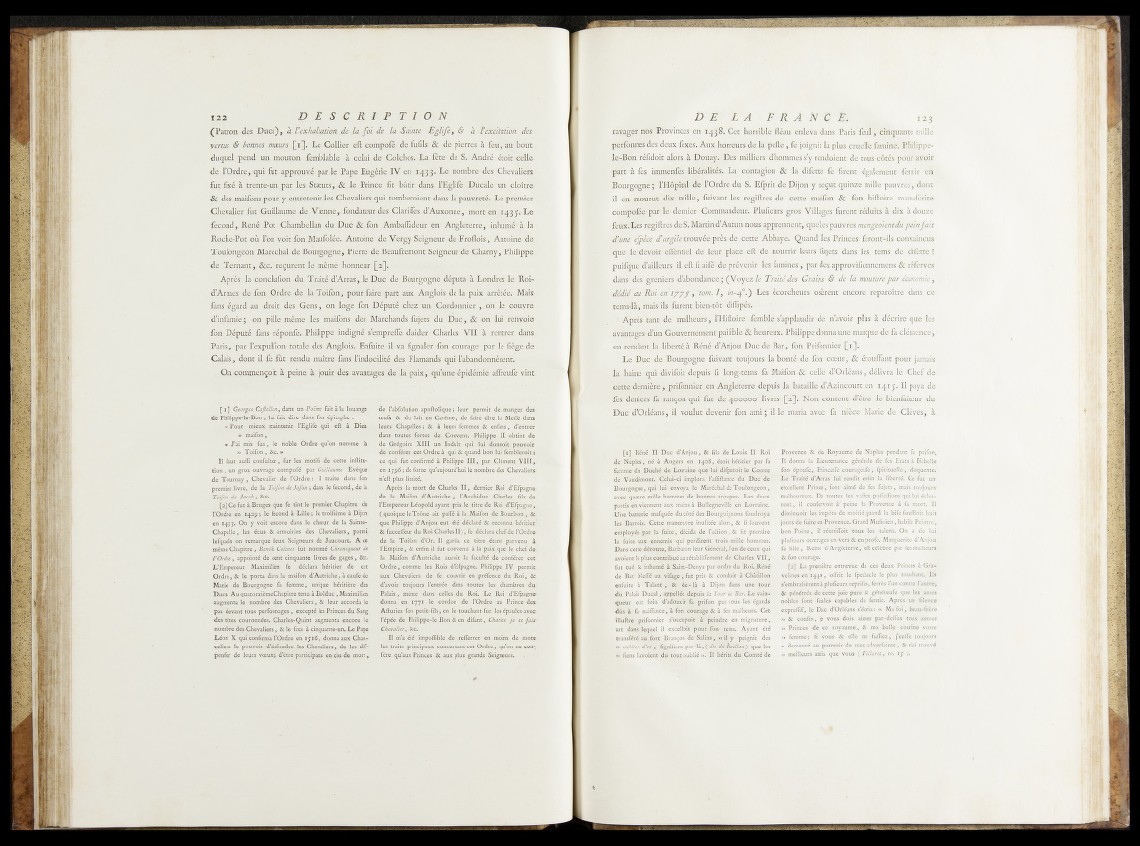
122 £ $ C R I R T I O N
{PsaoM-.4iss c f c :â t excitation. des
vertus & bonnes ma, ^^ÿB8ctf^Lj^3Mir<tfIj|ri<»TOÜLqtegCiclw pic-r , à feu, au t ouw<
Juqiielr|)£®d^^'jgg®Æ!|( jfçipblable jà f.celui ,de^Mq@^^^^^Stÿ$de|^,ti'André.étoitfieelle
A ? .lQr.ditygu j,fu t. approuvé par le ,Pjp.à Ecge3e,.I\4itn rq 3 3nf-c^rrn ît&Kf'dü, jC-lx fjjMBg
fut fixé à trente-un par les Statuts, & le Prince fit bâtir- dans l’Eglife Ducale un cloître
& des maifons pour y entretenir les Chevaliers qui tomberaient dans la pauvreté. Le premier
;^^êjfidiCT^j^^ m Uaum^de._,Vl0)^iMndatfflj|impP&ilfe^!:ci^tTOdne< .raoiÿen 143 J. (Le
■ fécond ,.:|il.c.néî Pq&Ühfflllyjldhadu Duc- & |lbjW’15iim|i^lIadeu,r*ntjAngleterre,--ii’n^^^ft|. là
Recj^K^fcùMionj^Qbgfon.Mttifilec 1 A.ntume d~ \ erg^ S i’gnaùr-dü^Frofiois ,ï \ni rnewéi
Toulongeon Maréchal q e îfiÉ ^ ^H ^ ^ ^ ^ ie ’isçfieauftemont Seigneur de Charny, -Philipp^:
de:^^rnant~iip l ^ redürenfel&’m&m&i?horinéU'rl[i2->]-. -4é>
A p r e f r. ir.'. il1 Arras-'-.b. Djc-dejiBêur. o.nBsdcPi.ta à^PridiçS l e Roi-
di^i)Ma-.derfqB|^fWe.‘.dey'^Eolr6ni pou. -lairef paiü^ux pànglohtdc; L pâjxfïàxrqîée'. \Mài's<
luiJBjïja d;Ji dt^faEel>,G^ns..j,onwlp^e»u’^,i Dérutéhwe^'tuMfer^^mii^r4lhenI»iê counre
iLmt mu., i âaujjll ,im.n c i-le^ym? mns/Æle jjMtrèh nd fijjttsrau*-Bu’ ï>&fl!pn lut r nU> -fi
fon Députe lan ;reponfc^lJlM,Fri'Vqd4EC‘^‘ym p i“fi&dKirAj*,Ch,_rLs3^/JiIjvàUe^Lrcrj.dins*
SP m i^ Ll l’cxpL Ül()Il|t tfe lc.d^^4 ll^jQljÆfliûlte nLijta^ gfelAforihciour-,eyp lIleTtege de-
Calais, dont il fe fut rendu maître làns l’indocilité des Flamands qui l’abandonnèrent.
„ j^QniC.qmmensoitià: peinej^fdBiiSEèsitSŸtiita'rfe^çiQ la paixjrcjutûne épidémie affréufe vinti
[ 1 ] Georges Cajlellan, dans un. EfiemeSfat à‘la .iQuaàëfr.
tSe PhilkiD^la-B(]n'<<lum£t^il:rèiQ^rÆo^rgpiisgüü : , ^
S'MtM^^ pC^Tmilx^m..inLaiiir l’Eglife qui eft à Dieu
s J’ai mis Jus h -le noble Ordre qu’on nomme là
» Toifon , &c. »
^ I l faut aüffi^eê^mfèig^fîar les motifs de cette incitation
, un gros ouvrage compofé par Guillaume Evêque
de Tournay , Chevalier de ^1’ Ordre1: il traite dans fon
premier f^§ .jpl|u |5 tèjfec<?nd,,.de la
• TM^ÆM J'ac°b s Scc* - -
[2] Ce. fut à Bruges que Je 'tint*le prg^^^^.pi^& de
l’Ordre en 1429 ; le Tecqnd,'à tLillev; leçt^olfîème'à Dijon',
en 14.33. ©u- y voit encore dans le choeur de- la Sainte-
Chapelle , les écus & armoiries des Chevaliers, parmi
léfquels, on remarque deux Seigneurs ; de .jauçqurt. A ce
même Chapitre „ Benoît: Coïinü^fut nommé Chroniqueur de
V Ordre, appointé de cent cinquante' livres de gages , Sic.
J /Empereur - Maximiliep^ fè^'^d^â|i'Ç héritier de eet
.Ordre, & le, porta dans, la maifon ' d’Autriche, à caufe de
Marie de Bourgogne là femme, unique héritière des
Ducs. A u quatorzième Chapitre tenu à Bolduc, Maximilien;
augmenta le nombre (des Chevaliers,, Sc leur accord'a-de-
pàs devant tous perfonnages, excepté les Princes du Sang,
dès tétés; couronnées; :Charles-Q.uint augmenta -encore le
•nombre des .Chevaliers , & le fixa à cinquante^un, Le Pape
Léon X qui confirma .l’Ordre en i j ' i é , donna aux Ghan-é
celiers le Jjpïw;bir 'd’abfo,udre les Chevaliers, de les' dif-
pênfer de leurs voeux; d’être participons en das de-jenorti
de l’abfolution apoftolique; leur permit de manger des
oeufs & du lait en Caiême, de faire dire la Me(Te dans
leurs Chapelles ; & à leurs femmes & enfans, d’entrer
dans toutes' fortes de; Çouv'ens.,, Philippe II'obtint de
de Grégoire XIII un Induit qui ’lui dronnoi't pouvoir
de corfféije^eet Ordre à~ qui & quand bon lui fembleroit :
ce -» 1 Ihiippe III ,v par ^Clément VMi,.
en ij$ é;,de forte qu aujourd’hui le nombre des Chevaliers
n’eft plus Æimjteil t
- Après,da mort de Charles I I , dernier Roi d’Ëfpagnej;
de la^-Mlifoit.
l’Empereur Léopold ayant i-priS’ le titre de Roi d’Efpagne,
( quoique le Trône ait paffé à la vA^airon^ dq B(ow|iqn^a&,
que Philippe d’Anjou eut ét^d|ekréT & ^reconnu héritier'
& fucceifeur du Roi''Ghalr.lës H ) , fe déclâr à« cheÆde r floW^
■ de', :1a Toif§n| Il, .garda1, ce titre étant parvenu à
l’Ëmpiae,,»&iienfihjàljupit«convenu à la paix,qu^l€^G'hef de
la Maifon d’Autriche auroit. la fàejilté/.de^conférer ',cet,
Ordre, comme les Rois d’Efpagne. Philippe IV permit
aux Chevaliers de fe couvrir en préfence'^MRpi) r§s
d’avoir toujours l’entrée dans toutes ,lès^c^âmbré^^ft;
Palais, meme dans • celfes du Roi. Le Roi d’Efpagne1
donna':en 1771 le cordon de l’Ordre au Prince des
Aftpries fqn^petit-fiJü en le toucl^ah^fi^^esvépaules avec'
l’épée de-, Philippe-le Bon & en difant, Charles je u jfaisï
Il m’a,'été impoflibl§;ide^.relTerrer en? moins: 'dh mots
les traits principauxîcohëeraa^ëet Ordre, qivon né confère
qu’aux Princes, &, aux plus 'grands Seigneurs* •
t> Ë ' L A T R A N C Ë . 123
lâjffifeMBPwvànCes en,^^jàSeâSÈm^&îfflëau si^ev'à 'dàjïs."'Ratïsf:iéul p flpaüante mille
peMtUàéS'des deux fexes, ^ law e f te à' fè wffitSlémK&'CBuelle famine, Pbilippele
Bon réfidoit alors à Douay. Des milliers d’hommes s’y reudoienc de tous côtés pour avoir
part à fes immenfés libéralités. X d b p a llKM ^H également fentir en,
Bourgogne; l’Hôpital de l’Oxdïe du 'S. Elprit de Dijon y reçut quinze mille pauvres, donc '
il en mourut diiix mille, fùivant les regilkes dè pette maifon & fon hiftoire manuferite
compisfée par le • dernier Commandeur. Pluileuxs gros’ Villages furent réduits à dix iLdot®!*
fë® E ré » g fc ê s< ^M # ll» i^ d ’AuttmWmapSMifl6riï#qti*i|paüv8d»i;^^^H|iW<^î4B_/&#
^Me^fsoe^^lS^wS^Muvéêipiès.de.'Gëttg''AbbayeiS^ua'fid''fes' Brjncétf feroJtt^il«' cûnVàînsus
pïifi|iïç>Ûf.îi il*îir4 il e& ^M ^® e^ r§V en k '* lM fe |h% ip s^®W ^® H fe s^fe® 1p®t1i^ ns® 'r ^ 'e*''res
c'tri^d s ^1 m 1 d( t^iSpii i.( / Tr~f -1 ■* G '£ * “
Wwr ' f, < ^**)*,‘Rc'^^^^Bstjïosèr&|*'^ib3!e|5iWsSoltre dans c»
tem's là. T ''nmïlnlstfureftti blsBOTiulOjdss*,1
Après tant de maUiems, lTIilloire femble s’applaudir de n’avoir plus à décrite que les
avSft^i^.Wd’Hïi ( ,o d > t,. t^ ^ ëh 't ;ÿ^ ^ fe^ é^ ^ è a J fe^ .% ^ îd î^ p< ^ a ô h n a^ u h e a 4 arql!l®TOlfl,T:lémérLàeV,
c 1 1 u iM i l S h 1 ol . ' 1 Ü n éM 'T i'o 'tf l-D iïo fd -'Jj {! l ’I n d u u 1
Vivant ^ f fl^ ^ là sbW téM B fM 'f fe 't îfl!^ ’é» 'u^ iiï pour lathaia/1
,k “haine -'qm di\ aJjjylp'iSjlmi ilon^L^sssSfMsrfbn’ tm, r t e a n s ,-édëll!vràf[lW‘ '®hèfde
Gdït^dëî*U^a^t;|^^d’x t^ li -AVU r^nerd--[_uis J . 1 ^Mll^ tÿA/lht. W en 141^. I l paya dê
lès deniers là rançon qui fut de 400000 lii re [ a ] . Non content d ê tre le bieml ike 11 du
Duc d’Orléans, il voulut devenir £bn ami ; il le maria avec fa nièce Marie de Clèves, à
i ‘ '5' "QWn'),* î" c“ «<1 t 11 R 1
.oé’INa'ples, ^rié 'à^Aigeÿy^en‘ *1^08,véfoit|h^^^mppr' fai
féfiifhé'du- Duché'.dë Lorraine qué'lui difputoït-le,-Comte
de Vaudémont. ''Celui-ci*' implora l’afiïftWèé'!d.ia Duc'de '
BouÉ^gné, 'qui ïffifenÿpÿa le’ Maréchal de To'ulônge’on*^
avec- ‘qùàtré -mille indirm^^de* j^OE^^^dpés; ’JLës deuxJ
partis en viennent aux mains à Bullegneville en Lorraine.
U'ne- ba'Étërie&mafquéé 'dmcêté des Bourguignons foudroya^
^ïàcBarrdisi- Cette manoeuvre inufîtée alors, & 'fi foùvent*
déployée1 ^par laf fuite Çf décida^deM^éliom, êt fit- prendre
>lak fhite' àui ^ ennemis ^tfi^perdirét^^Ois’ftmille’ hommess
Dans cette^de^ ^ é i -Barbazan leur Général, l’ün de ceux'qui'
jtoie’ht‘l^plus contribué au rétablifTemeiit dè'1 Charles V I I ,
fut-tué Stlinhlm^ ^ S é ut-Denys
de Bar'1blfeiré^aü"yif|gé à fuf pris &\cOTÎmiip‘ à-'Châtillon,
;enïiiite; à ’ Talant de - là ' à Dijdn 'daiw:^^fe4|ôur''
^ r o Pàlflls Ducal, appeiwefdemiisè&--Tour'dc'Bar.Le vaihïr^
qtrèur eut f©iù d^do'ucir ra^^lb'iî • par tous les1 égards
dûs àt fa naiffànce, à fon.* cotürage & à fes malheurs. Cet
îllut^tonfûnnieï s*5^ ^ p^Ë3B ^ g ^ | lt e en migriature,
art dans lequel il excell’oit pour-fon- items,- Ayant été
/ ttan^féï^^bîfefB'rahçôhf^è SaÜ'ril|;j^|Vy feëignft' des
S5 o«/r//ej t£’o/-j fignifiant par-là, ( dit du Èaillan) que les
» liens l’avoient-^^(|ü^oubl«p|! ' 11^ h^i'tsîdWGônîté'de
Provence\^^qè^pyramé ; «^Waples' pendant Ta prifouj
Il douna^J^L^^^^TCeVgéÜMfléf^M^HEratS à Ifabelle
^ ^ e u ^féwI^l^cËifë^Coura&eÙiéîi'miï'îcuêHg.lMefcmüent'èr-
l^lErti^’ïd’Arra^ liii benoit efifî’n" !ïa ' iibèrte.^CëWütP’.ti#
''ex^Up^p^^^^m^'aimé ^^éais;'-foufou^
^pl^u^e^^®eytoutes les’ vaw# ^^^epons;qéff^iî écla^
jtdinTTniirtitflfei'jjmp^'armOme 41^'hW
fui?erèt^Brpy'eïlcè^Gmn#iyit^ Peintre^
B o r n e r t a l e r i s . Oâ - a^de^jlml
plufîeurs ouvrages "en vers & eqipiofe, Marguerite d Anjod(v
' ffefiliIft'jV Rêine 'd’Angleterrè^ eft çélebtè par fes malheursl
g ^ ' '
fflg@|)La'<pfëmière, e h ^ ^ ^ ' aè '.{pêsVdéiEè'-Pfincëf %. Gray^
vëlin^sfè^I»p"; ' offrit le' Tp'ëâacle' le {5lïfs;to'ùd^nj^^l
::è’erhb r&fsèr.ëht à-^Mfîeiyâ^rèpîifes/t ferfès h,im1 c ô p t t^ aùtrë^
&> pénétrés- de;CeK^qie''pufè &• g'énérèufe- qüe lës,’âmes
nobl^^^nt, aëuleftv’eapablès de fentir. Après 'uri^ïilénêe
^ p p ^ ^ ^ ^ jd u e fd ’Q '^ P^^’éhfià : « Ma-foi, béau-firère
)/■ & ^btfiiî^T eW -^si^i^ 'a ié efA pa r^â è ffîs;^ tô^ ^
53 ' Pri'h'cfes1^ ’ë ^ e® 6^^pm^, & ma- ;belle; - ebufi'rie Votre
sV^^^^P'.^Wqus'-'l&t ' élle ^•në'\fuJpëzfiXjfejlfi^;> tôujoüfi
»l'derfteufé'au-'-pbu^itM'è'fiqësNàdvërlaiifM^^ & n ai trouve