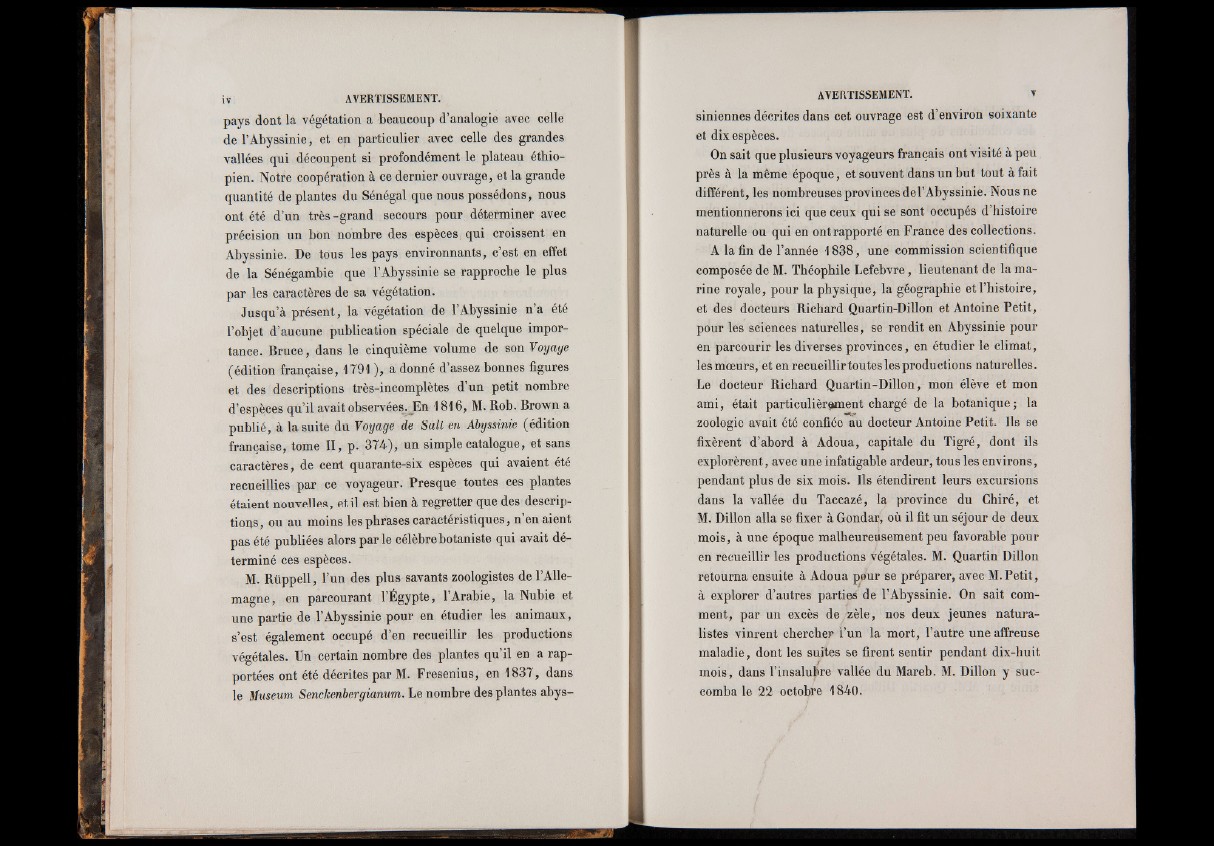
pays dont la végétation a beaucoup d’analogie avec celle
de l’Abyssinie, et en particulier avec celle des grandes
vallées qui découpent si profondément le plateau éthiopien.
Notre coopération à ce dernier ouvrage, et la grande
quantité de plantes du Sénégal que nous possédons, nous
ont été d’un très -grand secours pour déterminer avec
précision un bon nombre des espèces, qui croissent en
Abyssinie. De tous les pays environnants, c’est en effet
de la Sénégambie que l’Abyssinie se rapproche le plus
par les caractères de sa végétation.
Jusqu’à présent, la végétation de l’Abyssinie n’a été
l’objet d’aucune publication spéciale de quelque importance.
Bruce, dans le cinquième volume de son Voyage
(édition française, 1791 ), a donné d’assez bonnes figures
et des descriptions très-incomplètes d’un petit nombre
d’espèces qu’il avait observées.^En 1816, M. Rob. Brown a
publié, à la suite du Voyage de Sait en Abyssinie (édition
française, tome II, p. 374), un simple catalogue, et sans
caractères, de cent quarante-six espèces qui avaient été
recueillies par ce voyageur. Presque toutes ces plantes
étaient nouvelles, et il est bien à regretter que des descriptions,
ou au moins les phrases caractéristiques, n’en aient
pas été publiées alors parle célèbre botaniste qui avait déterminé
ces espèces.
M. Rüppell, l’un des plus savants zoologistes de l’Allemagne,
en parcourant l’Égypte, l’Arabie, la Nubie et
une partie de l’Abyssinie pour en étudier les animaux,
s’est également occupé d’en recueillir les productions
végétales. Un certain nombre des plantes qu’il en a rapportées
ont été décrites par M. Fresenius, en 1837 , dans
le Muséum Senckenbergianum. Le nombre des plantes abyssiniennes
décrites dans cet ouvrage est d’environ soixante
et dix espèces.
On sait que plusieurs voyageurs français ont visité à peu
près à la même époque, et souvent dans un but tout à fait
différent, les nombreuses provinces del’Abyssinie. Nous ne
mentionnerons ici que ceux qui se sont occupés d’histoire
naturelle ou qui en ont rapporté en France des collections.
A la fin de l’année 1838, une commission scientifique
composée de M, Théophile Lefebvre, lieutenant de la marine
royale, pour la physique, la géographie et l’histoire,
et des docteurs Richard Quartin-Dillon et Antoine Petit,
pour les sciences naturelles, se rendit en Abyssinie pour
en parcourir les diverses provinces, en étudier le climat,
les moeurs, et en recueillir toutes les productions naturelles.
Le docteur Richard Quartin-Dillon, mon élève et mon
ami, était particulièrement chargé de la botanique ; la
zoologie avait été confiée au docteur Antoine Petit. Us se
fixèrent d’abord à Adoua, capitale du Tigré, dont ils
explorèrent, avec une infatigable ardeur, tous les environs,
pendant plus de six mois. Ils étendirent leurs excursions
dans la vallée du Taccazé, la province du Chiré, et
M. Dillon alla se fixer à Gondar, où il fit un séjour de deux
mois, à une époque malheureusement peu favorable pour
en recueillir les productions végétales. M. Quartin Dillon
retourna ensuite à Adoua peur se préparer, avec M. Petit,
à explorer d’autres parties de l’Abyssinie. On sait comment,
par un excès de/zèle, nos deux jeunes naturalistes
vinrent chercher i’un la mort, l’autre une affreuse
maladie, dont les suites se firent sentir pendant dix-huit
mois, dans l’insalubre vallée du Mareb. M. Dillon y succomba
le 22 octobre 1840.