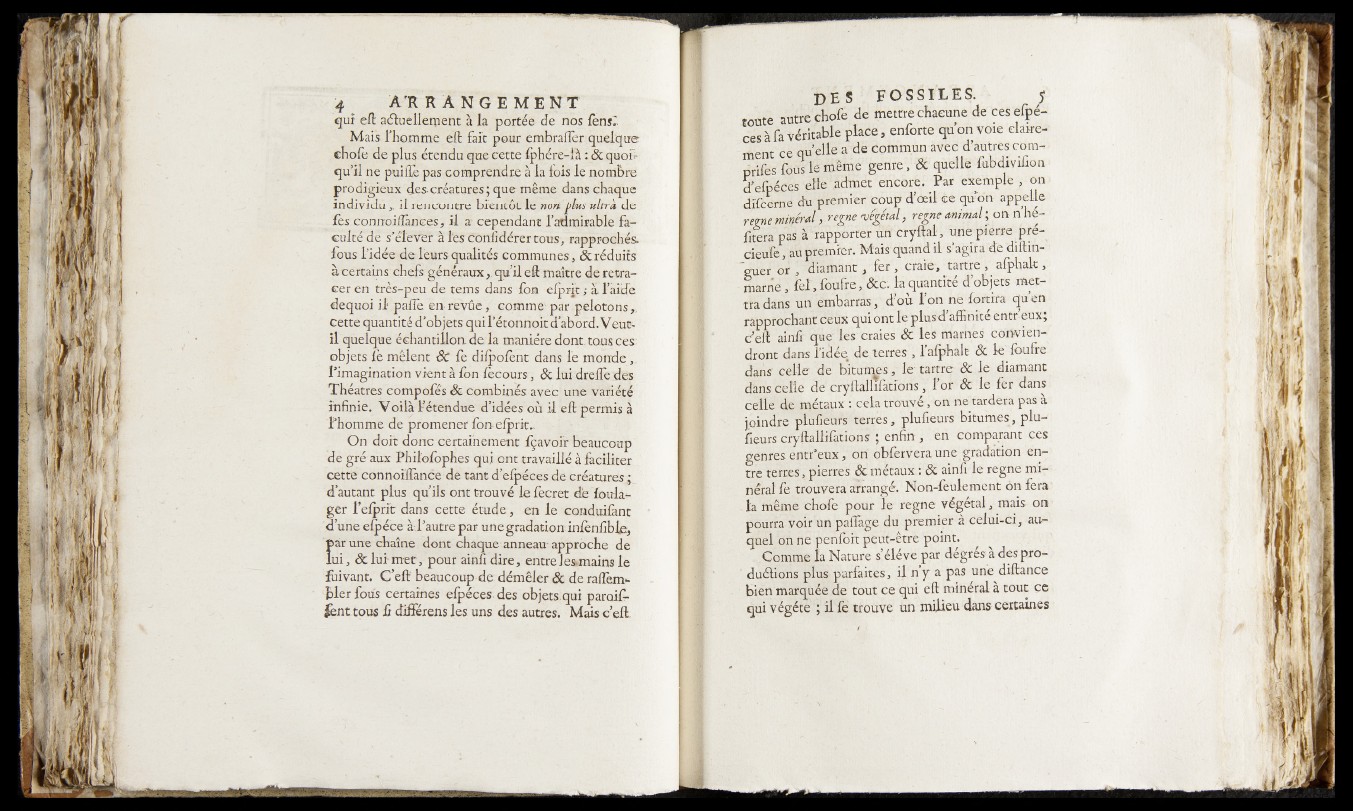
4 À'R R A NG E ME N T
qui eft actuellement à la porté© de nos fensZ
Mais l’homme eft: fait pour embraftèr quelque
choie de plus étendu que cette fphére-fà : Sc quofi-
qu'il ne puifte pas comprendre à la fois le nombre
prodigieüx des-créatures; que même dans chaque
individu il rencontré bientôt le non plus ultra de .
fes:cônhoi/îàn'cès, il a- cependant l’admirable fa-
cultecPe^'éîe^r àTésèbnfidérertous-, rapprochés.
fous1 l’idée -de- leurs qualités communes, & réduits
àrertains chefs'généraux, qu’il eft maître de retracer
èn très-peu de fems dans Ion eJprjt ; au fâide
dequoi ifpaïîe ën-revue,' comme par>pelotonst,
cette qüantité d objets qui bétonnait d abôrd. Veut-
il qüelque échantillon de la manière dont tous ces:
pbjêts le mêlent SC le dilpofènt dans le monde
fimagination vient à Ion fècdursq &.lüi dreffold^
Théâtres éompofé's Sc combinés aveb une variété
infinie. Voilà détendue' d’idées où il ‘eftpermis à
l ’homme de pfomeneT ion êfprit..
On doit donc certainement l^aivoir beaucoup
de gré aux Philbfophes qùi ont travaillé a ’faciliter
cette connoilîànce dè tant d’efpéces de créatures.;
d’autant plus qu’ils ont trouvé le lècret de foufri*-
ger l’elprit dans--cette étude, en le condufrànc
d’une espèce àvl’autre par une gradation.infenfib.fo,
par une chaîne dont chaque anneau- approche de
lu i, & lui m e t, pourainfidire, entreJeamainsle
fuivant. C’eflf beaucoUp de démêler Sc de raffern«-
bler fous certaines elpéces. des objetsiqui paroifo
lenttoiîs fi difîerens les uns des autres. Mais c’efL
toute autre’cHofé de mettre chacune de të$’# é -
ces à fa Véritable place, enforte qù on véie clane^
ment'cè qu elle a'dè-comm;ûnavêcd’âüfcrès com^>
d r te ïo u s lè hTêîpe genre, Sc quelle fubdivifion
d’efp'éées\èlfê\âdtnét encorè. Par exemple , ©n-
difcërtté du premier'coup doeil ce qii’on- appelle
rem em ^m lp em e vfrétai, régné animal ; on n’k ^ '>
frtera'pas, à fr^pùrter' $fcryffàf, mie piérre pre-
Cieuîe, ah prejmipr. Mais quand if s’agira dedlftin-1'
Vuer or J àiâmant, fer,. cràiê-, tartre^ afphak,
marne fej;, foufre, & c ^ k ^ h n tïté 4 ?objets Celtia
dans un émbârfàsjj| d’où l’on ne lortifa- qu'en
rapprochant’^ ù x qui'ont le plu^ü’affinité entreux;
d’eft ainfi que les'ùtaies & les marhéf cdirtvieri-'
dront dans l’idéé'de^erres , l alphalt 8c le foufre
dans- celle de bjtuiqes,~ le tartre- &.le*,Ramant
dâns?c â lé de^'ctyftallifations, l’ob*& leïflr dans
cefié de méfauV&éla trouvé',%n-nétardera pas à
joindre plufAfs terres, plufieursfbitumes^ plu-
fieurs cryftallifations ;' enfin , en comparant çes
genres erîtf’eux ja on obfervera une gradation entre
terres| pierres & métaux. : & ainfi le régné minéral
fe trouvera arrangé. Non-feulement ôn fera
la même choie pour le régné végétal, mais on
pourra-Voir:un paflàge du premier à celui-ci, auquel
ô'n fie pénion: pèiit-être point. " •
.Comme la Nature séléve par dégrés-à des pro-
' duétiobs plus parfaites, il n y a pas une diftance
bien marquée de tout ce qui eft minerai à tout ce
qui végète ;' il fë troüve trn milieu -dans certaines