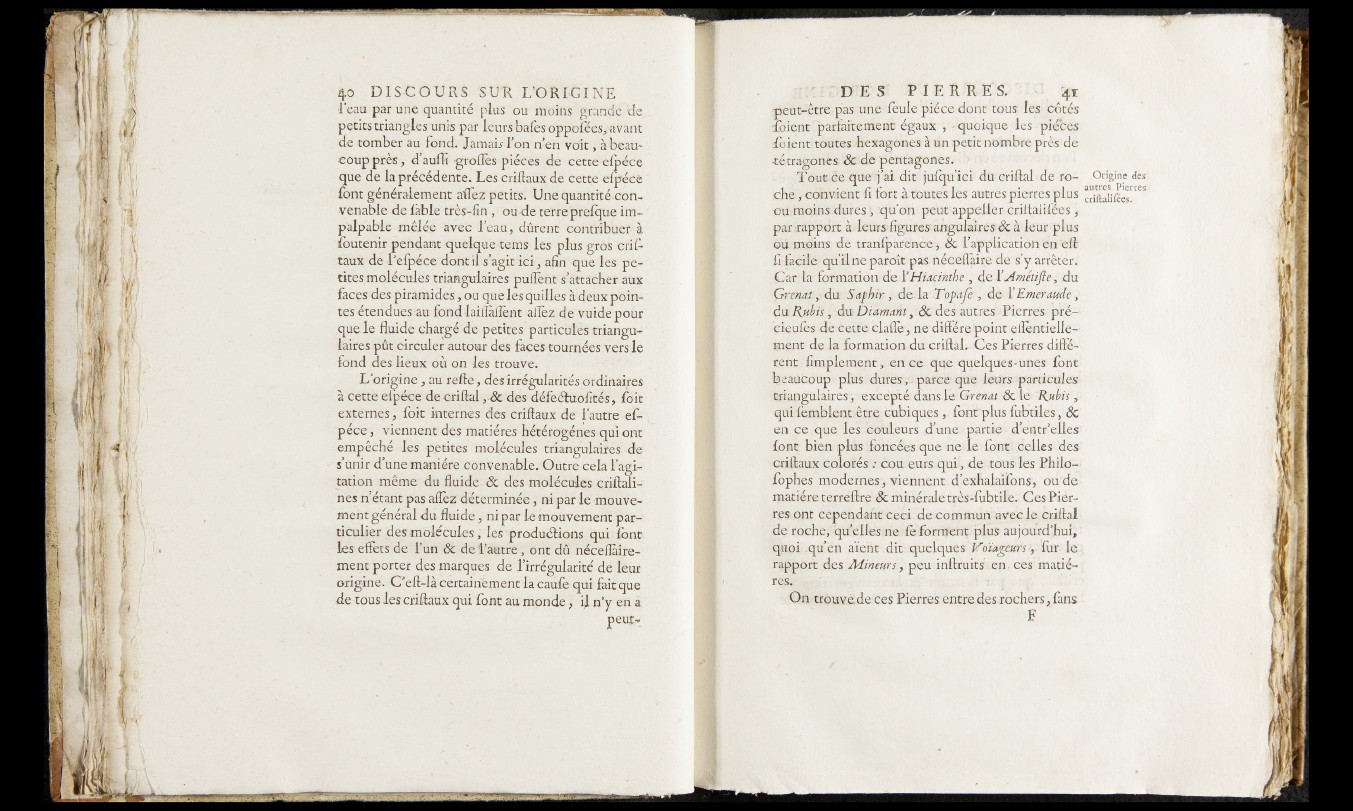
40 D I> C O Ü R S Stî'R L?O R lG fN Ê
i ’eau par une quantité plus1 ou rtiôm'S grande \le;
petits triangles unis pa^letirs baies oppofëèSjwà'Ÿânt
rie tomber âu fond. Jamais foïïm’en vdît firb-eau-
côup près y ri’auffi <grofïès piégés de cfetté^efpece
que rie la précédente. Les criftaux: de cette *efpécë
dont généralement ariez petits. tJne qmanrité>eon-
venable de fable très-fin, * oiirie teïre jpreique impalpable
mêlée avec l ’eaa, durent' Wnt'rfbüet;!
ïbùtenir péhdant'quelque^eïÉS'iês pkis gros -tzri£
taux de l’efpéce dont il sagit-kb, afin" que les pe~
tites molécules triangulaires pufïènt s’attâchèt aux
faces des piramides' ,ou qiïeles quilles ad eux pointes
étenduesau fond laiiTàfiènt a fiez de vuidepour
que le fluide chargé'de petites’ pâfticülès triangu*
laires pût circuler autour des faces tournées vërs le
fond dès lieux où on des trouve.-
L'origine, xau refie, desïrrégularitésfordinaires
à cette elpéce decriftal,8c des défeéhiofités, foie
externes, foit internes des'Criftaux de 1 autfe ef-
péce, viennent des matières hétérogènes qui ont
empêché les petites molécules triangulaires de
s’ünir d’une manière convenable. Outre cèla l’agio
tation même' du fluide de des molécules crifiraii-
nes riétant pas allez déterminée, ni par le mouvement
général du fluide ,• ni parle mouvement particulier
des molécules ; les'produ étions qui font
les effets de l’un & de l ’aut reont dû hëcefîàire-
ment porter des marques de l’irrégularité de leur
origine. C’eft-là certainement la caùfo qui fait que
rie tous les criftaux qui font au monde, il n’y en à
' D~E S P I E R R E S. | 1I ^
peut-être, pasrune feule pilée?dbfttf to'u&les cotés
rfojentCpariàitemètre égaux^fflquoique 4ôs$ pi éceg?
fojüentitautes-îlîexagdnes à unperipnOinbre ptèsriê
•■téittagonè© ?&idè" I b
i 'Touf-.ie.quetj’al; dit ijufoii’foi1 dos criftal ■ de rô-
.chfhj cornaieut *fî;’fort àdbüt'es les autres pierresplus
parirappriro folieurs; fi gu$é£ angulaires* 8c à-4èür ‘plus
dforndins die trari^afrinoe^ Jrii’a|Spw«ta<fHi érï*4#
fi. faèilër qu’il ne paraît pas néfedfl^içe'ri^^y> arrêter.
(Car la foîma.tiaii de l’Htaçihtherie YAnietifle>, du
Qrenail^ <iw„Saphjtr £ dé- ha^Tp'jM^’, - de YEmefaiide-,'
du Rubis, duîDiamant, 8c ries'aütresb^ierr'es-'pré-^
éieqfos rie èëùe;claffëvne'diffdre^)oii3t efïentielle->
méat delà formation ducriflal. XCebPierr-eS diffé-'
tent Amplement,. ereee^ qqe 'qqelques-unes < font
beaùfeoup plus dures,^ parce' que lêurs-particdlès*
triangulaires j ; excepté’dans ieriSreaa# 8ciè M&bfs y
qui'fembleatktxe. cubiques, fonbplus fùbtiles, &
en oe que, lesuddùleurs ri-uneu» partie?* d?e^tr’elles‘
font bien, plus foncées que nerifofonri celles dès
criftaux, c(dQlésib<fou2euisiqfoli deUKOuéles 'Phifou,
fophes modernesyvàeiinent. d’exhalaifons, ou ri<§i
matière terr.effcre & minérale très-fùbtilby i(Bës®iér-
rps ont cependaaGcèfci. de:comm.ua-Qve:cls, criftal
déroché, qu’elles me fe foraient; plus aujourd’/h11!» ’
quoi. ,qu en ai eût £ d k q u e lq n a sl^t&agems ïùr? fo.
rapport des M.imurs t peu? inftraitfeëpt c^imatié«
On tf6uveLde:Cés Pierres entrèdes rochers,.jfàns
I E
.Origine desr>
•autres Pierresl
-èriMlifécs.: