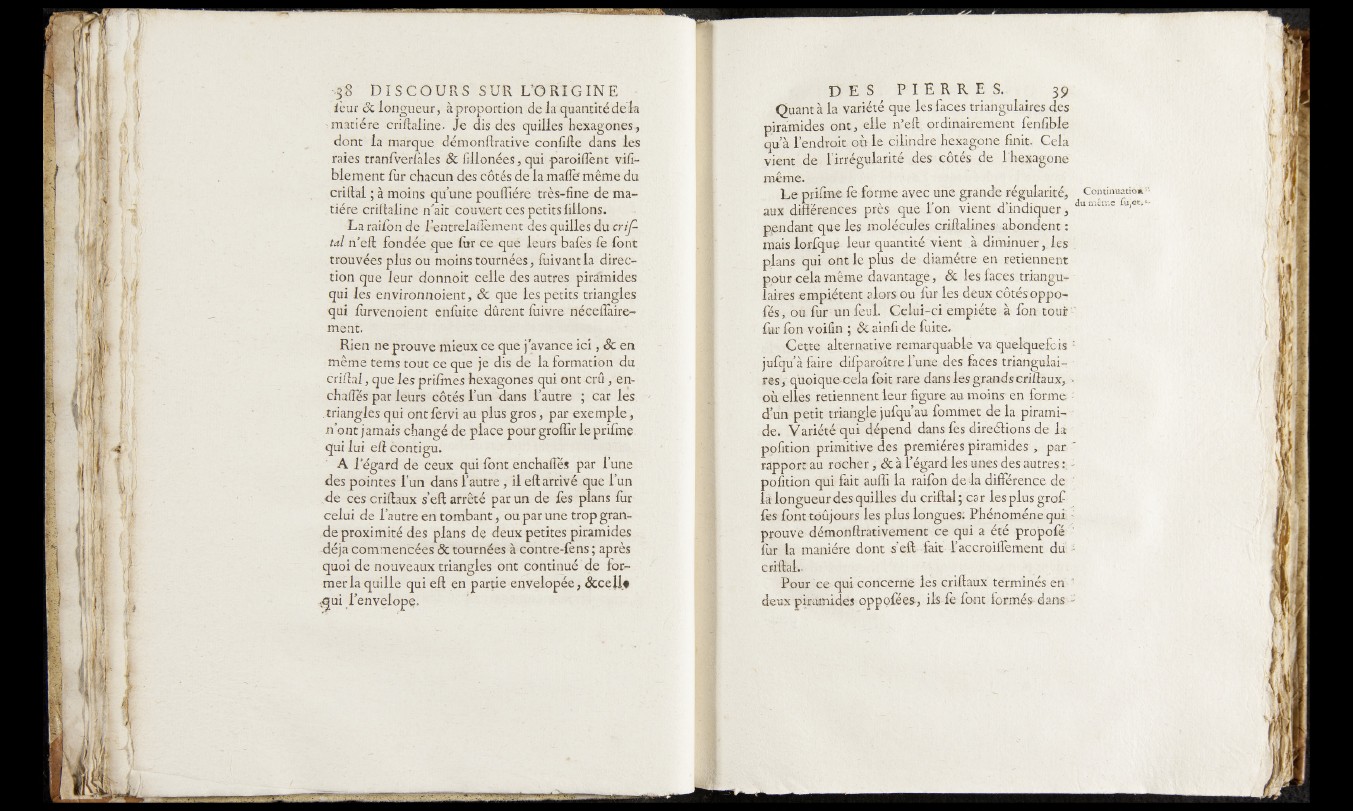
D I S €O U R S ' iS© R L’O R IG IN E
I ibufSc loogeetnq 1 ^©portion de laqâaratké dels
'• matière cnftaline» Je dis des quilles hexagones.,
dont la marque démonftrative confiée dans les
raies tranfoërfoles Sc fiilonées, qui paroiflènt vifi-
blement fur chacun des cotes de la malle même du
ctiflâl ; à moins qu’une pouffiére très-fine de ma-
ctiére criftaline naiteOü-\8ert-cespetits fdlons.
La railon de &ntrela&ment des quilles du c'r/y-
tal n’eft fondée .que lùr cequé leursbafoafo font
trouvées plus ou moins tournées, fiûvantla cfeee*
tion que leur donnôit celle deVautreS piràfriides
qui les environnoient, Sc qùe les petits triangles
qui forvenoient enfîiite dûrent fiiivre néceflàire-
ment.
Rien ne prouve ïùieux ce que j'avance ic i, Sc en
;même tems tout ce que .jé dis de la formation du
ctiitdl, que les prifines hexagones qui ont craven-
chafles par leurs côtés l’un dans l’autre ; car les,
triangles qui ont forvi au plus gros, par exemple,
n’ont jamais changé de place pourgroffirle prifine.
qui lui eft contigu.
A l ’égard de ceux qui font.enchafies par l’une
des pointes l’un dans l’autre, il eft arrivé que l’un
de eéscriftaux s’eft arrête par un de lès plans fiir
celui de l ’autre en tombant, ou par une trop grande
proximité des plans de deux petites piramides
déjà commencées & tournées à contre-lèns ; après
quoi de nouveaux triangles ont continué de former
la quille qui eft en partie envelopée, éfecéilt
.Æui l’envelopç.
D E S . P I E R R E S. 39
Quant à la variété que les faces triangulaires des
pjràmides ont, elle »’eft, ordinairement fenfible
qu’à l'endroit, où 1e. cilind-re hexagone finit., Cela
vient de l’irrégularité des cotés de lhexagone
mime.
Le pjifrBe.fe forme avec une grande régularité,
aux différences près, que l’on vient d’indiquer^
pendant que les molécules criftalines' abondent :
mais lorsque leur quantité vient à- diminuerles
plans qui ©nt le plus de diamètre en retiennent
pour cela mèmedavantage, Sc les faces trianguv
Lires empiètent alors, où fur les deux cotés ©ppo-
fés * ©& fur% unfoul. Cehii-ei emf iète à fon tout
fonvoiân ; Sc ainfide fuite.
_ Çette alternative fem^qpable va quelquefois
jufqu’à faire dilpaçcatre l’une des foees triangdtai-:
ress quoiquOcel» fok rare dans lés grands criftaux,
où elles retienn®î>t‘l®u? figure au moins' en forme
d’un petit- triangle jufqu’au fommet de là pirarni-
de. Varier équi dépend dans fos direélioras de la
pofition primitive des premières pirartiides , par
rapport au rocher, Sc à l’égard lesuoesdesàutres $
pofition qütiàit aulîi la raifon de la .dâll&ienÈe de;
là longueur des quilles du criftal ; car les plus gro£
fos font toujours les plus longues: Phénomémequi
prouve- démonffoativement ce qui a été proposer
foi la manière dont s’efo fait l’accroiflèment do!
Cïillah.
Pour ce qui concerné les eriffaux terminés en
deux pirumides oppçfées^ - ils-fo font formés dans