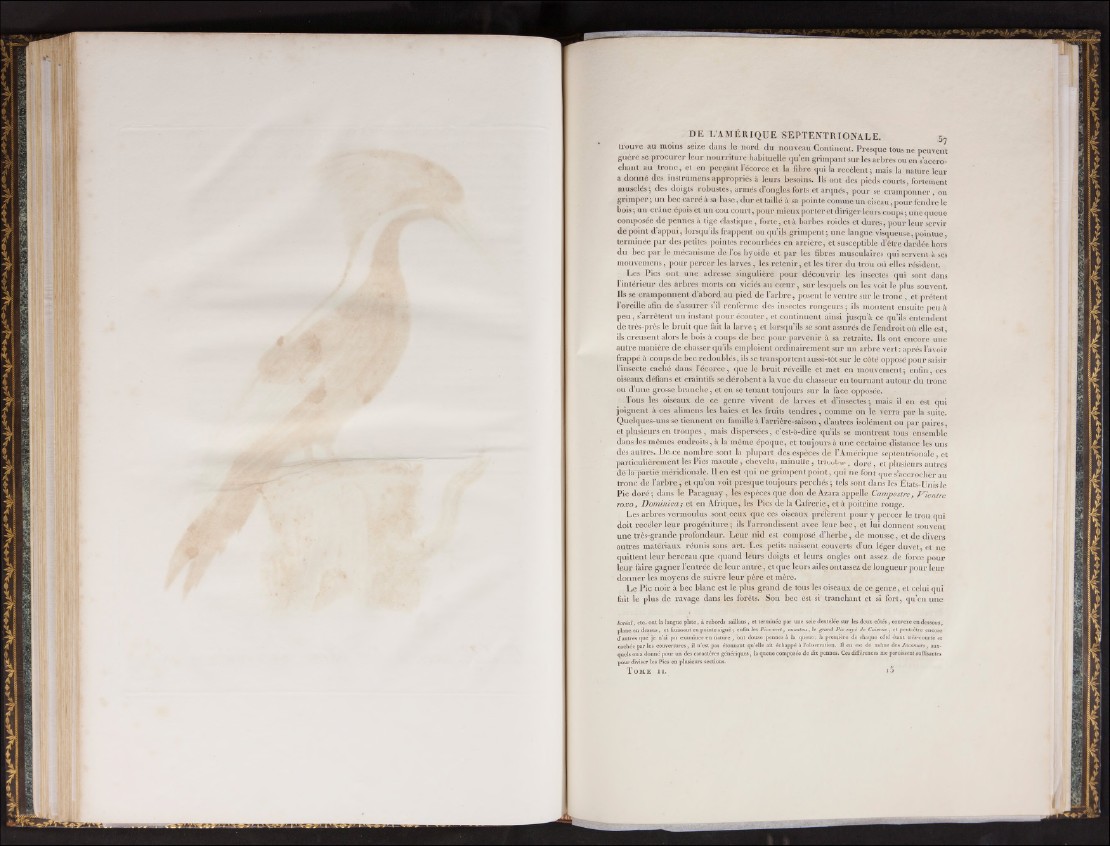
iruuve au moins seize dans le nord du nouveau Continent. Pres(jue tous ne peuvent
guère se procurer leur nourriture liabiluelle ([u’en grimpant sur les arbres ou en s’accro-
cliaiit au troue, el en perçant lecoree et la libre <]ul la recèlent; mais la nature leur
a donné des inslrumciis appropriés à leurs besoins. Us ont des pieds courts, foriement
musclés; des doigts robustes, armés d’ongles loris et anpiés, pour sc cramponner, ou
grimper; un bec carré à sa base, dur et taillé à sa pointe comme un ciseau, pour lendre le
bois; un cràiie épais cl un cou court, pour mieux porter cl diriger leurs coups; une queue
composée de pennes à lige élaslifjuc, forte, et à barbes roides et dures, pour leur servir
dc point d’appui, lorsiju ils Irappent ou qu'ils grimpent; une langue visqueuse, pointue,
terminée par des pcliles pointes recourbées cu arrière, et suscejilible d'ôtre dardée hors
du bec j)ar le mécanisme de l’os hyoïde et par les libres musculaires qui servent à scs
mouvctnens, pour percer les larves , les retenir, el les tirer du trou où elles résident.
Les Pics ont une adresse singulière pour découvrir les insectes qui sont dans
l’intérieur des arbres morts ou viciés au coeur, sur lcs([uels ou les voit le plus souvent.
Ils se craïupoinieul d’abord au pied dc l’arbre, posent le venlrc sur le tronc, et prêtent
l’oreille afin de s’assurer s’il rcnlcrmc des insectes rongeurs; ils montent ensuite ])eu à
peu, s’arrêtent un instant pour écouler, et continuent ainsi jus(ju'à cc qu’ils entendent
dc très-près le bruit que fait la larve ; el lorsciu’ils se sont assurés dc l’endroit où elle est,
ils creusent alors le bois à coups de bcc pour parvenir à sa retraite. Ils onl encore une
autre manière de chasser (ju'ils enqiloieiU ordinairement sur un arbre vert: après l’avoir
frappé à coups de bec redoublés, ils se transportent aussi-tôt sur le côté opposé pour saisir
l’insecte caché dans l’écorce, (jue le bruit réveille et met eu niouvemcm; enfin, ces
oiseaux défians et craintifs se dérobent à la vue du cliasseur eu tournant autour du tronc
ou d’une grosse branche, et en se tenant toujours sur la face opposée.
Tous les oiseaux dc ce genre vivent de larves et d’insectes; mais il en est qui
joignent à ces alimens les baies et les Irults tendres, comme on le verra par la suite.
Quelques-uns se tiennent en famille à rarrlère-saison , d’autres isolément ou par paires,
et plusieurs en troupes, mais dispersées, c’est-à-dire qu’ils se montrent tous ensciublc
dans les mêmes endroits, à la même épo<pie, et toujours à une certaine distance les uns
des autres. Dc cc nombre sont la plujiart des espèces de rAmêrIfjuc srjiientrionalc, et
particulièrement les Pics macule , clievelu, minulle , , (foré , cl plusieurs aulrcs
de la partie méridionale. Il en est qui ne grimpent point, qui ne font (pie s’accrocher au
tronc de l'arbre , el (ju’on voit presque toujours perchés ; tels sont dans les États-Lnis Je
Pic doré ; dans le Paraguay , les espèces que don de Azara appelle Campeslrc, Vicntrc
roxo, Doniinica', et en Afri(jue, les Pics dc la Cafrerie, et à poitrine ronge.
Les arbres vermoulus sont ceux que ces oiseaux prélèrcni pour y percer le trou ipii
doit recélcr leur progéniture ; ils l’arrondissent avec leur bec, et lui donnent souvent
u n e très-grande profondeur. Leur nid est composé d’iierbe, dc mousse, et dc divers
autres matériaux réunis sans art. Les petits naissent couverts d’un léger iluvct, el ne
quittent leur berceau t[uc (juand leurs doigts et leurs ongles onl assez de Ibrcc pour
leur faire gagnciT’enlrée dc leur antre, et cjue leurs ailes ont assez dc longueur jiour leur
donner les moyens dc suivre leur père et mère.
Le Pic noir à bec blanc est le plus grand dc tous les oiseaux dc cc genre, et celui qui
fait le plus de ravage dans les forêts. Son bec est si tranchant et si fort, <ju’eu une
boréal, eic. onl la langne plate, à rebords salllans , et terminée par une scie dentelée sur les deux côlés, convexe en dessous,
plane eu dessus , et Unissant en pointe aiguë ; enfin les Pics vert, ouaniou, le grand Pic rayé dc Caiennc, ot pcui-iTre encore
d’autres que je n'ai pu examiner en nature , ont douze pennes à la quetie ; la |)ren)ière de cliacpie côté étant très-courte et
cachée par les couvertures, il n’est pas étonnant qu’elle ait écliappé à l’uliservalion. Il en est de niêiiic des Jacnmars, auxquels
ou a donné pour un des caractères génériques, la queue compose'e dc dix pennes. Ces différences me paroissent suiTisauirs
pour diviser les Pics en plusieurs sections.
T ome ii. i j
I