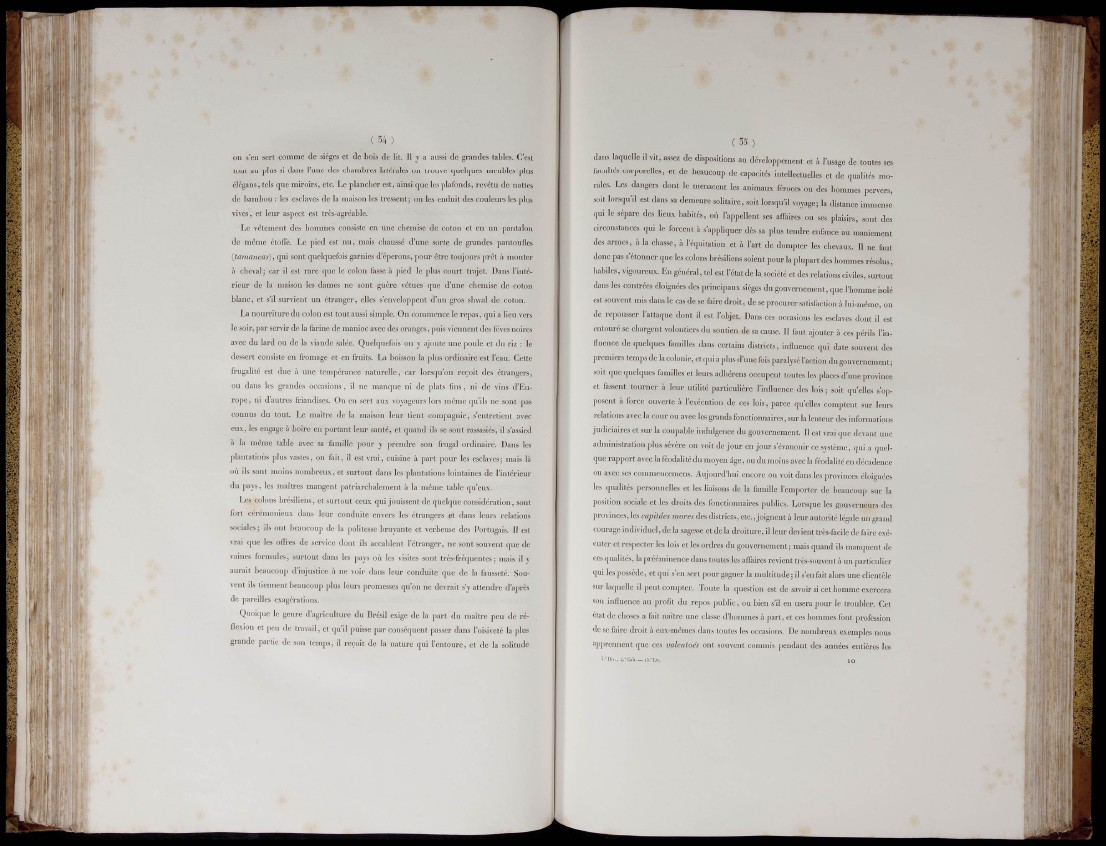
on s'en sert comme de sieges el de bois de lii. Il y a aussi de gi-andes tables. C'est
lout au plus si dans l'une des chambres latérales on trouve quelques meubles plus
élégans, tels que miroirs, etc. Le planclier est, ainsi que les plafonds, revêtu de natlcs
de bambou : les esclaves de la maison les tressent -, on les enduit des couleurs les plus
vives, et leur aspect est très-agréable.
Le vêtement des hommes consiste en une chemise de coton et en un pantalon
de même ctofre. Le pied est nu, mais chaussé d'une sorte de grandes pantoufles
(tamajicas), qui sont quelquefois garnies d'éperons, pour être toujours prêt à monter
à chevalj car il est rare que le colon fasse à pied le plus court trajet. Dans l'iniérieur
de la maison les dames ne sont guère vêtues que d'une ciiemise de coton
blanc, et s'il survient un étranger, elles s'enveloppent d'un gi-os shwal de coton.
La nourriture du colon est tout aussi simple. On commence le repas, qui a lieu vers
le soir, par servir de la farine de manioc avec des oranges, puis viennent des feves noires
avec du lard ou de la viande salée. Quelquefois on y ajoute une poule et du riz : le
dessert consiste en fromage et en fruits. La boisson la plus ordinaire est l'eau. Cette
frugalité est due à une tempérance naturelle, car lorsqu'on reçoit des étrangers,
ou dans les grandes occasions , il ne manque ni de plats fuis , ni de vins d'Europe,
ni d'autres friandises. On en sert aux voyageurs lors même qu'ils ne sont pas
connus du tout. Le maîire de la maison leur tient compagnie, s'entretient avec
eux, les engage à boire en portant leur santé, et quand ils se sont rassasiés, il s'assied
à la même table avec sa famille pour y prendre son Irugal ordinaire. Dans les
plantations plus vastes, on fait, il est vrai, cuisine à part pour les esclaves; mais là
où ils sont moins nombreux, et surtout dans les plantations lointaines de l'intérieur
du pays, les maîtres mangent patriarchaicment à la môme table qu'eux.
Les colons brésiliens, et surtout ceux qui jouissent de quelque considération, sont
fort cérémonieux dans leur conduite envers les étrangers el dans leurs relations
sociales; ils ont beaucoup de la politesse bruyante et verbeuse des Portugais. Il est
vrai que les o/Tres de service dont ils accablent l'étranger, ne sont souvent que de
vaines formules, surtout dans les pays où les visites sont très-fréquentes; mais il y
aurait beaucoup d'injustice à ne voir dans leur conduite que de la fausseté. Souvent
ils tiennent beaucoup plus leurs promesses qu'on ne devrait s'y attendi-e d'après
de pareilles exagérations.
Quoique le genre d'agi-icuhure du Brésil exige de la part du maître peu de réflexion
et peu de travail, et qu'il puisse par conséquent passer dans l'oisiveté la plus
grande partie de son temps, il reçoit de la nature qui l'entoure, et de la solitude
C 35 )
dans laquelle il vit, assez de dispositions au développement et à l'usage de toutes ses
facultés corporelles, et de beaucoup de capacités intellectuelles et de qualités morales.
Les dangers dont le menacent les animaux féroces ou des hommes pervers,
soit lorsqu'il est dans sa demeure solitaire, soit lorsqu'il voyage; la distance immense
qui le sépare des lieux habités, où l'appellent ses affaires ou ses plaisirs, sont des
circonstances qui le forcent à s'appliquer dès sa plus tendi-e enfance au maniement
l'équitation et à l'art de dompter l des armes, h la chas; es chevaux. Il ne faut
donc pas s'étonner que les colons brésiliens soient pour la plupart des hommes résolus,
habiles, vigoureux. En général, tel est l'état de la société et des relations civiles, surtout
dans les contrées éloignées des principaux sièges du gouvernement, que l'homme isolé
est souvent mis dans le cas de se faire di'oit, de se procurer satisfaction à lui-même, ou
de repousser l'attaque dont il e,st l'objet. Dans ces occasions les esclaves dont il est
cmouré se chargent volontiers du soutien de sa cause. 11 faut ajouter à ces périls l'influence
de quelques ihmilles dans certains disU'icts, influence qui date souvent des
premiers temps de la colonie,et quia plus d'une fois paralysé l'action du gouvernement;
soit que quelques lamilles et leurs adherens occupent toutes les places d'une province
et fassent tourner à leur utilité particulière l'influence des lois ; soit qu'elles s'opposent
à force ouverte h l'exécution de ces lois, parce qu'elles comptent sur leurs
relations avec la cour ou avec les gi-ands fonctionnaires, sur la lenteur des informations
judiciaires et sur la coupable indulgence du gouvernement. Il est vrai que devant une
administration plus sévère on voit de jour en jour s'évanouir ce système, qui a quelque
rapport avec la féodalité du moyen âge, ou du moins avec la féodalité en décadence
ou avec ses comniencemens. Aujourd'hui encore on voit dans les provinces éloignées
les qualités personnelles et les liaisons de la famille l'emporter de beaucoup sur la
position sociale et les droits des fonctionnaires publics. Lorsque les gouverneurs des
provinces, les capildes mores des districts, etc., joignent à leur autorité légale un grand
courage individuel, de la sagesse et de la droiture, il leur devient très-facile de faire exécuter
et respecter les lois et les ordres du gouvernement; mais quand ils manquent de
ces qualités, lapréénnnence clans toutes les affaires revient très-souvent à un particulier
qui les possède, et qui s'en sert pour gagner la multitude; il s'en fait alors une clientèle
sur laquelle il peut compter. Toute la question est de savoir si cet homme e.xercera
son iniluencc au profit du repos public, ou bien s'il en usera pour le troubler. Cet
état tic choses a (ait naître une classe d'hommes à part, et ces hommes font profession
de se fiiirc droit à eu.x-mêmes dans toutes les occasions. De nombreux exemples nous
•apprennent que ces valenLoés ont souvent commis pendant des années entières les
• i i r
I I
iî'"'
• ^ li
h i¡,-1l f i !
! 1
. . H
' l i i i : 1
< 1 1
M
,,!•! î
ïi i 1
T: i I
•'I
il II
I!